culture et histoire - Page 1189
-
Henri Vangeon - L'Action Française dans la Grande Guerre
-
Désaccords sur l' Art contemporain - Orages d'acier - 08/05/16
-
Roger Holeindre et le Choeur Montjoie Saint Denis viennent de sortir un CD pour évoquer l'Indochine et l'Algérie

Lorsque « Servir Dieu, l’Église et la Patrie » des scouts se conjugue avec le « Qui ose gagne » des paras et du bon sang corse, cela peut produire un mélange explosif : un engagement total, c’est-à-dire de toute une vie, droite, riche d’aventures audacieuses, une vie de combattant.
Les douze poèmes de Roger, ici rassemblés, ont été écrits au Vietnam, en Algérie et en prison, dans les années cinquante et soixante. Ils racontent ces engagements et des cicatrices encore douloureuses pour ceux qui sont revenus de ces guerres.
Roger les déclame lui-même, avec sa voix passionnée et chaleureuse qui a enflammé tant d’auditoires depuis plus d’un demi-siècle.
Et ces textes de feu sont illustrés par des chants des bérets rouges, verts ou bleu marine des troupes de Marine ou des scouts, interprétés fort à propos par le Choeur Montjoie.
Près d’une heure avec le sergent Antoine, tombé à Dien Bien Phu, avec Tong et Dinh, de Phủ Lý, avec le sergent-chef Brahim de la harka de Lanoix, assassiné par les rebelles du FLN.
Près d’une heure avec Roger Holeindre et le Choeur Montjoie Saint Denis...
En savoir plus et le commander cliquez ici
Vous pouvez aussi le commander via le CNC cliquez là
-
Commandant Kieffer chef des troupes françaises du débarquement
-
La Semaine de MAGISTRO, une tribune d'information civique et politique

La Semaine de MAGISTRO - Adossée à des fondamentaux politiques avérés, Magistro, une tribune critique de bon sens, raisonnée et libre, d'information civique et politique.
A tout un chacun• Arnaud TEYSSIER Historien "Pourquoi les français se plaisent à rêver d'un Macron ou d'un Juppé ?"
Du côté des élites• Christine SOURGINS Historienne de l'art, essayiste L'Etat perd de vue 23 000 œuvres d'art
• Maxime TANDONNET Haut fonctionnaire, ancien conseiller pour les affaires intérieures et l’immigration au cabinet du Président de la République
- Présidentielle : prolifération de candidatures et désintégration de la politique
- Église de Mossoul : la destruction ignorée
En France• Jacques BICHOT Economiste, démographe, Professeur émérite à l'Université Lyon 3 - Ancien président de Familles de France Naissances : nouvelle baisse au 1er trimestre 2016
Avec l'Europe• Eric ZEMMOUR Journaliste politique, écrivain Encore et toujours l’axe germano-américain
• Jean-Luc BASLE Economiste, ancien directeur de Citigroup New York L’euro survivra-t-il ?
De par le monde• Roland HUREAUX Essayiste Candidature d'Hillary Clinton : on ne saurait oublier combien la présidence Clinton fut défavorable aux intérêts français
• François JOURDIER Officier, amiral (2S) COP 21, la fausse menace
• Yves GAZZO Ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte auprès de l'Union européenne Problématique de l'eau dans le bassin méditerranéen : entre COP21 et COP22
Au-delà• Henri HUDE Philosophe - Directeur du Pôle d’éthique au Centre de recherches des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan Quelques pensées sur "La joie de l'amour" (3)
... Faites suivre s'il vous plaît à vos amis, dans votre famille et partagez, ...
MAGISTRO vous invite aussi à vous rendre sur son site et y (re)lire tous les écrits depuis son origine (2008). MERCI. -
Hommage à Ste Jeanne d'Arc 2016 : discours de Thibaut de Chassey
-
Je suis royaliste pourquoi pas vous ? - Compte rendu
-
Eric Zemmour : l’Eurovision, « concours de dressage au politiquement correct »
Pour Éric Zemmour, le titre J’ai cherché avec lequel Amir Haddad défendra les couleurs de la France au concours de l’Eurovision, qui se déroulera samedi 14 mai à Stockholm, « est une parabole de notre destin national : elle commence en français, mais peu à peu l’anglais recouvre tout », de sorte qu’« à la fin, on ne retient plus que l’anglais. » Pour lui, « la France s’aligne. Las de perdre à chaque fois, las de se ridiculiser, notre pays a entendu le message :la langue française était un obstacle rédhibitoire, une provocation, une ringardise. »
« Au moment où les Anglais s’apprêtent à quitter l’Union européenne, nos élites médiatiques accélèrent l’anglicisation de la France », poursuit Éric Zemmour. « Notre ministre de la Francophonie, André Vallini, s’est dit “consterné” par ce choix. » Un « service minimum », ironise-t-il, en rappelant que « les travaux de la Commission européenne, à Bruxelles, se déroulent en anglais ».
A Emmanuel Macron, qui a tenté de se vêtir des oripeaux de Jeanne d’Arc, Zemmour lance par la même occasion : « Il faudrait informer notre ministre des Finances que Jeanne d’Arc est morte pour bouter les Anglais hors de France. Et ce qu’elle détestait bien plus que les soldats anglais, [ce sont] ces Français qu’on appelait Bourguignons et qui se soumettaient de bon cœur à la puissance occupante. »
Et d’ironiser en ces termes sur Amir Haddad et sa chanson : « Prénom arabe, refrain anglais, ah ils ont bien fait les choses à France Télévisions. Ils ont coché toutes les cases du multiculturalisme pour mériter la récompense suprême. »
Il estime que l’Eurovision, qui fut « une kermesse sympathique », est devenue « un concours de dressage au politiquement correct : les chiens les plus savants et les plus dociles reçoivent seuls leur susucre ». Il ne manque qu’une chose : « Amir n’est pas transsexuel. » L’an prochain…
-
Passé Présent n°101 - Spartacus, chef de guerre
-
Chronique de livre: Anne Lombard-Jourdan "Aux origines de carnaval; Un dieu gaulois ancêtre des rois de France"
Anne Lombard-Jourdan, Aux origines de carnaval; Un dieu gaulois ancêtre des rois de France
(Odile Jacob, 2005)
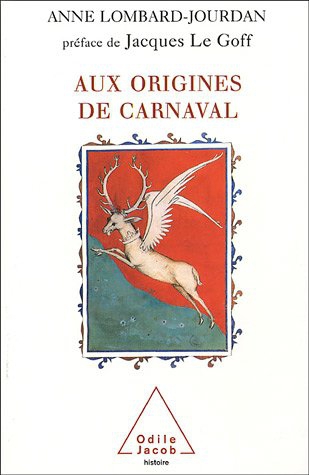 Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est lawütendes Heer, qui parcourt les airs, réminiscence du cortège des walkyries et einherjer mené par Odin/Wotan. Dans le monde celte, c'est la chasse sauvage ouwild hunt, que le Moyen-Age dit composée de nobles damnés, de fantômes et de créatures surnaturelles, démons et fées et menée par un avatar de Cernunnos : Hellequin.
Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est lawütendes Heer, qui parcourt les airs, réminiscence du cortège des walkyries et einherjer mené par Odin/Wotan. Dans le monde celte, c'est la chasse sauvage ouwild hunt, que le Moyen-Age dit composée de nobles damnés, de fantômes et de créatures surnaturelles, démons et fées et menée par un avatar de Cernunnos : Hellequin. C'est à ce thème et à ce personnage, dans leurs expressions françaises que s'intéresse l'historienne Anne Lombard-Jourdan dans son ouvrage paru en 2005 chez Odile Jacob et préfacé par Jacques Le Goff : Aux origines de carnaval ;Un dieu gaulois ancêtre des rois de France. A travers son exploration de la symbolique du cerf dans la culture française médiévale et en particulier au sein de la lignée royale, Anne Lombard-Jourdan dégage une mythologie gallicane fondée sur l'alliance complémentaire de la fée serpente Mélusine (dont se réclamèrent de nombreuses familles outre les Lusignan) et du dieu cerf Cernunnos. Elle fait de ce dernier, en étayant abondamment sa thèse, le tutélaire, l'ancêtre totémique des rois de France.
L'auteur s'intéresse tout d'abord, dans une démarche comparatiste dumézilienne, aux mythes du cerf et du serpent et à leurs liens dans le monde indo-européen et en particulier en Gaule, à travers les héritages celte, latin et germanique. C'est ensuite le personnage de Gargantua qu'elle analyse comme avatar du dieu-cerf à travers lequel Rabelais aurait exprimé, sous forme parodique, les rites et symboles du mythe gaulois. Dans la droite ligne de Claude Gaignebé, elle lit, au delà des pastiches truculents, l'expression de liens mythiques entre éléments et divinités en voie d'oubli. Cornes et viscères ne sont plus des références au "bas corporel" et aux tribulations sexuelles mais les attributs des dieux : bois et serpents.Le thème rabelaisien conduit naturellement à celui du carnaval, moment de jaillissement du refoulé païen et des rituels de fertilité au sein du calendrier chrétien. Masques, cornes, franges et cordes y réactivent de façon farcesque les mystères chamaniques liés au cerf et à la serpente. Une autre survivance du rituel se trouve dans la chasse au cerf, la plus noble entre toutes, dont l'historienne étudie, à travers manuels de vénerie et évocations littéraires, les codes. Ils témoignent d'une déférence particulière, de celles qu'on a face au totem, que seul peut chasser son "clan" : la maison royale et ceux qu'elle a anoblis.
Ayant ainsi déployé l'héritage secret de Gargantua-Cernunnos, Anne Lombard-Jourdan s'intéresse à sa parèdre, Mélusine, et à leurs relations de complémentarité symbolique : dans le rapport à l'eau (soif insatiable de l'un, milieu naturel de l'autre), dans l'opposition de l'aspect solaire (le cycle des bois, entre perte et renouveau, suit celui des saisons) et terrestre de l'un à l'aspect lunaire et aquatique de l'autre. Elle n'en fait ni des époux divins (ce qui serait une invention de toutes pièces) ni ne les apparente, mais y voit des polarités qui fondent une mythologie proprement française.
L'ouvrage revient alors sur la place dévolue au cerf dans la maison de France à travers les légendes mettant en scène ses membres et des cerfs surnaturels souvent liés à la figure christique, les illustrations et la présence physique des cerfs dans les demeures royales, et les métaphores littéraires qui rapprochent monarque et cervidé. C'est dans le cerf ailé (présenté en couverture) que les rois trouvent leur emblème totémique, lié non pas, comme la fleur de lys, au Royaume de France dans son entièreté, mais à la fonction monarchique en particulier. Enfin, le don de guérison des écrouelles, le rôle thaumaturgique du roi, est analysé comme un héritage chamanique lié au culte du dieu-cerf.
L'auteur revient en profondeur sur ce dieu-cerf, en en différenciant les avatars : Dis Pater s'incarnant tantôt en Cernunnos, tantôt en Sucellus, et leurs compagnes Herecura et Nantosuelta, la femme-biche et la déesse des eaux, entourée de serpents. En Angleterre, c'est le roi légendaire Herne, ou Herle qui semble recueillir l'héritage du dieu-cerf, tandis qu'en France certains saints se le partagent. Le roi Herle ne peut que rappeler notre Herlequin ou Hellequin original, et c'est en effet lui qui clôt cette étude avec sa mesnie. Les herlequins, ou hellequins, sont les "gens" (/kin), la famille de Herle, le chasseur éternel et cerf lui-même. Le christianisme en a fait une cavalcade démoniaque, mais elle demeure liée aux dates ancestrales de l'ouverture du sidh, ce monde de l'au-delà où Cernunnos se portait garant pour ses enfants. De nombreux attributs physiques et vestimentaires furent attachés à cette menée. Des figurations celtes aux carnavals populaires, des évocations féeriques aux "arlequinades", on les y retrouve. Certains, comme le couvre-chef d'invisibilité, renforcent le lien entrewütendes Heer et chasse sauvage.
A l'issue de cette enquête, on trouve encore des annexes éclairantes : un dossier étymologique, indispensable à toute personne intéressée par le folklore et ses symboles, des documents archéologiques, diverses sources littéraires ainsi qu'une étude sur l'utilisation politique de la Mesnie Hellequin entre France et Angleterre.
Mythes, totémisme, royauté, folklore, transversalité européenne et gallicanisme, cette lecture a de quoi intéresser et enrichir à plus d'un degré quiconque s'intéresse à son héritage, mais pourra tout aussi bien permettre au gamer d'approfondir les thèmes du dernier opus de The Witcher (Wild Hunt), et aux métalleux de comprendre ce qu'il en est historiquement et culturellement de laMesnie Herlequin.Mahaut pour le C.N.C.
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/