culture et histoire - Page 1296
-
Passé Présent n°71 - Byzance, mille ans de civilisation brillante et chrétienne
-
Définition du Moyen Age par Le Goff
-
Zoom : Philippe Fabre, historien : L’emprise américaine sur le monde va s’accroitre ! (13-10-2015)
-
L’exactitude intellectuelle d’Alain Finkielkraut
Lire Alain Finkielkraut est toujours un enrichissement. Cette fois, avec La Seule Exactitude, il livre un recueil d’articles. Autant dire que nous sommes dans un genre mineur. Mais les articles ont été soigneusement sélectionnés et chacun nous offre, sur des sujets toujours différents, comme une trouée de lumière.
L’exactitude de Finkielkraut est faite des multiples détails de l’actualité quotidienne mais ce qui en fait la valeur, c’est que le détail choisi est révélateur du temps où l’on vit et des personnages qui font l’actualité. Pour que ce détail devienne décisif, il faut d’abord accepter de le regarder comme il est en lui-même et non tel que nos grilles de lecture, nos préjugés et nos conformismes nous pousseraient à le comprendre. L’effort de Finkielkraut est avant tout un effort de décryptage : « Il nous incombe de déchirer sans délai les portraits-robots qui nous obnubilent et de regarder en face le visage que nous n’attendions pas. » On se demande parfois pourquoi on assiste à une telle droitisation de l’univers culturel, pourquoi il n’y a que les livres de droite qui se vendent et pourquoi même les livres de gauche qui marchent (Michel Onfray) parlent aujourd’hui à la droite. C’est simple : seule la droite (une petite partie de la droite) a su s’extraire du politiquement correct pour regarder les choses non pas comme le prêt à penser nous les offre mais telles qu’elles sont en réalité. La force de cet ouvrage est dans cet effort de réalisme alors que ce qui se met en place, en particulier depuis les 7 et le 11 janvier 2015, c’est une nouvelle culture, tournant autour de trois questions fondamentales, que la culture de gauche avait passé par pertes et profits : l’identité, l’intimité (ou la liberté individuelle) et la religion. Exemple : la chronique intitulée « Voyage en France », recueillant le témoignage de Claude Levasseur, « un retraité actif qui s’occupe d’Emmaüs ». Claude ressent un malaise, le malaise français aujourd’hui : « Je vais souvent au Maroc et j’ai l’impression que ce ne sont pas les mêmes. Là-bas, on ressent une chaleur à votre contact, on est chez eux. Ici, dans un quartier d’origine musulmane, on n’est plus chez soi. Une espèce de méfiance s’est créée. Il y a simplement les regards quand vous passez. » Commentaire d’Alain Finkielkraut : « Claude n’a pas peur de l’Autre, mais il accepte mal de devenir l’autre à Tourcoing. » Une ligne suffit. Tout est dit, le malaise est circonscrit. Mieux : il est verbalisé. À partir du moment où l’on peut en parler clairement, sans pour autant subir les foudres de la pensée unique, on a déjà fait la moitié du chemin.[....]
Joël Prieur
Alain Finkielkraut, La Seule Exactitude, éd. Stock, 298 pp., 19,50 euros.
La suite sur Minute-hebdo.fr
http://www.actionfrancaise.net/craf/?L-exactitude-intellectuelle-d
-
CONFERENCE "EN FINIR AVEC LES PREJUGES SUR L'ISLAM" DE JOSEPH FADELLE
-
14 octobre : conférence sur l'éducation à Bouchemaine (49)
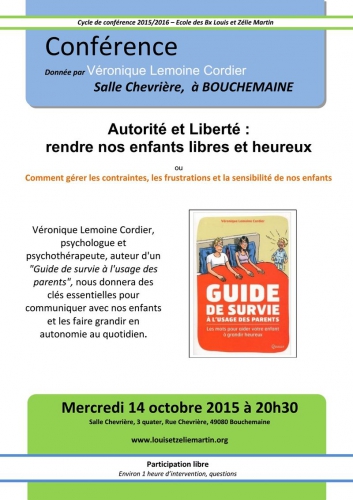
-
Guerrier 2.0
Sur le champ de bataille depuis l'aube, les yeux fatigués par l'agressivité lumineuse de l'écran de son Mac, Edouard pensa qu'il pouvait s'autoriser une courte pause. Dès le réveil, renonçant à un quelconque petit-déjeuner, il avait vaillamment combattu, enfonçant le bataillon Azov sur Fabecook et ridiculisant les hiérarques corrompus du régime fantoche ukrainien via Twitter. Vladimir Poutine, l'homme-ours, le nouveau Tsar, mi-politicien, mi divinité, ultime espoir du monde libre - dont le visage à la fois viril et rayonnant d'intelligence malicieuse faisait office de fond d'écran - semblait lui sourire avec confiance et gratitude.Edouard, à 21 ans, était déjà profondément déçu par la politique. Nationaliste radical, membre successivement de trois groupuscules qu'il avait été contraint de quitter suite à des divergences idéologiques insurmontables, il avait préféré « prendre du recul » et ne croyait plus vraiment à la « cause ». Il avait donc peu à peu renoncé au militantisme traditionnel auquel il avait tant sacrifié, ayant même été collé au concours d'entrée de l'ESSEC suite à une dénonciation politique qu'il n'avait jamais pu prouver mais qui n'en était pas moins évidente et certaine. Désormais, toutes ses espérances reposaient à l'Est, dans la figure du maître du Kremlin dont - il le savait maintenant - les chars seuls pourraient un jour libérer sa bonne ville de Montauban de l'occupation mahométane qui le contraignait à vivre quasiment barricadé dans l'appartement familiale dès que la nuit était tombée. Il fallait bien être le dernier des vendus à la CIA pour ne pas se rendre compte et admettre que l'avenir de la civilisation européenne se jouait dans le Donbass, région dont il ignorait l'existence il y a deux mois encore et dont il envisageait aujourd'hui de se faire tatouer le drapeau sur le muscle, timide mais nerveux, de son bras droit.Harassé par les confrontations de la matinée, il s'octroya donc un moment de répit bien mérité. Sur Google, les recherches « Marion Maréchal nue » et « Marion Maréchal sex-tape » n'ayant donné aucun résultat, il se rabattit sur Youporn et un classique « Pregnant teen gang bang ». Après quelques instants de frénétique copulation collective et un léger gémissement satisfait, il interrompit la vidéo. Son sexe mollissant dans sa main encore légèrement tremblante, le foutre répandu sur le contreplaqué du bureau, il pensa qu'on trouvait vraiment des choses dégueulasses sur internet et qu'il serait sans doute bon d'écrire un petit billet pour dénoncer cet état de fait, nouvelle preuve de la décadence occidentale. Enfin, il ferait ça lorsque la guerre lui laisserait un peu de temps... Rasséréné et apaisé, il pouvait maintenant remonter au front. Il n'était que temps d'ailleurs car, depuis Saint Martin en Ré, Werwolf88 avait lancé une contre-attaque d'envergure en diffusant une vidéo montrant de membres présumés du FSB sodomisant des chatons devant les yeux ruisselants de larmes de leurs légitimes propriétaires. Le coup était d'importance car le post avait déjà été « liké » plus de trente fois et une quinzaine de commentaires rivalisaient dans l'exclamation horrifiée et le haut-le-coeur scandalisé ! « Egorgez-vous entre vous tant que vous voulez, tas de barbares, mais ne touchez pas aux animaux, si mignons et si innocents ! » était l'idée plus ou moins centrale. Personne ne remettait en cause l'authenticité et la fiabilité de l'information. Edouard se devait de réagir, rapidement et efficacement. Il hésita entre la diffusion du témoignage d'un paysan ayant observé des membres du Pravy Sektor jouant au football avec la tête d'un prisonnier pro-russe ou celle d'un article du blog « Je kiffe la Russie » expliquant que les bataillons de volontaires ukrainiens étaient en fait commandés par des officiers SS cryogénisés en 1945. Ne parvenant pas à trancher, il publia les deux textes, non sans adresser un doigt d'honneur rageur à Werwolf88 et à sa clique altantico-européiste !L'ennemi paraissait passablement sonné par la fulgurance et l'efficacité de sa réaction. Il restait sans réponse. Le cliquetis des souris électroniques semblait suspendu, peut-être étaient-elles enrayées. Le fumet de la victoire s'exhalait des réseaux sociaux et couvrait presque celui du tas de linge sale qui jouxtait le bureau. Le doux soleil d'Austerlitz glissait au travers des persiennes mi-closes. C'était le moment idéal pour s'égarer dans quelques escarmouches sur des sujets moins tragiques et fondamentaux. Une petite note pour expliquer comment Jean-Marie Le Pen aurait dû gérer le Front National depuis 20 ans, une brève lamentation sur la destruction des églises, ces précieux symboles de notre culture et de notre identité où il ne mettait jamais les pieds, un bref commentaire discrètement scabreux sur la photo d'une jeune militante en maillot de bain, une citation de Drieu et une de Bloy, pour la forme, quelques réflexions sur l'importance du grec et du latin à l'école, la défense de la corrida, la nécessaire sévérité dans l'éducation des enfants...Edouard était en verve, exalté par son nombre quotidiennement croissant de « followers » et « d'amis », mais il fût bientôt interrompu dans son offensive tous azimuts par la voix maternelle l'invitant à se rendre à table pour dîner.- « Doudou, viens vite, ça va refroidir ! »On reprendrait les hostilités un peu plus tard, après la tarte au citron meringuée et la finale de « Master chef ».Xavier Eman(In revue Eléments, numéro 156) -
Modernisme et Totalitarisme
Tous les esprits obsessionnels et/ou enthousiastes (l’un ne va pas forcément de pair avec l’autre) sont d’essence manichéenne. Ils se différentient très fortement de ceux qui ne partagent pas leur conviction, intensément vécue, assimilée à La Vérité. La distinction entre « eux » et « nous » tourne très facilement à l’alternative « eux » ou « nous ». C’est l’essence même du phénomène totalitaire, vieux comme l’humanité, infiniment plus répandu qu’on ne le croit.
Tout le monde l’aura compris : le suffixe « - isme » indique l’exposé d’une doctrine, qu’elle soit d’inspiration (ou « d’essence ») religieuse, politique, scientifique ou artistique.
A – Le Totalitarisme n’a rien de spécifiquement moderne !
C’est, par définition, un État où le détenteur de l’autorité exige l’obéissance absolue de ses ouailles, en « totalité », c’est-à-dire non seulement dans leur corps (travail, service armé, participation à la vie sociale), mais aussi de leur esprit (par une idéologie officielle imposée au peuple sous la forme d’une pensée unique)… voire de leur « âme » pour ceux qui croient en une ou plusieurs divinités.
Toutes les théocraties anciennes (soit les civilisations où le monarque était réputé « de droit divin » ou était lui-même souverain pontife du culte officiel) ont été des totalitarismes au même titre que le communisme, le fascisme ou le nazisme, et si les musulmans sunnites parviennent à s’accorder sur la personne d’un nouveau calife, celui-ci deviendra un potentat de droit divin, absolu s’il cumule les fonctions de sultan (chef politico-militaire).
Le totalitarisme est une manière d’envisager la domination des êtres humains. Il est indépendant du type de régime politique : le Pouvoir peut appartenir à un seul homme, dictateur omnipotent, à deux hommes ou à un consortium d’hyper-capitalistes. Il peut être fondé sur une foi, sur le culte de l’État ou de la race, sur un dogme économique et/ou social.
Le dictateur (si l’on préfère : l’autocrate) dirige lui-même :
* l’Exécutif, soit le pouvoir qui fait respecter les lois et la puissance de l’État : administration, fiscalité, polices généralement nombreuses et très puissantes, armée, prisons, relations étrangères
* le Législatif, en décidant seul des lois, avec ou sans la fiction d’un parlement à sa botte ; il n’existe en totalitarisme moderne qu’un parti unique, ce qui procure au despote des élections sans surprise
* le Judiciaire (même remarque que pour le parlement : des magistrats vautrés devant le maître ou convaincus sincèrement de son génie)
* l’Économie, étatisée, dans le cas du marxisme, ou plus ou moins fermement dirigée, dans les régimes populistes
* la Propagande, soit l’information domestiquée : les media, qui vont du ministre de l’Information aux « réseaux sociaux », en passant par la presse, la radio, le cinéma et la télévision, les organismes culturels et les « sociétés de pensée », voire un clergé aux ordres ;
la jeunesse est l’objet d’un endoctrinement spécifique dans un espoir, assez rarement vérifié, d’assurer la pérennité du régime -
« A Quoi sert l'Histoire » par Hannibal
L'histoire démotique est celle que les manuels, les journaux, les médias nous donnent à lire et à voir. C'est en quelque sorte la soupe directrice qui forme nos connaissances, notre jugement et notre sensibilité. Le vingtième anniversaire de la chute du mur de Berlin en a vu un flot de déverser. Peut-on l'analyser ?
Pas à proprement parler, puisque, c'est la loi du genre, les informations sont beaucoup trop nombreuses et hétérogènes pour être seulement perçues. Mais, dans la grande presse, les grosses chaines de radio et tv, les principaux portails web, on peut noter des choses.
Des anomalies.
Ainsi Orange retranscrivait-elle, pour le mur, le texte de Wikipédia, encyclopédie participative sans aucune autorité. Des absences. On ne parlait ni de Jean Paul II, ni de Soljenytsine, ni de Ronald Reagan, qui ont plus fait pour abattre le mur que tous ceux qui étaient évoqués. Des présences, enfin, insolites. Une présence surtout. La présence partout de communistes et d'ancien communistes pour commenter, de Marie Georges Buffet à Alexandre Adler. La présence massive, parfois jusqu'à cinquante pour cent et plus des invités. C'est un peu comme si, dans une émission commémorative tenue le 8 mai 45, l'on avait invité une majorité de nazis pour parler de la chute de Berlin.
Réinformer, serait rappeler l'évidence ?
Réinformer, à ce sujet, serait rappeler l'évidence ? ce sont les anticommunistes qui ont fait tomber le mur. Renseignez-vous, regardez autour de vous, sortez: l'anticommunisme n'a pas très bonne presse. Certes, grâce à Courtois, Furet, Harendt et quelques autres, on veut bien condescendre à reconnaître que Staline a fait beaucoup de mal, mais cela ne veut pas dire que le communisme n'ait pas été un très bel idéal, et que l'anticommunisme (toujours primaire, toujours sectaire) soit justifié. Parmi les bobos et l'opinion paresseuse qui les suit, la phrase de Sartre subsiste toujours, à peine diluée: “ Les anticommunistes sont des chiens, je ne sors pas de là. "
Quant au mur, et au bloc soviétique, il est élégant de dire qu'ils sont tombés tout seuls, sous l'effet de la décomposition du système et grâce à l'action si l'on veut de Gorbatchev. Or cela ne veut rien dire. Dire que le système soviétique s'est décomposé, c'est donner raison aux anticommunistes qui seuls pendant trente ans affirmèrent qu'il était inviable - alors que les autres, jusqu'en 1974, l'encensaient. C'est aussi donner acte de leur action à tous ceux qui l'ont aidé à se décomposer. Les anticommunistes de l'intérieur qui, partout en Europe de l'Est, des primats Hongrois ou Polonais aux syndicalistes de Dantzig en passant par les grévistes de Berlin-Est et les insurgés de Budapest ont préparé le délitement, dans le désespoir apparent. Les anticommunistes de l'extérieur, qui l'ont contenu et l'ont obligé à s'essouffler, de la Corée et Dien Bien Phu à Ronald Reagan et sa guerre des étoiles. Et tous les intellectuels, de Souvarine à Soljenitsyne, en passant par Madiran ou Monnerot, qui ont refusé le sens de l'histoire marxiste quand les compagnons de route justifiaient, illustraient, défendaient l'horreur. Il y a eu, de la fin de la seconde guerre mondiale à Soljenitsyne, trente années de honte et de plomb, durant lesquelles, par peur, par intérêt, l'opinion dominante s'est endormie. L'histoire démotique a feint d'ignorer, malgré les accrocs de Prague et de Budapest, la nature réelle du communisme, que l'on connaissait déjà pourtant depuis les années vingt. Ces amnésies à répétition sont l'une des caractéristiques du système. Ceux qui, aujourd'hui, pérorent sur la chute du mur, sont les mêmes qui ont excusé le système qui l'a construit. Ce ne sont pas les belles consciences de gauche qui ont permis au mur de tomber, ce sont les anticommunistes, les fascistes dont on se moquait ou que l'on vilipendait. Aujourd'hui, grâce à l'échappatoire commode du stalinisme, la dogmatique marxiste reprend du poil de la bête, et ses interprétations léninistes et trotskistes s'insinuent et s'enkistent partout.
Le mythe du crime unique
La question qui se pose est : pourquoi ? Les penseurs ont montré que les communisme était un totalitarisme. Les historiens ont montré que ce fut le plus long et le plus mortel ; ils incluent dans ce constat Lénine et Trotski. Alors pourquoi cette si longue complaisance ? Pourquoi cette collaboration toujours renaissante ? Pourquoi, en un mot, cette préférence communiste ? Pourquoi est-il moins interdit de flirter avec Marie Georges Buffet qu'avec Marine Le Pen ? Pourquoi Honnecker est-il moins méchant que Franco ? Eh bien tout simplement parce qu'on peut réduire les uns ad Hitlerum, et pas les autres. Parce qu'ils ont combattu le mal absolu. Je ne sais pas combien de millions de gens a fait tuer Staline, mais je sais qu'il a vaincu la bête immonde. Je ne sais pas combien de camps contenait l'archipel du Goulag, mais je sais qu'il ne s'est pas perpétré le crime incomparable, la shoah.
Il y a un livre qui vient de sortir, A quoi sert l'histoire ? L'auteur, qui signe Hannibal, se penche sur ce concept de crime incomparable, unique. Non les faits, qu'il n'examine même pas, le révisionnisme n'est pas son problème, mais le mythe du crime unique, qu'on a bâti à partir de différents récits des faits. Il démontre que la morale, la conception du monde, la politique et l'appareil juridique de l'occident, de l' ”Euramérique " en découlent. C'est assez convaincant. Pour vaincre le politiquement correct qui déforme l'histoire à destination du grand nombre afin d'imposer des politiques tyranniques, il convient de refuser le concept de crime unique. L'application qu'on vient d'en lire à la préférence communiste n'en est qu'un exemple.
Martin Peltier , 09/11/2009
Hannibal, A quoi sert l’Histoire ?, Diffusion International Edition, 91 avenue de Clichy 75017 Paris (info@die-livres.com - tel. 01 42 63 45 86 et 06 68 09 09 10), 216 p. 20 €.
http://www.chapitre.com/
http://www.amazon.fr/Les intertitres sont de la rédaction
-
Les grandes "migrations" barbares du Ve siècle
"Une étudiante de classe préparatoire à l’école des Chartes m’apprend qu’un de ses professeurs d’histoire lui enseigne qu’on ne doit plus, selon les directives des maîtres des programmes, nommer « grandes invasions barbares », les arrivées de peuples germaniques et autres sur notre sol au long des siècles du haut Moyen-Âge.
Il faut désormais les désigner comme des « migrations » ; cé ti pas plus gentil comme ça !
Fini donc cette histoire affreuse où l’on enseignait à des petits enfants terrorisés que les Alains, les Allamans, les Burgondes, les Wisigoths et les Ostrogoths, les Huns et les Normands étaient des envahisseurs barbares. Ouf ! Ils n’étaient donc que des peuples « en migration ».
Ainsi en n’utilisant pas le terme « invasion » pour désigner des phénomènes du passé sans doute évitera-t-on de l’utiliser pour désigner des phénomènes actuels. [...]"