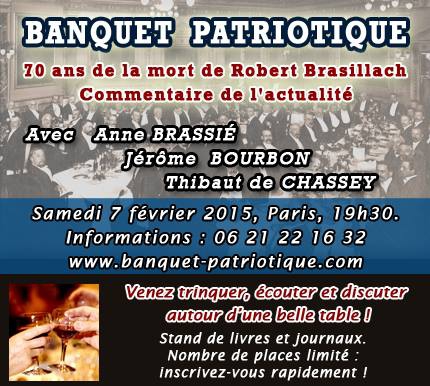L’ingénierie sociale est la modification planifiée, durable et furtive du comportement. Il s’agit de modifier définitivement la nature d’une chose, de manière irréversible, donc pour le long terme, et pas seulement à court terme. C’est ce qui distingue l’ingénierie sociale de la propagande et de la manipulation, dont les impacts sont ponctuels et réversibles.
Les deux concepts de l’ingénierie sociale sont le « hameçonnage » et le « conflit triangulé ». Leur application permet de produire le sentiment qu’un conflit est inévitable, alors qu’en réalité il pourrait très bien s’arrêter ou ne même pas commencer, ceci dans l’optique de naturaliser des structures conflictuelles qui ont été construites de manière artificielle. Il n’est pas excessif de parler ici de piratage de l’esprit et du comportement, comme on parle de pirater un ordinateur. Dans les deux cas, il s’agit de violer discrètement les défenses et l’intégrité d’un système de sécurité afin d’en prendre le contrôle, ni vu ni connu. L’intérêt de cette approche d’ingénierie sociale est de fournir une méthodologie compacte, avec des recettes et des mots-clés, une sorte de kit mental pour pirater tout système quel qu’il soit, c’est-à-dire le violer furtivement en se l’ouvrant par abus de confiance ou en suscitant l’indifférence (hameçonnage), puis le détruire indirectement en faisant monter les contradictions et la méfiance entre les parties, c’est-à-dire en instaurant un conflit triangulé.
Approche polémologique de la question identitaire
L’idée d’une ingénierie possible du conflit identitaire s’inscrit dans le cadre de la polémologie, ou science de la guerre, discipline fondée par le sociologue Gaston Bouthoul (1896-1980) après la Deuxième Guerre mondiale. Que ce soit en Intelligence économique ou dans le renseignement militaire, la science de la guerre se consacre à la modélisation des conflits, et en particulier des facteurs sources de conflits, ou facteurs polémogènes et dissolvants. C’est précisément à ce niveau que se situe notre étude, un peu en amont du conflit proprement dit, puisqu’il s’agit de modéliser la production stratégique de conflit. Modéliser l’action de « dissoudre pour régner ».
La méthode classique pour garder le contrôle d’un groupe consiste à augmenter la visibilité de ses différences internes, souligner ses contradictions, de sorte à amplifier ses clivages latents et à paralyser son organisation. Vieille comme le monde, appliquée par les Romains contre les tribus gauloises ou de nos jours dans ce qui s’appelle la « doctrine Kitson », cette méthode est plus que jamais d’actualité, à l’heure où des « minorités agissantes », services spéciaux d’État ou organisations diverses, travaillent à élaborer en France, en Syrie, en Irak, en Ukraine, des tensions diverses à visées dissolvantes (coups d’État, guerres, terrorisme, communautarismes) en jouant la carte des « identités ». Du point de vue identitaire, les identités ethniques ou culturelles sont considérées comme un référentiel authentique, une terre dans laquelle s’enraciner en toute confiance car elle ne ment jamais. Mais à y regarder de plus près, on voit que les identités, même les plus traditionnelles et enracinées, n’échappent pas aux manipulations et qu’il est possible, en appliquant certaines techniques, de les faire mentir après les avoir littéralement « piratées ».
La thèse ici défendue est que la production de conflit s’appuie sur l’exacerbation des rivalités identitaires. Le concept de « rivalité identitaire » est largement inspiré de celui de « rivalité mimétique » que René Girard, anthropologue et membre de l’Académie française, a mis à l’honneur. La nuance apportée par un autre adjectif sert simplement à préciser que toute rivalité mimétique est en fait une rivalité mimétique identitaire, en ce que le phénomène de la rivalité mobilise les processus d’identification des rivaux. En outre, nous souhaiterions faire fonctionner ce concept dans un champ un peu différent de celui de Girard. Trois catégories de personnes s’intéressent à la question identitaire :
1) les militants de l’identité, individus et groupes politiques ou associatifs,
2) les analystes de l’identité, chercheurs en sciences humaines, sociales et cognitives,
3) les ingénieurs de l’identité, dans le « consulting » et le renseignement politique, commercial ou militaire (guerre psychologique).
Ce que les analystes décrivent objectivement mais sans y toucher, les consultants n’hésitent pas à le pirater, pour le retravailler et le reconfigurer dans une optique stratégique de management des perceptions afin d’influencer les militants au moyen d’opérations psychologiques. Ainsi, ce que René Girard décrit comme une structure anthropologique universelle peut également faire l’objet d’un façonnage et d’une instrumentalisation à des fins d’ingénierie sociale. Voyons maintenant ce qu’est une rivalité identitaire et comment elle peut être utilisée en termes de production stratégique de conflit.
Distinguer les bonnes et les mauvaises raisons de se battre
Qui dit polémologie, dit approche scientifique du conflit. Dans l’histoire humaine, les épisodes de conflits à analyser sont innombrables. Il semble que le fait de se battre à intervalle régulier soit inévitable. Cependant, avec le recul, il est évident que certains conflits auraient pu, malgré tout, être évités facilement. De fait, il y a des bonnes raisons de se battre, mais il y a aussi des mauvaises raisons de se battre. Comment distinguer ces bonnes et ces mauvaises raisons de se battre ? En déployant une approche scientifique et rationnelle du conflit, et en quittant les approches passionnelles et émotionnelles où tout se confond. La méthode scientifique consiste 1) à recueillir des faits objectifs et 2) à proposer des modèles (ou modélisations), c’est-à-dire des représentations schématiques et hypothétiques de la façon dont les faits objectifs sont liés entre eux par la causalité, ou relation de cause à effet. Ce sont là les deux temps, pratique et théorique, de l’activité scientifique. Les bonnes raisons de se battre sont « naturelles » et n’ont pas été orchestrées de manière triangulée. Tous les acteurs du conflit sont visibles et se ramènent généralement à deux camps. À l’opposé, les mauvaises raisons de se battre sont triangulées, c’est-à-dire provoquées artificiellement puis « naturalisées » au moyen du hameçonnage. Les acteurs du conflit sont trois, mais seuls deux apparaissent. Dans une perspective irénique et pacifiste mais non utopiste, il est possible de travailler à cerner et isoler les mauvaises raisons de se battre, de sorte à ne pas en être dupe, à réduire leur impact destructeur et à se concentrer sur les bonnes raisons de se battre. Il s’agira de répondre à la question schmittienne : qui est mon véritable ennemi, celui que je dois dissoudre, et qui sont mes vrais amis et mes vrais alliés, avec lesquels coaguler ? L’allié n’est pas l’ami, mais, par définition, nous pouvons nous allier avec lui contre un ennemi commun.
La rivalité mimétique identitaire
La première question qui se pose à l’ingénierie du conflit triangulé est : comment créer un conflit à partir de rien ? Comment amorcer un conflit sans raisons ? Comment mettre en place un conflit qui n’a pas de raisons objectives de se produire, c’est-à-dire qui n’a pas de « bonnes raisons » de se produire ? Pour répondre à cette question, analysons le phénomène des « mauvaises raisons de se battre ». Décrivons comment implémenter une rivalité mimétique identitaire pour lancer artificiellement une mécanique conflictuelle, puis la naturaliser et l’automatiser dans la mesure du possible.
La notion de rivalité mimétique chez René Girard définit un mode de construction identitaire culminant dans l’affirmation volontariste de sa supériorité sur autrui. Un objet convoité en commun donne naissance à une compétition qui fait passer l’objet au second plan, derrière une rivalité de prestige entre deux sujets, deux egos. Girard dit ceci dans Des choses cachées depuis la fondation du monde :
« Dans l’univers radicalement concurrentiel des doubles, il n’y a pas de rapports neutres. Il n’y a que des dominants et des dominés, (…) Le rapport à l’autre ressemble à une balançoire où l’un des joueurs est au plus haut quand l’autre est au plus bas, et réciproquement. » (Grasset, 1978, p. 406)
Dans la plupart des cas, l’affirmation volontariste de soi provoque chez autrui une réponse en miroir de sa propre supériorité. Un mécanisme automatique de revendication narcissique croissante se met alors en place, concurrence induisant une montée aux extrêmes qui aboutit logiquement au conflit et à l’affaiblissement des deux parties engagées dans la rivalité. Sur ce sujet, on se reportera aussi à la théorie des jeux et aux phénomènes d’escalade schismogénétique étudiés par l’anthropologue Gregory Bateson, dont la course aux armements est une illustration pratique.
La rivalité mimétique est la structure générale de tout conflit proprement humain, quand on passe d’un conflit autour d’un objet à un conflit entre sujets, donc à un conflit intersubjectif et psychologique. Ce que je pense d’autrui, et ce que je pense qu’il pense, territoire purement mental que les sciences cognitives appellent la « théorie de l’esprit », prend le pas sur l’observation objective des faits. Quand il n’y a pas de raisons objectives de se battre dans le présent, on peut donc mettre en scène des raisons subjectives dans le champ des représentations, en allant les chercher dans le passé pour ranimer des souvenirs polémogènes (tel pays a attaqué tel autre au siècle dernier), ou dans le futur, en évoquant les risques à venir (attaque préventive sur la base de suppositions), ou encore, troisième option, dans une métaphysique exaltante jouant un rôle de psychotrope.
Les mauvaises raisons de se battre, scénarisées par un « storytelling » polémogène, naissent donc dans un champ purement représentatif, mental, égotiste, subjectif et narcissique, lié à l’image de soi et d’autrui, c’est-à-dire au sentiment de sa propre identité et de celle des autres. Malheureusement, de ce creuset originel purement psychologique peuvent néanmoins émerger des conséquences tout à fait concrètes et physiques. En effet, toutes les espèces vivantes peuvent être blessées physiquement, mais une seule, la nôtre, peut en plus être blessée psychologiquement au point d’entrer dans un processus concret de vengeance pour rétablir l’estime et l’intégrité de son identité, faisant déborder le conflit du champ subjectif pour être amenée à frapper physiquement et dans le réel. En effet, quand les lésions psychologiques et identitaires sont profondes, elles se traduisent par un sentiment dépressif d’humiliation qui peut pousser à un « passage à l’acte » physique : comportement de réparation, de revanche, de vengeance, de vendetta, induisant une montée de violence obéissant à la « loi du talion » et qui fait passer le conflit de l’état psychique et subjectif à l’état physique et matériel. Faire passer la violence des mots aux actes, c’est tout le travail de l’ingénierie sociale.
Orchestrer la rivalité
Cette tendance humaine au conflit identitaire peut être cultivée, stimulée, amplifiée et manipulée. En effet, la rivalité mimétique est la structure principielle de toutes les situations dans lesquelles une tierce personne doit faire entrer deux autres qu’il souhaite voir s’entredéchirer. Dans le cadre d’une ingénierie polémogénétique triangulée, l’automatisation d’un cycle comportemental conflictuel en crescendo constant doit veiller à installer des cliquets d’irréversibilité pour jalonner et stimuler la montée aux extrêmes, de sorte qu’on ne puisse plus jamais revenir en arrière pour la pacifier. L’embrayage de ce mouvement perpétuel a souvent besoin de ce que le Renseignement appelle une « opération psychologique », en l’occurrence l’orchestration méthodique d’un préjudice profond, une blessure traumatique fondatrice dont on entretiendra la mémoire (rôle du slogan « Ni oubli, ni pardon »), et qui sera ainsi utilisée pour alimenter une soif de vengeance infinie, moteurs par excellence de la rivalité mimétique (récupération politique de la Shoah, affaire Clément Méric, attentats terroristes divers, etc.).
Une rivalité mimétique apparaît toujours à première vue sous la forme d’une structure duelle. Comme on dit : dans tout conflit, à la fin, on est deux. Considérons deux sujets qui n’ont pas de raison objective de se battre : ils peuvent néanmoins se trouver entraînés dans une rivalité mimétique conflictuelle pour de mauvaises raisons, purement mentales, qui seront cristallisées dans le champ intersubjectif des représentations (images et mots) par un troisième acteur ayant intérêt à affaiblir ces deux premiers sujets. Il est parfois difficile de démêler les raisons objectives et subjectives des conflits. L’humain vit autant dans le monde objectif des faits que dans celui des représentations et des images de soi et d’autrui. Néanmoins, la partie proprement identitaire, intersubjective et psychologique, des conflits ne se dramatise et ne se déploie que dans le champ des représentations, donc du langage et des images. À ce titre, ce versant identitaire des conflits est grandement susceptible d’une manipulation médiatique, faisant passer l’objet réel derrière sa représentation langagière et iconique falsifiée.
Exemple : il se peut que l’Islam soit incompatible avec l’Occident, comme le soutiennent les partisans du « choc des civilisations ». C’est une hypothèse à tester, comme toutes les hypothèses. Mais pour que le test soit neutre et objectif, il faut déjà se débarrasser de toutes les images et représentations associées à cette religion par les médias depuis le lancement de la théorie du complot islamiste, le 11 septembre 2001. Pour discuter sérieusement de l’Islam en Occident, il faut donc revenir au minimum aux conditions du 10 septembre 2001, c’est-à-dire oublier volontairement tout ce qui s’est produit depuis cette date en termes de terrorisme d’État, faits divers truqués et attentats sous faux drapeau (opérations false flags) : 11 Septembre, Madrid, Londres, Toulouse, Boston, Bruxelles, État islamique, Charlie Hebdo, etc. Après ce travail de décapage, de nettoyage et de déconstruction de la gangue d’images médiatiques, l’objet réel apparaît et on peut l’appréhender scientifiquement, mais pas avant. Lutter contre l’Islam pour les raisons invoquées depuis le 11 Septembre (fanatisme, terrorisme, incompatibilité culturelle absolue, etc.) relève donc d’une rivalité mimétique orchestrée, c’est-à-dire un duel identitaire mis en scène par les médias au moyen d’images et de mots-clés. Ce conditionnement pavlovien polémogène, comme on dresse des chiens ou des coqs de combat à se battre entre eux sans raison objective, s’appuie donc sur de mauvaises raisons. Évidemment, ceci n’exclut pas qu’il existe de bonnes raisons de lutter contre l’islamisation, mais ces raisons objectives sont à définir en toute indépendance vis-à-vis du discours médiatique et des représentations qu’il diffuse dans l’opinion publique.
Rappelons pour mémoire ce que notait un rapport militaire états-unien de la School of Advanced Military Studies (SAMS), commenté dans leWashington Times du 10 septembre 2001 :
« Les officiers de la SAMS ont dit à propos du Mossad, le service de renseignement israélien : “Joker. Sans pitié et rusé. A la capacité de prendre pour cible des forces américaines et de faire croire à une action palestinienne/arabe.” »1
Le site Wikistrike, de son côté, titrait de manière laconique le 11 septembre 2011 : « Al-Qaïda a ciblé en dix ans le monde entier sauf Israël. »
Conflits à deux ou triangulés
La propagande de guerre consiste toujours à construire une image infâmante et polémogène de l’ennemi. En cette année de commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, rappelons comment les médias de la Belle Époque, essentiellement les journaux imprimés, fabriquèrent sur plusieurs années une opinion publique favorable au conflit à venir en diffusant dans leurs colonnes des articles de presse mensongers et des dessins caricaturaux déformants, de sorte à précipiter les peuples les uns contre les autres. Nous sommes ici dans le domaine du management des perceptions, qui vient s’intercaler entre l’objet réel et le sujet percevant. Ma perception d’un objet, ou d’un autre sujet (autre pays, autre religion, autre identité), peut être altérée et modifiée par une tierce personne, un troisième sujet qui n’apparaît pas à première vue. Il existe donc une géométrie du conflit. Il y a au moins deux types de forme géométrique des conflits : duelle ou triangulée. Dans la structure duelle, deux acteurs s’affrontent en face à face. Le conflit advient « naturellement », par la rencontre problématique mais directe et sans médiateur de deux acteurs. À l’opposé, dans la structure triangulée, deux acteurs s’affrontent sous le regard d’un troisième. Le duel entre les deux acteurs situés à la base du triangle est supervisé, tutoré et influencé par le troisième acteur qui occupe le sommet du triangle. Ici, les problèmes sont orchestrés.
Un conflit peut donc être « médiatisé », au sens étymologique, c’est-à-dire entretenu par un média, ou un médium, occupant une position intermédiaire entre les deux belligérants. L’Analyse transactionnelle propose le modèle du « triangle dramatique », ou triangle de Karpman, qui met en place une structure relationnelle entre trois rôles : la victime, le persécuteur et le sauveur. Il semble bien que la majorité des conflits qui ensanglantent la planète se trouvent ainsi triangulés. Autrement dit, pratiquement tous les conflits sont des artefacts, mis en scène, élaborés, façonnés, construits dans le cadre d’une véritable ingénierie stratégique de la tension intentionnelle. Pourquoi est-il aussi difficile de s’en rendre compte ? Parce qu’il manque à la plupart des observateurs une grille de lecture, celle du Renseignement. Un chercheur comme Bernard Lugan, par exemple, est une vraie mine d’informations factuelles sur les conflits ethniques qui traversent le continent africain, mais il applique rarement la grille de lecture du Renseignement. Conséquence : il manque souvent un élément dans sa description, le troisième élément, le sommet du triangle. Quand on le lit, on a l’impression que les tensions ethniques intra-africaines adviennent toutes seules, directement, par la rencontre polémique des acteurs en conflit. Le sommet du triangle, l’ingénieur du conflit, son chef d’orchestre, n’est pas décrit. L’application de la grille de lecture du Renseignement à ces conflits ethniques permet de révéler que dans la majorité des cas, ces conflits identitaires sont supervisés, entretenus, provoqués, tutorés par un acteur extérieur, le plus souvent occidental, à des fins coloniales et impérialistes. Cette action extérieure, cette ingérence étrangère, ne provient évidemment pas des peuples occidentaux, qui n’y sont pour rien, mais résulte de la convergence d’intérêts entre mafias financières, lobbies industriels, ONG diverses et services spéciaux occidentaux tels que la CIA, le MI6, le Mossad, la DGSE…
Or, ce qui s’applique avec succès en Afrique sub-saharienne ou dans le monde arabo-musulman est appliqué également en France. Des représentations polémogènes destinées à construire la rivalité mimétique identitaire de deux groupes sociologiques sont diffusées dans les médias par un troisième groupe sociologique. À titre d’exemple, on se rappellera le Rav Ron Chaya et sa parabole talmudique du petit coq juif qui doit pousser les gros coqs chrétien et musulman à s’entretuer s’il veut prospérer (dans la lignée des théoriciens du suprémacisme racial juif tels que Yitzhak Shapiro, Yaakov Yosef et Ovadia Yossef). Une application pratique en fut donnée pendant les émeutes de banlieue de 2005 qui ont secoué la France plusieurs semaines durant. Des sources personnelles confirmées par d’autres reproduites en annexes ont attesté de la présence parmi les casseurs d’individus agitateurs liés à Israël et au Mossad. La narration médiatique officielle de cette page de l’histoire de France rapporte un conflit duel entre des Français de souche terrorisés, repliés derrière les forces de l’ordre, et des délinquants fous furieux issus de l’immigration africaine et musulmane. Le troisième acteur de la situation, en l’occurrence l’agent provocateur professionnel, reste ignoré et n’apparaît qu’à la condition d’appliquer la grille de lecture du Renseignement. Cette structure triangulée se rencontre également dans le marché des produits halal en France, dont l’expansion incontestable repose entre les mains d’individus et d’entreprises pourtant non musulmans ; d’où la nécessité de toujours poser la question des éléments non musulmans à l’œuvre dans les processus d’islamisation si l’on veut vraiment comprendre leur fonction. On retrouve encore ce trinôme dans la fausse opposition politique entre la Droite et la Gauche, entretenue artificiellement par le sommet du triangle pour empêcher la jonction des forces populistes françaises dans un front commun, le fameux processus de coagulation que le Pouvoir passe son temps à dissoudre continuellement. Le clivage Droite/Gauche doit être dénoncé pour ce qu’il est, l’attrape-nigaud par excellence de la triangulation républicaine, un simple hameçon d’ingénierie sociale.
Dans la plupart des conflits, nous ne sommes donc pas deux, nous sommes trois. Quand on se trouve engagé dans un rapport de forces avec un autre sujet, il faut toujours se demander « qui » nous y a engagés, afin de reconstituer le « triangle de la rivalité », retrouver les trois acteurs de la rivalité mimétique, du rapport de forces. Il y en a deux qui sont évidents, mais le troisième l’est moins. Cela est normal. L’efficacité du conflit triangulé repose sur une condition sine qua non : il ne doit pas être perçu comme tel, comme mobilisant trois sujets, mais il doit être perçu comme un duel. La base ne doit en aucun cas percevoir le sommet. Ou alors, si elle le perçoit, elle ne doit pas le comprendre.
Comment devenir invisible ?
Le piratage est l’art de la furtivité, donc de l’invisibilité. Comment s’y prend le sommet « pirate » du triangle pour que son rôle d’instigateur du conflit reste incompris et inaperçu de la base ? L’efficacité de la triangulation vient de ce que les deux sujets de la base se perçoivent mutuellement comme des ennemis, donc se méfient l’un de l’autre, mais ne perçoivent pas le sommet comme un ennemi, donc lui font confiance, ou au moins ne s’en méfient pas, lui restent indifférents. D’après le célèbre pirate informatique Kevin Mitnick, l’ingénierie sociale est L’Art de la supercherie et consiste essentiellement à jouer sur la crédulité et la confiance d’autrui pour modifier son comportement, principe du « hameçonnage » (phishing). En étant perçu dans la confiance ou dans l’indifférence, le sommet hameçonneur peut se permettre d’être perçu, mais il ne sera pas compris comme architecte du conflit. C’est une application de la technique dite « cacher en pleine lumière », « l’art royal » dont se servent les prestidigitateurs et les illusionnistes, ainsi que les sociétés ésotériques et les services secrets. Se montrer en partie, pour gagner la confiance et donner le sentiment qu’il n’y a rien à creuser : « Ah, ce n’est que ça ? Circulez, y’a rien à voir. » En revanche, dès que les deux acteurs en conflit et occupant la base du triangle perdent confiance dans le troisième qui est au sommet, on sort du duel pour entrer dans un triangle conflictuel. Le rôle du sommet est perçu et compris en tant qu’ingénieur du conflit, on sort donc de la rivalité mimétique qui est une structure duelle ; les mauvaises raisons du conflit, celles orchestrées par le sommet, s’évaporent.
Pour parvenir à ses fins, le sommet hameçonneur, qui n’est jamais totalement invisible, doit néanmoins empêcher le regard de la base de rester focalisé sur lui. Le sommet pirate sait qu’il sera vu plus ou moins, mais doit empêcher l’attention de la base de rester concentrée sur lui. Il doit donc réussir à diffracter la focalisation de l’attention de la base. Comment ? En multipliant les leurres, les diversions, les fausses pistes, ou en prenant le contrôle des rapports de confiance. La maîtrise des relations de confiance et de méfiance est la clé de l’ingénierie sociale. Si je suis ingénieur social, mon travail pour occuper le sommet de la pyramide consistera à produire de la méfiance entre vous et de la confiance à mon égard, ou au moins de l’absence de méfiance, soit de l’indifférence. Si j’arrive à produire de l’indifférence à mon égard, je dé-focalise votre attention de ma personne et je deviens pratiquement invisible à vos yeux. Le hameçonnage consiste à devenir invisible, ce qui permet par contraste de mieux organiser la visibilité d’autrui en bien ou en mal. Quand on maîtrise la gamme des rapports méfiance/indifférence/confiance, donc quand on a la maîtrise de la focalisation de l’attention d’autrui, on maîtrise la technique d’invisibilité et on devient pratiquement tout-puissant. Dans l’orchestration triangulée d’un conflit, l’obtention de la confiance est ainsi le moment clé du hameçonnage, qui se résume par l’expression « un faux bien pour un vrai mal » : pour les faire avancer, le hameçonneur fait miroiter aux deux hameçonnés une carotte, un conflit présenté comme salutaire, dont chacun croit qu’il sortira grandi et gagnant, et l’ennemi diminué et perdant, alors que l’issue en sera seulement perdant-perdant pour les deux hameçonnés, le seul gagnant étant le hameçonneur.
Conclusion
On croyait qu’on était deux et on se rend compte qu’on était en fait trois : c’est le sentiment qu’ont dû éprouver les Poilus de 14-18 quand ils ont commencé à se mutiner et à fraterniser avec les malheureux soldats prussiens de la tranchée d’en face, découvrant soudainement qu’ils n’avaient aucune bonne raison de se battre et que s’ils s’entretuaient depuis des années, c’était uniquement parce qu’un troisième acteur en lequel ils avaient confiance les avait convaincus de le faire. Et quand ils ont réfléchi sur le sommet du triangle, ces courageux patriotes, totalement manipulés par leurs états-majors respectifs, eux-mêmes manipulés par les médias de l’époque, ont-ils remonté la chaîne causale jusque tout en haut ? Sont-ils allés jusqu’aux banquiers cosmopolites et aux « marchands de canons », ancêtres du complexe militaro-industriel, que Louis-Ferdinand Céline désignait dans ses pamphlets comme étant les vrais responsables du massacre ? Même si à l’époque certains soldats sont parvenus à décrypter individuellement la situation générale et l’identité des vrais fauteurs de guerre, la vérité historique sur ce conflit resta exclue des grands médias et stagna donc au niveau du signal faible. Conséquence : la même structure conflictuelle triangulée, mobilisant à peu près les mêmes acteurs, fut reproduite à l’identique entre 1939 et 1945 – pourquoi changer une formule qui gagne ? – et cette fois-ci, même Céline tomba dans le panneau ! De sorte à ne pas nous laisser piéger à notre tour dans de nouveaux massacres sans raisons objectives et orchestrés en haut lieu, il nous revient d’organiser massivement une force politique collective capable d’élaborer des mesures d’anti-piratage. Notamment, il est indispensable de démocratiser la culture du Renseignement, seul moyen de mettre en relief les divers hameçons et conflits triangulés qui nous sont appliqués en France, au Moyen-Orient, en Ukraine et partout où l’axe Washington/Tel-Aviv s’acharne à provoquer ses guerres, ses coups d’État et ses attentats terroristes.
Annexes
« U.S. troops would enforce peace under Army study » , Rowan Scarborough, The Washington Times, 10/09/2001.
« Israel faked al-Qaeda presence » , BBC, 08/12/2002.
« La vérité, enfin, sur les menées du Mossad ? » , The International Solidarity Movement, 20/03/2004.
« Émeutes des banlieues françaises en novembre 2005 provoquées par le Mossad » , Narkive – Israel francophones.
« Le Mossad derrière les émeutes des banlieues en novembre 2005 » , Union des Patriotes, 04/08/2007.
« Notizbuch » , Deutschland Brief, 07/2007.
« Udo Ulfkotte : le Mossad a alimenté les révoltes dans les banlieues » , La voix de la Russie, 22/10/2014.
« Der Krieg im Dunkeln (Udo Ulfkotte) » , Scriptoblog.
« Dr. Udo Ulfkotte, Wayne Madsen and Israel’s covert program to provoke the Muslim riots in France » , The Daily Sketch, 31/10/2006.
« Wayne Madsen Report » (traductions de l’auteur).
« Le 23 octobre 2006 – WMR a déjà rapporté que le ministre de l’Intérieur français et candidat conservateur aux présidentielles Nicolas Sarkozy avait lancé des manœuvres de “guerre psychologique” en excitant la violence parmi les musulmans, essentiellement des gangs de la jeunesse nord-africaine à Paris et dans ses banlieues, pour convaincre le public français qu’il y a une “menace musulmane”. Nous pouvons maintenant rapporter que selon nos sources dans le Renseignement français, le programme est relié à des fonds de financement “hors bilan”. Le ministre de l’Intérieur entretient ce qui est connu comme une “boîte noire” de fonds recueillis de la confiscation d’actifs français anti-narcotiques, contrebande, et d’autres activités illicites. Ces fonds non comptabilisés ont “disparu” dans les opérations clandestines de M. Sarkozy pour provoquer des troubles dans la jeunesse musulmane. L’argent est utilisé pour payer des fauteurs de troubles et convaincre des gangs de la rue d’attaquer les voitures de police, les bâtiments, les transports publics et en général exciter la violence. Hier, des provocateurs ont arrêté un bus à Grigny, dans l’Essonne, en banlieue de Paris. Dans ce que la police a appelé une attaque bien planifiée, les passagers ont été forcés de descendre du bus et deux jeunes l’ont ensuite embrasé avec du pétrole. Les flammes se sont étendues à quatre voitures garées. L’incident fait écho à des attaques précédentes planifiées contre la police ou des cibles civiles.
En plus des opérations de boîte noire, le Renseignement français a confirmé que les forces de renseignement intérieur de M. Sarkozy ont reçu ordre par le ministre de l’Intérieur de placer la candidate socialiste aux présidentielles Ségolène Royal sous surveillance électronique et physique totale. » [source ]
« Le 25 octobre 2006 – Un nouveau livre en Allemagne met en lumière le programme clandestin d’Israël de provocation de violence chez les musulmans en Europe de l’Ouest et d’engagement dans des opérations “faux drapeau” dans le but pour les gouvernements occidentaux de blâmer l’Islam radical. Le livre, Der Krieg im Dunkeln (La guerre de l’ombre) par Udo Ulfkotte, un ancien correspondant du Frankfurter Allgemeine Zeitung, fournit les détails d’opérations de deux unités du Renseignement israélien – la Metsada, spécialisée dans le sabotage, incluant les attaques terroristes “faux drapeau” et les assassinats ; et le LAP (Lohamah Psichlogit), qui est engagé dans la guerre psychologique.
Le précédent livre de Ulfkotte sur l’extrémisme islamiste, titré The War In Our Cities (La guerre dans nos villes), a été retiré du marché allemand à cause de “pressions légales massives de plaignants islamiques”.
Ulfkotte affirme que des agents de renseignement britanniques et allemands ont rencontré des agents de la Metsada et du LAP en France provoquant des violences pendant les émeutes de novembre 2005, dont les extrémistes islamistes furent accusés. WMR a également rapporté que le ministre de l’Intérieur et candidat aux présidentielles Nicolas Sarkozy, soutenu en France par les factions favorables à la Droite israélienne (Likoud/Netanyahou/Olmert), a coordonné et continue de coordonner le paiement d’agents provocateurs de violence dans les banlieues à prédominance musulmane de Paris et d’autres villes.
Les émeutes de novembre 2005 se sont étendues de Paris à Rouen, Lille, Nice, Dijon, Strasbourg, Marseilles (où la Branche C du Mossad, également responsable pour Paris et Londres, entretient une importante cellule), Bordeaux, Rennes, Pau, Orléans, Toulouse, Lyon, Roubaix, Avignon, Saint-Dizier, Drancy, Evreux, Nantes, Dunkerque, Montpellier, Valenciennes, Cannes, et Tourcoing.
Ulfkotte cite aussi une source du MI6 britannique attestant que le but d’Israël est de façonner une image des musulmans comme étant des menaces imprévisibles qui ne peuvent pas être intégrées dans la société occidentale.
Pendant ce temps, des sources du Renseignement états-unien rapportent un effort continuel du Renseignement israélien pour lancer des opérations sous faux drapeau aux États-Unis. En plus des nationaux israéliens et des binationaux américano-israéliens attrapés pendant qu’ils examinent des tunnels, ponts, bases militaires, hauts bâtiments, agences gouvernementales, maisons privées d’agents de la loi, aéroports, usines pétrolières et chimiques, et autres cibles potentielles, des nationaux israéliens sont également attrapés pendant qu’ils mettent sur pied d’autres tactiques de panique et de terreur. Il y a eu également une infiltration sans précédent d’agents du Mossad dans les postes sensibles et de haut niveau du département de la Défense, de la CIA, de la Sécurité intérieure, du FBI, et d’autres agences, qui toutes continuent de reconnaître officiellement Israël comme une nation au “Renseignement hostile”.
Lundi, Yechezkel Wells, un garçon de 21 ans, binational américano-israélien, a plaidé coupable pour avoir téléphoné une fausse alerte à la bombe le 26 août aux Services de secours de l’aéroport de Long Beach (Californie) depuis une cabine téléphonique. Wells a affirmé qu’il avait passé cet appel parce qu’il était en retard pour son vol et qu’il espérait ainsi retenir l’avion de décoller. Wells a dit qu’il y avait une bombe dans le vol Jet Blue de Long Beach à Fort Lauderdale, en Floride. Le vol Blue Jet a été retardé d’une heure.
On ne sait pas grand-chose sur Wells. Il affirme être étudiant mais il n’y a aucune information sur sa scolarisation. Wells a plaidé coupable pour le simple délit de fausse information sur une menace visant un aéronef. La sentence est prévue pour le 29 janvier 2007 et Wells encourt au maximum cinq ans de prison ou de probation. Si le passé sert de leçon, on peut s’attendre à ce que l’administration Bush accepte la probation en échange d’une expulsion de Wells en Israël, où des milliers d’autres agents comme lui du Mossad, de la Metsada, du LAP attrapés en train d’élaborer des opérations psychologiques ou de terrorisme sous faux drapeau aux États-Unis avant, pendant et après les attaques du 11 Septembre, peuvent continuer à exercer leurs travaux en tromperies. » [source ]
« Le 26 octobre 2006 – WMR a reçu un témoignage oculaire des opérations du ministre de l’Intérieur français Nicolas Sarkozy pour provoquer des violences dans les banlieues parisiennes. Sarkozy est en lice pour les élections présidentielles de l’an prochain. Le 25 septembre, un convoi de la police a utilisé le Quai des Célestins sur la rive droite de la Seine comme zone d’entraînement pour un assaut dans la banlieue des Tarterêts dans le but de “bousculer” les habitants. Plusieurs centaines de policiers ont été recrutés pour l’attaque. Il y eut seulement quelques arrestations pour ce qui s’avère être une opération de guerre psychologique (voir le reportage d’hier sur la responsabilité du LAP d’Israël dans les émeutes en France).
L’assaut planifié de la police était en représailles d’une attaque contre deux policiers aux Tarterêts. WMR a appris de sources dans le Renseignement français que l’agression des policiers était également orchestrée par Sarkozy et ses soutiens qui ont totalement infiltré le service de renseignement intérieur, la DST, et se trouvent maintenant en nombre croissant à la DGSE, le service de renseignement extérieur. » [source ]
« 10/11/12 novembre 2006 – WMR a obtenu un courriel crypté envoyé par le Renseignement états-unien à un officiel du gouvernement français en juillet 2005 mettant en garde contre l’infiltration de groupes immigrés en France par des membres du Renseignement néoconservateur entraînés aux États-Unis pour fomenter des émeutes dans les banlieues parisiennes peuplées d’immigrés musulmans en novembre 2005. WMR a déjà rapporté la responsabilité d’éléments contrôlés par le ministre de l’Intérieur français et candidat aux présidentielles Nicolas Sarkozy dans le déclenchement des émeutes. WMR a également rapporté que des éléments du Mossad issus des unités de guerre non-conventionnelle Metsada et LAP (psyops) étaient engagés dans les émeutes en France, selon les informations présentées dans un nouveau livre en Allemagne. » [source ]
« Le 6 février 2007 – Le candidat de droite aux élections présidentielles en France, Nicolas Sarkozy, a reçu de l’argent du fugitif international américain et pivot de la mafia russo-israélienne Marc Rich, selon des sources françaises. L’argent a été transmis par le biais de la division de blanchiment de la Deutsche Börse basée au Luxembourg à Clearstream. Sarkozy a proclamé son innocence dans l’affaire de corruption et de blanchiment d’argent sale des frégates de Taïwan, accusant le premier ministre français Dominique de Villepin d’être derrière un sale coup politique. Dans tous les cas, en éructant sur son innocence dans le scandale de Taïwan, Sarkozy a diverti l’attention des fonds reçus de la mafia russo-israélienne de Clearstream du compte de la banque Menatep, la banque possédée par le magnat russe emprisonné Mikhail Khodorkovsky. Sarkozy, un néoconservateur coopté pour favoriser une ligne dure envers les Arabes sur le territoire et au plan international, est aussi connu pour avoir reçu des fonds de Marc Rich, basé en Suisse, par le biais des comptes Clearstream de Menatep, avant et après l’effondrement de Menatep en 1998. Menatep a des liens avec un grand nombre de mafieux russo-israéliens, incluant Semyon Mogilevich, considéré comme le plus dangereux parrain de la mafia russo-israélienne dans le monde. L’ancien avocat de Rich, I. Lewis “Scooter” Libby, est en procès à Washington DC pour faux témoignage et obstruction de justice dans le dévoilement d’un officier de la CIA sous couverture. La police fiscale française s’aiguise sur des comptes off-shoresexploités par l’ancien officiel de Yukos Oil et Menatep, Alexei Golubovich, qui était assigné à domicile en Italie avant qu’il ne retourne en Russie. Golubovich a accepté de témoigner contre Khodorkovsky en échange d’un abandon par les procureurs russes des charges pesant contre lui. Dans ce qui pourrait être lié à un scandale de blanchiment d’argent sale, Yuri Golubev, un cofondateur de Yukos, est mort à Londres le mois dernier dans des circonstances que les procureurs russes estiment suspectes. En décembre, WMR avait rapporté, “Sarkozy a été accusé de recevoir des fonds illégaux par des comptes en banque douteux au Luxembourg et certains de ces fonds ont des empreintes digitales de la mafia russo-israélienne partout.” Sarkozy est dans une lutte serrée avec la candidate du Parti socialiste française Ségolène Royal. Une véritable infection de scandales d’argent et de corruption continue de s’accrocher à Sarkozy. » [source ]
« Le 10 mai 2007 – La purge néoconservatrice des services de renseignement français commence.
Seulement quelques jours après l’élection du néoconservateur Nicolas Sarkozy comme président de la France, la purge néoconservatrice attendue des membres anti-sarkozistes du Renseignement français et des services de sécurité a commencé. Le capitaine Thierry Tintoni des Renseignements généraux (RG) a été mis en doute par un tribunal secret pour violation de lois du secret. Tintoni est accusé d’avoir fourni à la candidate battue du Parti socialiste Ségolène Royal des informations sensibles sur la conduite de Sarkozy quand il était ministre de l’Intérieur. Les services de renseignement français vont maintenant subir les mêmes purges que les purges néoconservatrices similaires qui arrivèrent aux services de renseignement états-uniens, britanniques, australiens, danois et italiens.
Les sources françaises du WMR disent que les services de renseignement français, incluant la DGSE et la DST, s’attendent à une purge stalinienne par les forces de Sarkozy. Les cibles attendues incluent des agents suspectés d’être trop proches des socialistes et ceux considérés trop pro-arabes. L’équipe de Sarkozy va aussi cibler ces agents qui, par les télécommunications interceptées de Sarkozy et de ses associés et officiels d’organisations clés américaines et néoconservatrices, incluant l’American Enterprise Institute et l’American Jewish Committee, sont devenus conscients de la politique étrangère secrète de Sarkozy et de ses canaux de financement de campagne. Sarkozy a pris avec les néoconservateurs américains des engagements en politique étrangère qui sont en opposition tranchée avec les politiques du président sortant Jacques Chirac et de son premier ministre Dominique de Villepin. » [source ]
Lucien Cerise.
Notes
1Of the Mossad, the Israeli intelligence service, the SAMS officers say : "Wildcard. Ruthless and cunning. Has capability to target U.S. forces and make it look like a Palestinian/Arab act."
http://www.scriptoblog.com/index.php/blog/politique/1635-ingenierie-sociale-du-conflit-identitaire-par-lucien-cerise