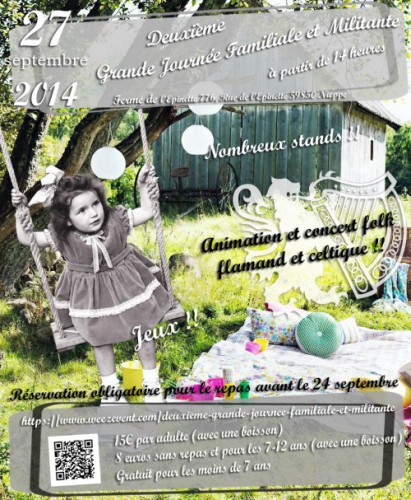Propos recueillis par Monika Berchvok
Que recouvre le terme de "révolution conservatrice" ? Quelles sont les origines de cette école de pensée ?
Ce terme, à mon sens, revêt une triple signification : il inclut 1) les prolégomènes de cette pensée organique et vitaliste qui se déploient dans une Allemagne et une Europe en pleine ascension, entre 1870-1880 et 1914; 2) elle est aussi une réaction, diverse en ses expressions, de l'Allemagne et de l'Europe après l'effondrement moral et physique dû à la première guerre mondiale; tout en étant un vœu de revenir à une excellence culturelle, partagée mais perdue; 3) elle est la résultante de la nietzschéanisation esthétique de la culture européenne, repérable dans tous les pays de notre sous-continent. Les origines de ce phénomène, divers et prolixe, se repèrent certes dans cette culture partagée, empreinte de nietzchéisme, mais elle a aussi des origines plus anciennes : les "autres lumières", celles qui dérivent de Herder et non pas d'un Aufklärung figé, rationaliste, qui donnera les idées de 1789 et les principes rigides de gouvernement à la jacobine; du romantisme, de la contre-révolution, de l'anti-modernité et de l'anti-bourgeoisisme français repérable dans la sociologie de Bonald ou dans les œuvres poétiques et littéraires de Baudelaire et de Balzac.
Quels furent les courants idéologiques qui l'ont traversée ?
Le 20ème siècle a été idéologique et notre après-guerre, depuis 1945, est marqué par les polarisations idéologiques de la Guerre Froide où l'on s'affirmait de "gauche" (communiste ou socialiste), libéral ou démocrate-chrétien. Ces distinctions ne sont pas vraiment de mise quand on observe les prolégomènes de la révolution conservatrice et ses expressions résolument anti-bourgeoises après 1918. Le socialisme d'avant 1914, dans l'espace intellectuel germanophone, est plus proche de ce nous pourrions définir comme "conservateur/révolutionnaire" que de la gauche actuelle : en effet, il est marqué par Schopenhauer et par Nietzsche plutôt que par Marx et par Engels. La rigidification idéologique des gauches est un phénomène qui date seulement des quelques petites années qui ont précédé la Grande Guerre. Après 1918, même la droite des diplomates, des entrepreneurs et des aristocrates admet un communisme pourvu qu'il soit national et permette une alliance tactique avec la nouvelle URSS, afin d'échapper au blocus que les alliés occidentaux imposent à l'Allemagne vaincue. Selon la définition de Destutt de Tracy, début du 19ème siècle, sous Napoléon, une idéologie est toujours une "construction" mentale, une "fabrication" (Joseph de Maistre) et non pas une expression de la vie, qui, en tant que telle, échappe à toute définition figée puisqu'elle se modifie en permanence en tant qu'organisme vivant. Armin Mohler, qui a forgé le terme de "révolution conservatrice" tel qu'il nous interpelle aujourd'hui, distingue six courants idéologiques. C'est évidemment une classification universitaire. Il le savait. D'autant plus que dans la définition d'une "bonne politique" au sens de la révolution conservatrice, des hommes de gauche de la première décennie du 20ème siècle, comme le social-démocrate belgo-allemand Roberto Michels, vont critiquer le fonctionnement des démocraties partitocratiques en démontrant qu'elles se figent, se "bonzifient" et s'oligarchisent en perdant leur tonus nietzschéen, populaire et vital. Les déçus socialistes face à la dé-nietzschéanisation de la sociale démocratie allemande se retrouveront dans le camp fasciste en Italie (avec Michels) ou parmi les critiques "révolutionnaires/conservateurs" du fonctionnement partitocratique du système républicain de Weimar. Niekisch, lui, venait du communisme qui, comme Michels mais sous d'autres formes, refusait les "accommodements" des sociaux-démocrates. D'autres, comme les frères Jünger, seront totalement apolitiques ou viendront des ligues de la jeunesse contestatrices mais patriotes: ils refuseront toutefois, après 1918, un "système" dominé par des instances où, justement, l'oligarchisation et la bonzification, dénoncées par Michels, transformaient la société allemande (comme ailleurs en Europe) en un magma dominé par un éventail réduit, inamovible, de ritournelles idéologiques et partisanes, incapables d'apporter du neuf ou de résoudre les problèmes véritablement politiques de toute politie. Rien n'a changé, le festivisme des gay prides servant dorénavant d'addenda écoeurants à un fatras sans âme ni force.
La figure fascinante de Moeller van den Bruck incarne l'excellence de la "révolution conservatrice". Pouvez-vous revenir sur son parcours ?
L'itinéraire d'Arthur Moeller van den Bruck est effectivement fascinant: il résume toutes les interrogations de la Belle Epoque, apogée de la culture européenne avant la catastrophe de 1914. A vingt ans, en 1896, il débarque à Berlin avec sa jeune épouse, Hedda Maase. Il fréquentera les clubs littéraires les plus en vue et, modeste, il amorcera, avec Hedda, une carrière de traducteur d'œuvres littéraires et poétiques essentielles. Berlin sera sa période française et anglaise: il traduira notamment Baudelaire, avec son esthétisme anti-bourgeois, Barbey d'Aurevilly, avec sa fougue catholique et Edgar Allan Poe, que Baudelaire avait déjà traduit en français. En 1902, il débarque à Paris où il rencontre sa deuxième épouse, Lucie Kaerrick, une Germano-Balte, sujette du Tsar Nicolas II. Avec elle, il deviendra l'insigne traducteur de Dostoïevski, dont les éditions en langue allemande se succéderont jusque dans les années 60. A Berlin, il était un dandy apolitique, à Paris sa conscience politique s'éveille, non seulement grâce à l'hyperpolitisation des Français, qui ne rêvent que de revanche, mais aussi et surtout grâce à la fréquentation de Dmitri Merejkovski, écrivain russe en rébellion contre les figements de l'Empire tsariste et de l'orthodoxie du Saint-Synode, parce que ces forces, qui structurent alors la Russie, étouffent les élans religieux et mystiques. L'orthodoxie figée est aussi un avatar de l'occidentalisation de la Russie depuis Pierre le Grand: Merejkovski est donc hostile à Nicolas II non pas au nom d'une option révolutionnaire libérale, hégélienne ou marxiste mais, bien au contraire, au nom d'un radicalisme hyperconservateur. Merejkovski attend le "Troisième Testament" de l'eschatologie chrétienne, notamment celle réactivée par Joachim de Flore dans l'Italie médiévale. La notion de "Troisième Reich" chez Moeller est donc une actualisation de la vision de Joachim de Flore qui prophétisait l'avènement, après les règnes du Père et du Fils, de celui du Saint-Esprit. Merejkovski annonce aussi, pendant son exil parisien, l'avènement de Cham, incarnation de l'homonculus dégénéré par la rationalité libérale que Dostoïevski déjà avait décrit dans son œuvre. Plus tard, la révolution de la lie de la population fera monter au pouvoir le "peuple-bête" : Merejkovski, on l’aura compris, sera hostile à la révolution bolchevique dès la première heure.
Après quatre années passées à Paris, Moeller fait le voyage en Italie où il est fasciné par l'esthétique de la Ravenne byzantine du roi ostrogoth Théodoric, qu'il met en parallèle avec les créations des architectes allemands du "Deutscher Werkbund". Sa conscience politique allemande s'éveille progressivement quand éclate la première guerre mondiale, où il servira, vu sa santé fragile, dans les officines berlinoises chargées de contrer la propagande des alliés surtout en Flandre, aux Pays-Bas, en Scandinavie, en Suisse et dans les Pays Baltes. Contre les 14 points du Président américain Wilson, Moeller et ses co-équipiers des officines de contre-propagande élaborent une charte du "droit des peuples jeunes". La pensée de Moeller est dès lors marquée par cette volonté de rejuvénilisation permanente des discours et pratiques politiques, exactement comme Merejkovski voulait un rajeunissement de la mystique russe, comme la bohème berlinoise et munichoise - que Moeller avait fréquentée entre 1896 et 1902 - voulait une dynamisation continue de l'Allemagne wilhelminienne. Pour Merejkovski comme pour Moeller, l'Europe germanique et la Russie couraient toutes deux le risque d'un figement définitif sous l'emprise d'une pensée occidentale faite de rationalismes étriqués et de ritournelles sans substances, pareilles à celles qu'ânonne Settembrini, personnage de la Montagne magique de Thomas Mann. Le danger est permanent, comme nous le voyons encore de nos jours: le "jeune-conservatisme" doit dès lors être un militantisme permanent, visant à dissoudre les figements dans la sphère politique, artistique et littéraire.
Après 1918, Moeller s'active dans les clubs qui préparent un réarmement moral de l'Allemagne vaincue, dans une perspective très "juvénilisante", à défaut d'être révolutionnaire au sens marxiste du terme. L'Allemagne vit alors une période de crise sans précédent: défaite, effervescence révolutionnaire, république des conseils à Munich, inflation galopante, occupation française de la Ruhr, etc. Cet effondrement général laissait augurer une révolution extrême, capable de balayer toutes les structures vermoulues du passé, héritées du wilhelminisme, et toutes les institutions libérales de la République de Weimar. Pour Moeller, la disparition de ces scories hétéroclites et sans substance permettrait l'avènement du Règne du Saint-Esprit selon l'eschatologie de Joachim de Flore, règne qui serait marqué par l'effervescence, cette fois permanente, des fleurons culturels de la Belle Epoque et de certaines de ses avant-gardes. Quand la situation s'apaise, dès que le Traité de Locarno entre en phase de négociation au printemps 1925, Moeller est déçu, tout comme les frères Jünger, car un retour à la normalité perpétuera l'emprise des scories malfaisantes sur l'Allemagne et le Règne de l'Esprit saint sera remis aux calendes grecques. Moeller se suicide. Ernst Jünger opte pour un retrait hors des grouillements nauséeux de la politique.
Moeller van den Bruck connait une véritable renaissance en Allemagne depuis quatre ou cinq ans. Plusieurs thèses de doctorat lui ont été consacrées, alors que seules celles, excellentes, de H. J. Schwierskott (1962) et de Denis Goeldel (1984; en français) existaient jusqu'ici: aujourd'hui, nous avons les études fouillées d'André Schlüter (2010) et de Volker Weiss (2012). Le dossier Moeller n'est pas clos. Effectivement, l'avènement du Règne de l'Esprit Saint a été simplement postposé…
Personnalité marquante, Ernst Niekisch représente à lui seul l'originalité du courant national-bolchevique. Comment percevez-vous son rôle central et atypique dans cette époque ?
Niekisch vient du camp marxiste mais cette personnalité attachante, cet instituteur, ne représente pas seul l'option dite "nationale-bolchevique". Il a fait partie du premier gouvernement des conseils de la république bavaroise, avant que celle-ci ne soit balayée par les Corps Francs de von Epp, chers à Dominique Venner. L'échec des Conseils bavarois va l'amener, comme d'autres, à rechercher une synthèse entre nationalisme et communisme qui puisera à des sources diverses : démocratie germanique archétypale (dont l'idée sort tout droit du texte intitulé Germania de Tacite), qui peut se marier aisément avec l'idée des Conseils chère au socialiste anarchisant Landauer (tombé face aux soldats de von Epp), alliance germano-russe contre Napoléon à partir de 1813, fusion des idéaux paysans et ouvriers des socialismes et communismes allemands et russes, hostilité à l'Occident (surtout catholique et français) et au capitalisme anglo-saxon, alliance avec des peuples d'Eurasie en rébellion contre l'Ouest (Inde, Chine, monde arabe, etc.). Le rôle de Niekisch a surtout été celui d'un éditeur de revues nationales-révolutionnaires, où se sont exprimés les frères Jünger, amorçant de la sorte leur carrière littéraire. Hostile à Hitler, en qui il percevait un "catholique bavarois" allié au fascisme italien, Niekisch sera poursuivi et persécuté après 1933 et, finalement, embastillé en 1937. Cet emprisonnement lui permettra d'écrire, à mon sens, le meilleur de ses livres, Das Reich der niederen Dämonen, où l'on peut lire des dialogues entre prisonniers, des marxistes mais aussi des conservateurs "austro-fascistes", véritables témoignages des marges non-conformistes des années 20 et 30, celles qui ont été vaincues par l'histoire mais qui demeurent, néanmoins, substantielles et intéressantes.
Jünger et Ernst von Salomon furent associés à la "révolution conservatrice". Quelle importance ont ces écrivains proches des nationalistes révolutionnaires pour cette génération d'activistes ?
Jünger et Salomon sont des nationalistes révolutionnaires ou, du moins, des nationalistes "soldatiques". Cette définition leur vient de leurs écrits entre 1918 et 1928 où effectivement ils ont plaidé pour un bouleversement radical de la société, qui aurait dû être apporté par des phalanges impavides d'anciens soldats altiers de la première guerre mondiale. Le coup de force brutal, perpétré par des "cerveaux hardis" (Salomon), est la seule hygiène politique à leurs yeux, la seule façon de faire de la politique proprement. Mais, comme je viens de le dire, les Traités de Locarno (1925) et de Berlin (1926) mettent un terme au chaos en Allemagne et apaisent la situation instable de l'Europe post bellum. Jünger se retire progressivement de la politique et amorce la longue suite de ses voyages à travers le monde, à la recherche d'espaces et de sociétés intacts dans un monde de plus en plus soumis à l'accélération (Beschleunigung), à la connexion et à l'éradication. Jünger devient ainsi, pourrait-on dire, un "homme-yeux" (ein Augenmensch) qui repère partout les traces d'excellence naturelle qui subissent toutefois l'inéluctable érosion engendrée par la modernité. Le repérage, auquel il s'est livré jusqu'à son dernier souffle à la veille de ses 103 ans, est une attitude conservatrice et traditionnelle mais qui, simultanément, nie ce qui est établi car tout système établi ronge les racines anthropologiques, biologiques et ontologiques des hommes, des êtres vivants et des choses. A l'Est comme à l'Ouest au temps de la Guerre Froide, pensées et idéologies hégémoniques participaient, et participent toujours sous des oripeaux autres, à cet arasement planétaire. Comme pour Moeller, les livres sur les frères Jünger, sur les fondements de leur pensée, se succèdent à un rythme effréné en Allemagne aujourd'hui, démontrant, notamment, qu'ils ont été des précurseurs de la décélération (Entschleunigung) nécessaire de nos rythmes de vie. Une pensée qui, sous tous ses aspects, n'a pas pris une ride.
La renaissance de la jeunesse allemande est un phénomène important de l'époque de la "révolution conservatrice". Pouvez-vous revenir sur la spécificité des Wandervögel et des ligues de jeunesse ?
L'année 1896 est cruciale: Moeller arrive à Berlin et amorce sa quête dans la bohème littéraire de la capitale prussienne; Karl Fischer fonde le mouvement des lycéens randonneurs, le Wandervogel, qui cherche à arracher la jeunesse aux affres d'une urbanisation effrénée; Eugen Diederichs fonde à Iéna sa maison d'édition qui véhiculera les thèmes d'un socialisme organique et enraciné, d'une religion chrétienne adaptée aux terroirs germaniques, d'une esthétique proche des pré-raphaëlites anglais et de l'art nouveau (Jugendstil), etc. Tous cherchent à asseoir une société alternative basée sur des idéaux organiques et vivants plutôt que mécaniques et figés. Après le départ de Fischer pour les armées dans la garnison allemande de Tsing-Tao en Chine, le mouvement se structure, passe de la joyeuse anarchie contestatrice à un anti-conformisme intellectuellement bien charpenté, qui jettera les bases d'une pensée écologique profonde (avec le philosophe Ludwig Klages), d'une pédagogie avant-gardiste dans le sillage de la tradition lancée, fin du 18ème, par le Suisse Pestalozzi. Laminé par la première guerre mondiale, le mouvement de jeunesse renaît vite de ses cendres tout en se politisant davantage sous le signe du nationalisme révolutionnaire qui l'opposera, à partir de 1933, à la NSDAP qui cherchait à contrôler à son profit exclusif l'ensemble des ligues. Les mouvements des Nerother et du "dj.1.11" de Tusk (alias Eberhard Koebel) sont de loin les plus originaux, ceux qui auront organisé les raids les plus exotiques et les plus audacieux (Andes, Nouvelle-Zemble, Laponie, etc.).
Courant aux racines anciennes, le filon "folciste" (= völkisch) est une nébuleuse de groupes et d'organisations aux frontières de la religion, de l'ésotérisme et du politique. Comment expliquer la vivacité de cette conception du monde ?
Il a cependant été peu cartographié, même en Allemagne, a fortiori dans l'espace linguistique francophone. Il faudra s'atteler à une telle cartographie car effectivement les manifestations de ce filon sont multiples, partant parfois de la pure bouffonnerie passéiste. Disons, pour faire simple, que ce courant vise à faire du peuple rural allemand le modèle d'une anthropologie politique, comme les Germains de Tacite et des renaissancistes italiens ou comme le moujik des slavophiles. Il peut être approfondissement de l'identité allemande ou repli sur soi, à la façon des Mennonites protestants. Hitler s'en moquait dans Mein Kampf, brocardait les manies d'Himmler qui, parmi les dignitaires du futur "Troisième Reich", était le plus sensible à ce filon. Aujourd'hui les nouveaux "jeunes conservateurs" allemands s'en moquent au nom d'idéaux étatistes ou schmittiens. Disons que le filon survit officiellement dans toute l'Europe avec l'engouement, fort intéressant au demeurant, pour les archéosites consacrés aux périodes pré-romaines, celtiques ou proto-historiques. C'était là des projets des pré-folcistes d'avant 1914, de Himmler et des archéologues SS et… sont aujourd'hui des projets proposés par les syndicats d'initiative!
L'émergence du national-socialisme sera un bouleversement sans précédent pour l'Allemagne. Quels furent les rapports de la révolution conservatrice avec ce phénomène sans précédent ?
Il n'y a pas de rapport direct: la révolution conservatrice étant une nébuleuse de penseurs peu politisés, au sens où peu d’entre eux étaient encartés dans un parti. Généralement, les pères fondateurs ou les personnalités marquantes, mises en exergue par Mohler, dans sa thèse de doctorat sur la révolution conservatrice, n'adhèreront pas à la NSDAP (contrairement à Heidegger), sauf de très rares exceptions. Les gros bataillons de transfuges viennent plutôt des autres partis, surtout des sociaux-démocrates et, dans une moindre mesure, des démocrates-chrétiens du Zentrum. L'acceptation de la forme-parti, expression de l'ère des masses, est à mon sens déterminante pour une adhésion à la NSDAP, dès que celle-ci monte ou prend le pouvoir. Un Ernst Jünger, qui abominait la forme-parti, n'adhère pas, fidèle à son principe de jeunesse: les coups de force sont plus propres, comme ceux que préparait le Capitaine Ehrhardt, à qui il demeurera fidèle quand celui-ci sera poursuivi par la Gestapo dans les années 30. De même, le traditionaliste Edgar Julius Jung, hostile aux partis de la République de Weimar, demeure hostile à la NSDAP, alors qu'il a mené des actions musclées en 1923 contre les séparatistes rhénans quand les Français cherchaient à détacher les provinces occidentales du Reich. Seuls certains (mais pas tous!) théoriciens, économistes et sociologues du "Tat-Kreis", aux vues plus pragmatiques, passeront cum grano salis au service du nouvel Etat.
La "nouvelle droite" européenne, dans sa diversité, est-elle l'incarnation de la postérité de la révolution conservatrice ?
Il faut éviter les anachronismes. Nous vivons depuis les années 50 dans un monde fondamentalement différent de celui que nous avions entre 1880 et 1945. Armin Mohler exhume, début des années 50, les idées oubliées de la "révolution conservatrice" lato sensu, dans une Allemagne fédérale mutilée qui raisonne en termes de technocratie, seule idéologie pragmatique apte à assurer la marche en avant vers le "miracle économique". Il effectue ce travail d'encyclopédiste avec l'accord d'Ernst Jünger. Mais Mohler veut réactiver les idéaux nationaux-révolutionnaires du Jünger des années 20 en les maquillant en surface. Cette volonté provoque une rupture (provisoire) entre les deux hommes. En France, Giorgio Locchi, qui connaît Mohler, suggère à la rédaction de Nouvelle école un résumé succinct et pertinent de la fameuse thèse sur la révolution conservatrice. Il paraîtra dans le n°23 de la revue. En Italie, avant son décès prématuré en 1973, Adriano Romualdi initie le public de la droite radicale italienne aux thèmes majeurs de la révolution conservatrice allemande, lesquels, de toutes les façons, sont déjà traités abondamment par les universitaires de la péninsule. Alain de Benoist publie un résumé du livre de Schwierskott (cf. supra) dans le n°34 de Nouvelle école, grâce aux talents de traducteur d'un embastillé de la République. Nouvelle école publiera ensuite deux numéros, sur Jünger et sur Spengler, sans qu'on ne puisse parler d'un travail systématique d'exploration, les collaborateurs germanophones de la revue étant très rares ou rapidement évincés, comme Locchi ou moi-même. Les éditions Pardès lanceront une collection d'ouvrages, malheureusement peu vendus, qui ont failli faire crouler la maison, car aucun travail systématique fait de monographies ou d'essais didactiques n'a préparé le lecteur français, et surtout le militant politique, à bien réceptionner ces thématiques d'un âge héroïque européen, hélas bien révolu. Les thèmes de la révolution conservatrice allemande, en France comme en Italie ou en Espagne, sont surtout approfondis par des universitaires non marqués politiquement ou métapolitiquement, comme Julien Hervier, Gilbert Merlio, etc.
(fait à Forest-Flotzenberg, juillet 2014).
Cet entretien a été accordé à Monika Berchvok (Rivarol) suite à la parution de l'ouvrage
"La Révolution conservatrice allemande - Biographie de ses principaux acteurs et textes choisis"
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2014/07/26/r-s-entretien-sur-la-revolution-conervatrice.html