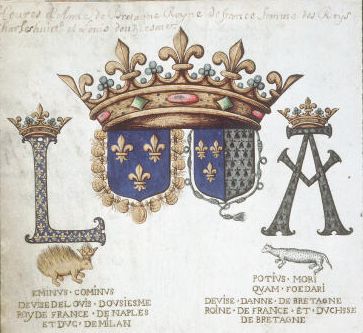Le colloque sur L’Action française, culture, société, politique du Centre d’histoire de Sciences Po, premier d’une série de trois consacrés à l’AF, a donné naissance à un ouvrage universitaire titré de la même façon, ouvrage auquel il nous semble important de consacrer une série d’articles pour faire le point des connaissances sur notre propre histoire politique et en tirer des enseignements eux aussi éminemment politiques. Après l’article sur Les ligues nationalistes et l’Action française, voici celui sur L’AF et l’Histoire (de 1900 à 1940), au travers du regard porté sur deux communications rapportées dans l’ouvrage.
L’Action française a toujours accordé une grande place à l’histoire, qui venait étayer son argumentation à l’égard des nationalistes en leur montrant que ses leçon ne pouvaient que les amener à conclure à la monarchie. C’est ce que montrent Christian Amalvi et Philippe Boutry.
Ils rappellent quelques noms souvent ignorés des monarchistes eux-mêmes et qui, pourtant, ont participé parfois à l’élaboration, plus souvent à l’actualisation et à la diffusion de "l’histoire capétienne" véhiculée par l’Action française : Jacques Bainville et Pierre Gaxotte, mais aussi Frantz Funck-Brentano, Marie de Roux, Louis Dimier, Auguste Longnon et son fils Jean, et, plus proches de nous dans le temps, Philippe Ariès ou Raoul Girardet (encore de ce monde, d’ailleurs). Les deux communications, se chevauchent et se complètent fort utilement.
Le passé en vue de l'avenir
Amalvi comme Boutry ajoutent à la liste des "non-historiens" qui, par leur recours et leur lecture politique du passé, ont, à leur manière, forgé une vision d’AF de l’histoire : des idéologues, comme Maurras ; des journalistes, le plus souvent polémistes, comme Léon Daudet et Georges Bernanos. M. Amalvi souligne que « le passé affleure constamment dans l’oeuvre de Maurras, non comme récit chronologique, mais comme preuve concrète pour appuyer une démonstration théorique et abstraite d’une rigueur implacable », ce que confirme M. Boutry : « Maurras lui-même, en dépit de ses immenses lectures, n’est nullement un historien ; ni son argumentaire ni sa polémique n’ont, en toute rigueur, besoin du document ou de l’archive pour exister ; sa "synthèse subjective" et son "empirisme organisateur" ne sont pas fondamentalement d’ordre historique, mais doctrinal. »
Sans doute Maurras signifie-t-il ainsi que, pour lui, l’histoire est le moyen de connaître ce qui "a marché" et, au contraire, ce qui est néfaste pour la France : il en a une lecture non pas purement historienne, mais, au contraire, éminemment politique. Jamais Maurras, d’ailleurs, ne s’est voulu historien et il écrit en politique par le biais de l’empirisme organisateur (« la mise à profit des bonheurs du passé en vue de l’avenir que tout esprit bien né souhaite à sa patrie », suivant sa conception) ; il intègre l’histoire à sa démonstration, au risque parfois de déconcerter les historiens eux-mêmes.
"École capétienne"
Il y avait des historiens royalistes et même une "histoire royaliste", avant l’AF et Maurras. Mais l’AF en fait un usage qui prend le contre-pied de l’histoire universitaire républicaine, et l’on peut dater la formation d’une véritable "école capétienne" sur le plan historique à la fondation de l’AF. Au delà de Jacques Bainville, Boutry signale que « la plupart de ceux qu’on rattache, de près ou de loin, à l’influence et aux doctrines de l’Action française sont bien davantage des "compagnons de route", des sympathisants ponctuels, plus ou moins nettement affirmés (car une appartenance déclarée au mouvement maurrassien ruinerait à coup sur, dans la France radicale, une carrière universitaire), des archivistes, des érudits, des historiens conservateurs plus ou moins hostiles à la république laïque et démocratique, des journalistes et des essayistes qui trouvent dans l’Action française, son journal et ses revues, des convergences intellectuelles et politiques, des affinités de réactions et de sentiments, une "communauté émotionnelle" et une chambre d’échos [...]. Une "nébuleuse", plutôt qu’un parti, à dire le vrai, mais capable de se constituer et de structurer en "école". » Cela aboutit à une « véritable hégémonie culturelle » dans les années trente, « construite en quelque trois décennies sur le paysage historiographique français par les hommes de l’Action française [...] parallèlement à l’Université et en partie contre elle ». L’Histoire de France de Jacques Bainville destinée au grand public (rééditée dernièrement dans une collection de poche et vantée, l’été dernier, sur... France-Info !), connaît un immense succès grâce à son refus du langage universitaire trop abscons.
Donner du sens à l'histoire
Cet ouvrage permet de mieux comprendre, selon M. Amalvi, la conception bainvillienne de l’histoire. « Dans sa préface, il développe les trois principes de base qui éclairent sa conception du passé : c’est d’abord une histoire psychologique traditionnelle dans laquelle la compréhension des individualités qui font l’histoire est capitale » ; Bainville privilégie les "grands hommes" et, éventuellement, les "minorités énergiques". C’est d’ailleurs une conception qu’il a en commun avec la IIIe République qui met en valeur les grandes figures comme le prouvent à l’envi les manuels scolaires de l’époque (mais ce ne sont pas toujours les mêmes, bien évidemment, ni les mêmes jugements en particulier pour les périodes "controversées" de l’histoire de France...), soucieux de donner des "héros nationaux" à une France en cours de nationalisation et de républicanisation (cf le cas emblématique de Jeanne d’Arc).
« C’est ensuite une histoire politique classique, qui privilégie l’étude des institutions, ignorant superbement la vie économique et religieuse du pays » : sans doute est-ce là encore un effet du "Politique d’abord", que Bainville a reconnu avant même de le connaître chez Maurras...
Cela veut-il dire, comme semble l’indiquer M. Amalvi, que Bainville (qui n’est pas, et comme Maurras ne l’est pas non plus, "toute" l’AF) méconnaît cette vie économique et religieuse ? En fait, c’est oublier que les auteurs de l’AF ont, d’une certaine manière, une lecture "utilitaire" de l’histoire, en particulier ceux qui ne sont pas des professionnels de l’histoire, et qu’elle leur fournit des éléments pour étayer leur propre raisonnement politique, raisonnement fondé principalement sur la comparaison des régimes politiques qui se sont succédé en France. En écrivant Nos raisons contre la République, pour la Monarchie (ou plutôt en regroupant des textes épars pour faire ce volume), Maurras n’a pas pour objectif de "servir l’histoire" mais d’en tirer des leçons ou, plutôt, de "donner du sens à l’histoire" dans une optique politique et monarchique. La question principale de l’AF, comme de tout mouvement politique, n’est pas, en soi, de faire de l’histoire, mais de faire l’histoire. L’histoire n’est qu’un moyen de la politique, surtout pour l’AF et les monarchistes qui doivent désarmer les préjugés à l’encontre d’une monarchie qui semble aller à contre-courant du "sens de l’histoire" vanté par les démocrates et, plus encore, par les universitaires marxistes comme Matthiez ou Soboul…
Histoire analogique
Dernier trait signalé par M. Amalvi : « C’est une histoire analogique, qui considère que les hommes d’autrefois ressemblaient à ceux d’aujourd’hui et que leurs actions avaient des motifs pareils aux nôtres. » En somme, c’est l’idée que, fondamentalement, les hommes ne changent pas : ce qui ne signifie pas que les sociétés, elles, n’évoluent pas, que les besoins et les désirs ne soient pas différents ou que les mentalités ne penchent pas plus d’un côté que de l’autre, entre individualisme et traditionalisme, selon les époques...
« De cet axiome de base découlent plusieurs conséquences de grande portée. Bainville considère en premier lieu que c’est le présent qui donne la clé du passé. » Du coup, Bainville, mais aussi Gaxotte et d’autres historiens dans la mouvance de l’AF, cherchent dans le passé des éléments du présent, des ressemblances qui permettraient d’apporter en politique des réponses à une situation donnée : conception cyclique d’une histoire, "éternel recommencement".
"La vraie tradition est critique"
En fait, il semble que la formule la plus appropriée pour comprendre la conception "AF" de l’histoire serait celle de Maurras : « Toute vraie tradition est critique », ce qui n’empêche ni la mise en perspective ni la mise en valeur des grands axes (principes ?) de l’histoire des hommes et des sociétés constituées, ni, bien sûr, la violente critique de la Révolution française. Il est certain que, par contre, une partie des lecteurs de Maurras, en particulier ceux qui privilégiaient l’ordre sans le définir autrement que par la peur du désordre, ne cherchaient dans l’histoire qu’un refuge face à l’adversité du moment, voire une nostalgie sans chercher à "penser la monarchie" autrement que dans ce passé "idéalisé" d’un "avant la Révolution" forcément meilleur…
Un autre élément évoqué est "l’appropriation" de l’oeuvre d’historiens, proches ou non, antérieurs ou contemporains de l’AF, comme Augustin Cochin (de tradition monarchiste et rédacteur occasionnel de la revue bimensuelle d’avant-guerre L’Action Française) et Fustel de Coulanges, républicain mais ayant défendu une conception "française" de l’histoire et de la nation après la défaite de 1870. Agaçante pour les républicains ou les universitaires, elle est en définitive l’occasion pour l’AF de démontrer son "ouverture" et de récupérer des arguments qu’elle met en ordre de bataille contre le "système" politique de la République.
Un repli sur l'histoire ?
Dernier élément évoqué de façon fort intéressante par M. Amalvi : l’existence, non d’une seule "école capétienne", mais de deux, l’une proprement politique (Maurras, Bainville, Marie de Roux, etc.) tandis que l’autre est spécifiquement (et parfois professionnellement) historienne (Pierre Gaxotte, Frantz Funck-Brentano, etc.), dont, précise l’auteur, « la lecture présente encore aujourd’hui le plus vif intérêt », ce qui est un bel hommage de l’université contemporaine à des historiens qui, longtemps, s’en sont retrouvés en marge...
C’est parfois en se séparant, ou en s’éloignant, du cercle purement maurrassien, d’après M. Amalvi, que Philippe Ariès ou Raoul Girardet ont pu renouveler leur approche de l’histoire, en privilégiant « l’autonomie de la société par rapport à l’État, et l’imaginaire politique ». Mais Ariès n’a jamais abandonné l’idée d’une politique monarchique à la tête de l’État, comme tend à le prouver sa participation à Aspects de la France puis à La Nation Française de Pierre Boutang, ce qui montre que "combat politique" et "réflexion historique" ne sont plus, dans l’esprit des royalistes de "l’ère post-maurrassienne", forcément mêlés.
Est-ce ici la remise en cause de l’empirisme organisateur, ou du "Politique d’abord" ? N’est-ce pas plutôt une séparation ou, plus sûrement encore, une autonomisation des domaines sociétal et social de la "décision politique" ? Cela n’annonce-t-il pas aussi un repli sur l’histoire qu’il s’agit de comprendre et d’écrire désormais, à défaut de la faire politiquement ? (Une certaine "démobilisation politique" était déjà intervenue chez beaucoup de monarchistes au profit de l’action religieuse, au moment de la mort du comte de Chambord puis du Ralliement.) Autant de questions qu’il reste encore à étudier... mais pas seulement par les historiens...
JEAN-PHILIPPE CHAUVIN L’Action Française 2000 du 1 er août au 3 sptembre 2008
* L’Action française - Culture, Société, politique. Éd. du Septentrion, Paris, 2008, 24 euros.
* Pour consulter une version plus développée de cet article, visitez le blog http://jpchauvin.typepad.fr/