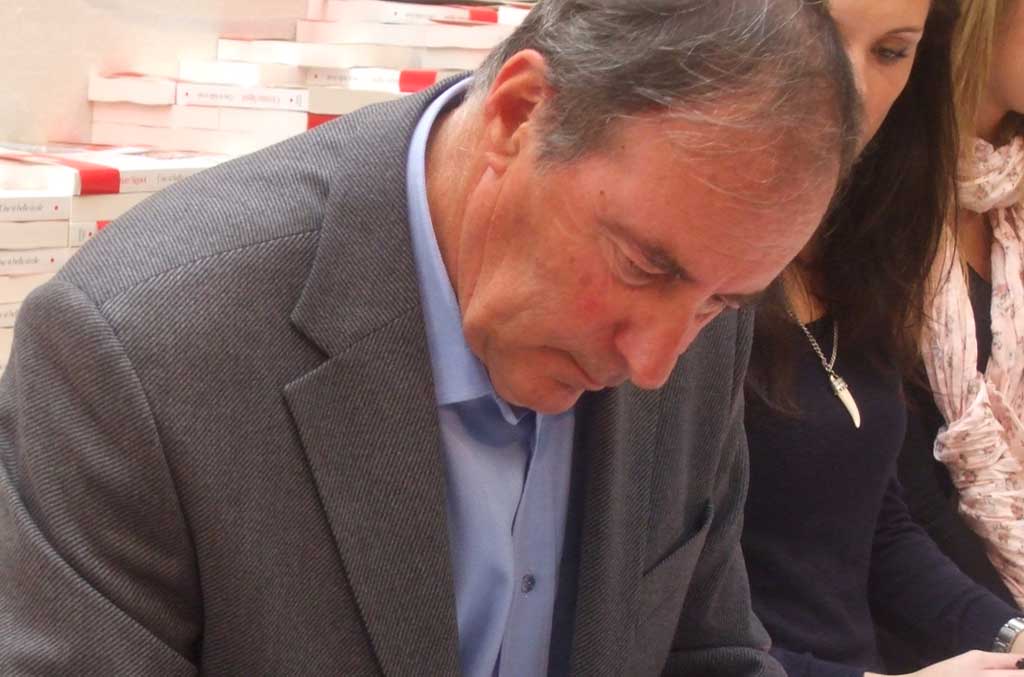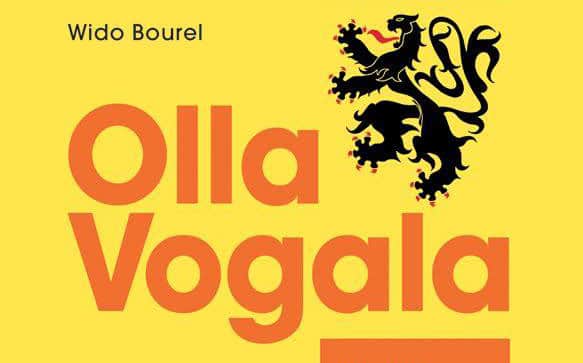Ce monde se dirige vers sa fin : inexorablement, depuis des siècles il se dirige vers sa fin. Les représentants officiels des grandes traditions ont fini par pactiser avec la décadence des profanes, tout ce qui était sacré est devenu domaine des laïcs, qui ont démantelé tous les temples pour y faire périr l'écho des paroles de vérité. La décadence de l'Europe, à partir du XIVe siècle, est le fruit de cette laïcisation de l'esprit, des mœurs et de la vie. Celui qui saisi les raisons profondes de cette désagrégation séculaire, peut opposer à l'écroulement du temple l'audace de sa force, force de vérité qui veut retourner aux saintes origines.
culture et histoire - Page 164
-
Retour à l'esprit traditionnel 1/3
-
Quand une mère de soldats nazis sauvait des officiers soviétiques

“Cachons les prisonniers russes. Peut-être que Dieu épargnera alors nos fils”, disait Maria Langthaler. Un reportage spécial d’Argumenti i Fakti sur cet exploit inconnu d’une paysanne allemande.
“Les gamins de quinze ans de la Hitlerjugend se vantaient de qui avait tué plus d’innocents. L’un a même sorti de sa poche une liasse d’oreilles coupées pour les montrer à son copain - tous les deux ont ri. Un fermier a trouvé un Russe qui se cachait dans une étable avec des moutons, et l’a poignardé avec un couteau - l’homme s’est débattu dans des convulsions, et la femme du tueur a égratigné le visage du mourant.
-
Que commémore-t-on exactement le 14 juillet ? [Vidéo]
-
Calendrier révolutionnaire : Travaillez plus pour gagner moins !

Le 24 novembre 1793, le Calendrier révolutionnaire ou républicain rentra en vigueur partout en France. La volonté des révolutionnaires fut de faire table rase du passé en instaurant un système universel s’appuyant sur le système décimal. Ce fut surtout un formidable recul des acquis sociaux des ouvriers que ceux-ci mettront plus de 100 ans à reconquérir et encore partiellement !
-
L’effondrement de l’URSS : l’historique de la trahison de Gorbatchev et Eltsine

L’URSS ne s’est pas effondrée parce que son système ne fonctionnait plus, ni parce qu’elle était économiquement affaiblie, encore moins à cause de sa guerre en Afghanistan ou autres foutaises dont les médias de propagande ont continué à nous abreuver même après la fin du bloc soviétique. Le témoignage qui suit nous raconte de l’intérieur ce qui s’est vraiment passé.
Un grand merci à Olga qui nous a retrouvé et traduit ce témoignage texte.
*
Cette année [2011] on marque les deux événements liés: le 20e anniversaire de l’effondrement de l’Union Soviétique et l’anniversaire de son premier et dernier président Mikhaïl Gorbatchev. Comment évaluer ces dates? Pour certains, l’effondrement de l’URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du siècle. D’autres, gagnant contre toute attente l’indépendance en 1991, parlent du triomphe de la démocratie et de l’autodétermination nationale des peuples, notant pompeusement les jours de son indépendance.
-
Le destin d’une génération
-
Les courants de la Tradition païenne romaine en Italie

Tout au long du XXe siècle, et, avant l’actuelle renaissance, avec le renouveau des premiers temps du Fascisme jusqu’aux Accords du Latran (11 février 1929), l’Italie a vu se manifester ce que le professeur Piero Di Vona a appelé, pour clarifier les choses, « le Traditionalisme romain ». Cet ensemble jusqu’il y a peu hétérogène, regroupant diverses personnalités, revues et tendances, n’est nullement monolithique ; il constitue plutôt une mouvance qui réussit à assumer différentes facettes d’un héritage ancien.
-
Olla Vogala, l’Histoire de la langue des Flamands, en France et ailleurs, de Wido Bourel
-
Création de tanneries de peaux humaines pendant la Révolution de 1789

Difficile de croire que des tanneries de peaux humaines et des fonderies de graisses humaines aient pu exister durant cette période troublée. Pourtant, les témoignages datant de cette époque ou de l’Empire sont nombreux et accablants. Il ne peut donc y avoir de doute sur ces macabres pratiques qui sont l’œuvre des plus hauts responsables politiques de la Convention nationale.
-
Aux origines du livre : le codex, avec Sylvie Lefèvre