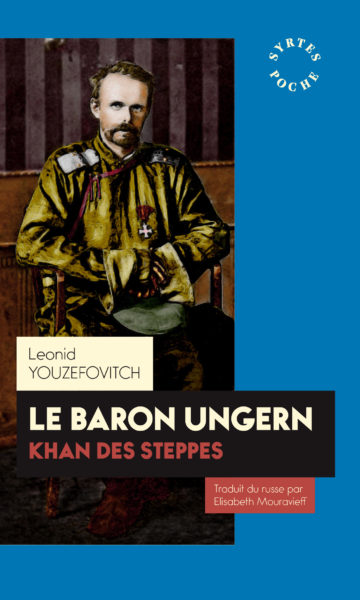Roman Fedorovitch von Ungern-Sternberg, baron allemand, général russe de l’armée blanche à trente-cinq ans, prince mongol marié à une princesse chinoise, fait prisonnier et fusillé par les rouges en 1921, est un personnage stupéfiant dont le parcours bien réel dépasse la fiction des aventuriers romanesques les plus extraordinaires.
culture et histoire - Page 465
-
Le Baron Ungern, Khan des Steppes (Leonid Youzefovitch)
-
Le symbolisme du loup 2/4

[Ci-contre : Hati & Sköll, Kate Redesiuk, 2009]
Comme le vieux cycle, le vieil homme doit “mourir” pour que surgisse l’homme à nouveau à la lumière de la Vérité et d’une nouvelle Connaissance. Ce mythe est également en rapport avec un autre type d’alternance : celui du jour et de la nuit, de mort et de résurgence cycliques du Temps et des saisons. L’hiver qui dévore comme un loup la nature corrompue de l’automne, symbolisé par l’ouest, pour la ressusciter au printemps, symbolisé par l’est.
-
LES DERNIERS FEUX DE L’EMPIRE
L’éclosion de la Sécession et des mouvements qui l’ont accompagnée ne s’est pas faite en rupture avec l’empire. La modernité viennoise n’avait que des ambitions esthétiques, ceux qui en furent les phares restaient les fidèles sujets d’une Autriche-Hongrie dont nul n’imaginait qu’elle allait disparaître.
Artistique ou littéraire, le patrimoine autrichien des années 1900 est aujourd’hui l’objet d’un engouement toujours plus vif. En France, cet effet de mode peut être daté de l’exposition qui lui a été consacrée, en 1986, par le centre Beaubourg.
-
Léonidas et les spartiates à la bataille des Thermopyles (18-20 août 480 av. J.C.)
Introduction
L’ouvrage collectif « Ce que nous sommes » édité par l’Institut Iliade nous rappelle qu’être européen c’est avant tout « transmettre l’héritage ancestral, défendre le bien commun ». C’est tout l’enjeu de notre combat : transmettre nos valeurs pour les défendre mais aussi transmettre en les défendant. Car il existe un lien indéniable entre la vitalité d’un peuple et sa volonté de combattre.
Dominique Venner l’avait parfaitement illustré dans un article intitulé « Guerre et Masculinité », paru dans La Nouvelle Revue d’Histoire. Au risque de choquer, il y soulignait le caractère en quelque sorte tragique qu’avait revêtu pour les Français la conjonction entre la fin de la guerre d’Algérie, « ressentie comme la fin de toutes les guerres » et l’évolution vers une société entièrement vouée aux valeurs marchandes et au consumérisme.
-
FAUT-IL BRÛLER ERNST NOLTE ?
L’historien allemand montre l’interdépendance entre le communisme, le fascisme et le nazisme. Une thèse qui perturbe les nostalgiques de la révolution d’octobre 1917.
Maître d’oeuvre du Livre noir du communisme, Stéphane Courtois estime qu’Ernst Nolte, dont plusieurs ouvrages sont réédités dans un volume de la collection « Bouquins », a « ouvert la voie des études historiques sur les totalitarismes » (1). D’autres considèrent toujours l’historien allemand comme un personnage sulfureux. L’ont-ils vraiment lu ?
-
La Grande Guerre – Autopsie d’un séisme (Alain du Beaudiez)
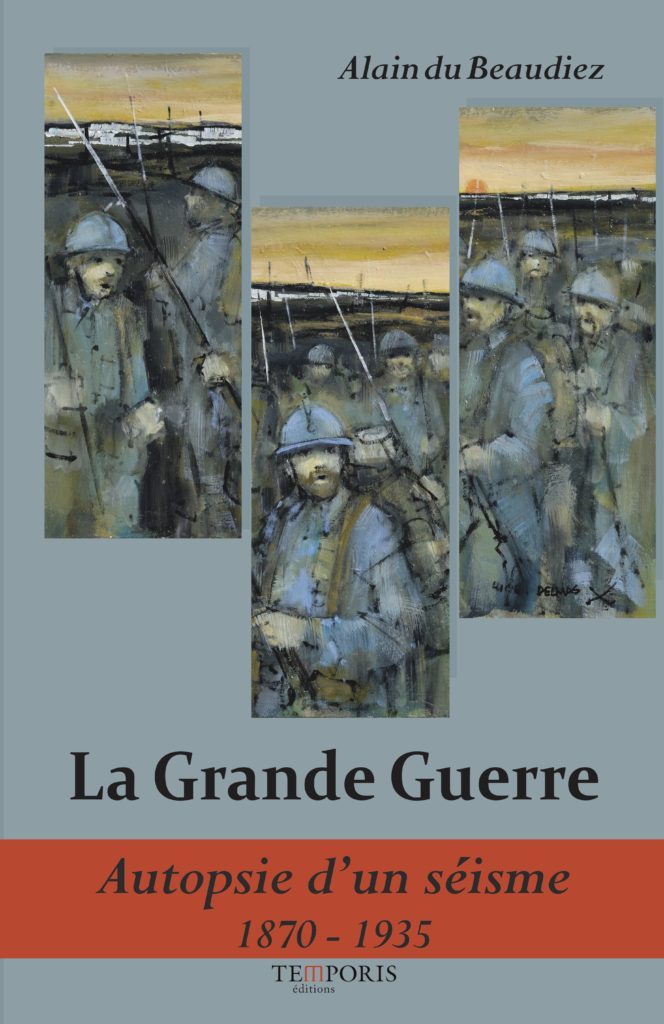
Alain du Beaudiez a passé dix ans comme officier pilote de l’Armée de l’Air avant de devenir ingénieur conseil puis de fonder et diriger pendant 25 ans le Groupe de Conseil en Systèmes d’Informatique MC21. Passionné d’histoire et de musique, il est aujourd’hui Président des Festivals de Musique de Chambre de Saint-Paul-de-Vence et d’Arcachon. Mais c’est un livre sur la Grande Guerre qu’il nous propose. Et plus largement une Histoire de la France, de 1870 à 1935.
-
Un entretien avec René Girard
Penseur chrétien, anthropologue de la violence et du sacré, René Girard confronte sa réflexion aux théories de Clausewitz dans un nouvel ouvrage (1), en même temps que ses grands livres sont rassemblés en un volume (2). Entretien avec un contemporain capital.
En relisant Clausewitz, vous avez découvert une analogie avec votre théorie de la violence mimétique…
Dans son traité de stratégie, De la guerre, Clausewitz explique que la « montée aux extrêmes » caractérise le monde moderne. Moi-même, j’étudie ce processus d’escalade, cherchant à comprendre pourquoi les relations humaines ne sont pas stables, pourquoi elles évoluent vers le meilleur ou le pire, plus facilement vers le pire. Chez Clausewitz, plus qu’une définition de la guerre, j’ai trouvé une définition « mimétique » des rapports humains, ce qui est l’objet de mes recherches.
-
LE SIÈCLE CHRÉTIEN (1220/1224) - la mort de Philippe Auguste
-
Histoire de la Bretagne (Philippe Tourault)
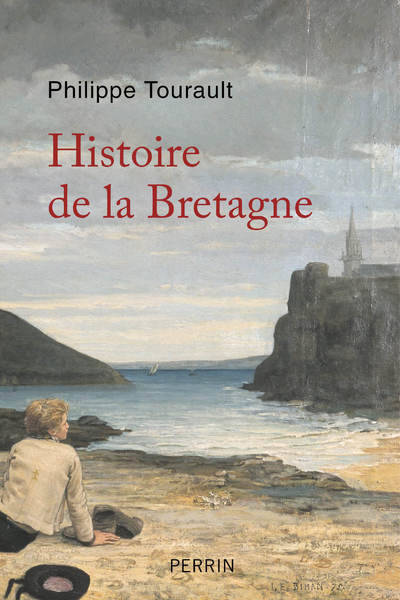
Philippe Tourault, historien, est un spécialiste reconnu de la Bretagne et l’auteur de plusieurs livres de référence sur le sujet, notamment sur Les Rois de Bretagne ou sur Anne de Bretagne. Cette fois, c’est une histoire générale de Bretagne qu’il nous propose. N’est-ce pas, en effet, en apprenant l’histoire de la Bretagne que l’on peut envisager de mieux comprendre ses singularités qui lui confèrent un caractère particulier ?
-
La symbolique politique du Loup
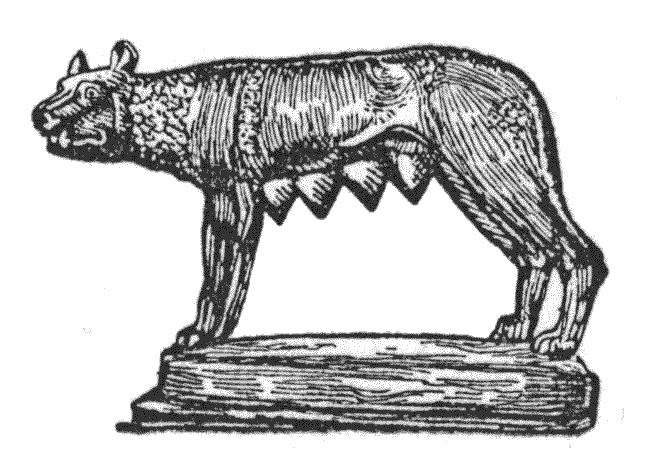
Synergies européennes - Bruxelles/Berlin - Décembre 2007
Ces jours-ci, on conteste l’authenticité de la découverte récente, à Rome, d’une grotte où, prétend-on, l’on honorait les fondateurs de l’Urbs, Romulus et Remus. C’est un coup supplémentaire pour la Ville porteuse de tant de mythes, après que l’on ait nié l’authenticité de la Louve Capitoline, qui n’aurait pas d’origines dans l’Antiquité mais n’aurait été inventée qu’au cours de notre Moyen-Âge. Quoi qu’il en soit, les enfants légendaires de la Louve sont tels qu’on les a toujours imaginés : paisibles sous le ventre du fauve, s’abreuvant à ses tétons.