culture et histoire - Page 527
-
Une Histoire de la Nouvelle France Partie 1
-
Le site Medias-presse-info consacre un article au Cahier d'Histoire du nationalisme n°19 sur les mouvements nationalistes en Belgique de 1945 à 2000
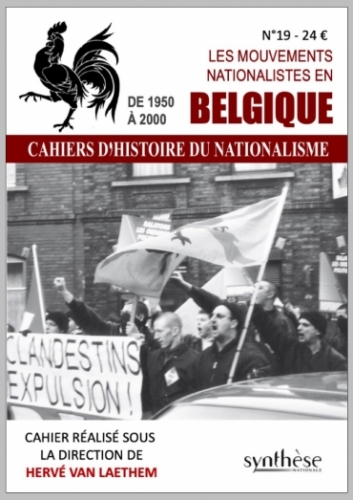
Source Médias presse info cliquez ici
Hervé Van Laethem a derrière lui déjà plusieurs décennies de militantisme nationaliste en Belgique. Au cours des dernières années, il s’est illustré à la tête du mouvement NATION. Il est également très présent et actif parmi les réseaux établis entre mouvements nationalistes à travers l’Europe. C’est également un fin connaisseur de la géopolitique syrienne qui a été reçu à plusieurs reprises par les autorités de ce pays, y compris par le président Bachar el-Assad.
-
Avant-Garde d’Europe

Certains d’entre nous militent dans un parti ou un mouvement politique radical ; d’autres dans un parti populiste ; d’autres encore participent aux activités d’un centre d’études, d’un magazine ou d’une association ; d’autres enfin se réclament d’une communauté précise.
Nous venons de différents pays européens et nous voulons nous rendre utiles, comme avant-garde d’une tendance.
Comment pouvons-nous être utiles en SYNERGIE – en tant que véritables “unités impériales” – à la cause nationale-révolutionnaire européenne?
-
Charles Maurras et l’Histoire
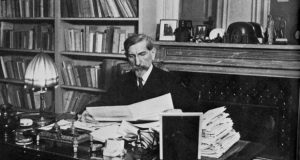
Une fois n’est pas coutume : j’ai accepté, pour une raison de calendrier (les 150 ans de sa naissance), de me pencher sur un personnage qui sort du cadre habituel de mon étude qui est le XVIIIe siècle : Charles Maurras.
Né au XIXe siècle et mort au XXe (1868-1952), Charles Maurras a suscité et suscite encore bien des passions. Nous y reviendrons dès que possible.
-
1941 : les Soviétiques préparaient la guerre !

Pendant des décennies, l'attaque allemande contre l'Union Soviétique, commencée le 22 juin 1941, a été considérée comme l'exemple par excellence d'une guerre d'extermination, préparée depuis longtemps et justifiée par des arguments raciaux. L'historiographie soviétique qualifiait en outre cette guerre de “guerre de pillage” et ajoutait que l'Allemagne avait trahi ses promesses, avait rompu la parole donnée. Jusqu'en 1989, le Pacte Hitler/Staline des 23 et 24 août 1939 avait été interprété de cette façon dans l'apologétique soviétique. L'observateur des événements était littéralement noyé sous un flot d'arguments qui visaient à étayer au moins 2 thèses :
- 1) La signature du traité a empêché Moscou d'être impliqué dans les premiers événements de la guerre européenne, qui aura ultérieurement comme victime principale l'URSS ;
- 2) Le pouvoir soviétique a vu d'avance le plan des “impérialistes” et l'a contrecarré ; il visait à détourner l'armée allemande vers l'Est. L'Union Soviétique aurait ainsi été la victime, à l'été 1941, de sa fidélité à la lettre du pacte et de sa volonté de paix. Cette loyauté, l'URSS l'a payée cher et a failli être complètement détruite sur le plan militaire.
-
La Petite Histoire : Geneviève, la sainte qui a sauvé Paris des Huns
En 451, alors que les Huns menés par le terrible Attila ravagent la Gaule, les Parisiens n’ont qu’une idée en tête : fuir leur cité au plus vite. Mais parmi eux, une voix s’élève, celle de sainte Geneviève, qui les exhorte à ne pas abandonner la ville aux barbares. Pendant des jours, elle s’adonne au jeûne et à la prière afin d’enjoindre le seigneur à sauver Paris. À la stupéfaction générale, les Huns détourneront leur route et se dirigeront vers la Loire, épargnant ainsi la future capitale. Un miracle, diront certains, qui vaudra entre bien d’autres faits à Geneviève de devenir la sainte protectrice de Paris.
https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-genevieve-la-sainte-qui-a-sauve-paris-des-huns
-
Une écriture dans l'ombre : les secrétaires au temps moderne
-
Hélène Carrère d’Encausse : Goodbye Lénine
Dans l’imaginaire collectif, la chute du mur de Berlin, en 1989, marque la fin du communisme en Europe. S’il est vrai que cet événement eut des conséquences pratiques et symboliques considérables, il reste que c’est plusieurs années auparavant que le système avait commencé à craquer. En 1985, l’accession au pouvoir de Mikhaïl Gorbatchev à Moscou allait changer la donne, puisque cet homme avait compris que, si le régime ne se rénovait pas, ses jours seraient comptés.
-
Vive l'Europe LIVE - Entretien avec Laurent Alexandre - Dimanche 21 février, à 21h
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
Vianney : le piège de « The Voice » se referme

Le gentil chanteur Vianney ne sera sans doute plus jamais le même. Celui qui souhaitait juste apporter « du bonheur aux gens », qui « assumait être cucul », déclarait « ne pas comprendre la méchanceté » et « trouver injuste les railleries » aura, le temps de deux émissions de « The Voice », provoqué torrents de haine et déferlements d’insultes de la part de militantes féministes et de membres des communauté LGBT.