Son existence est parfois remise en doute mais sa légende, bâtie au fil des siècles, est loin d’être enterrée. En 1472, alors que les Bourguignons ravagent la région sur les ordres furieux de Charles le Téméraire, une ville pourtant sans garnison va résister aux envahisseurs. Cette ville, c’est Beauvais, où tous les habitants se mobilisent pour en interdire l’accès aux troupes du duc de Bourgogne. Les combats sont farouches, et les femmes y prennent toute leur place, notamment l’une d’entre-elles, une certaine Jeanne Hachette. Armée d’une petite hache, elle repousse un assaillant et parvient même à capturer son étendard, redonnant ainsi du courage à tous les assiégés. Elle restera, aux yeux de l’histoire, le symbole de la résistance beauvaisienne, et surtout de la bravoure des femmes lors de ce siège.
https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-jeanne-hachette-une-heroine-francaise

 « Bastien-Thiry avait quelque chose de romantique. Ce sera un bon martyr », avait ironisé le général de Gaulle deux jours après l’exécution du lieutenant-colonel. Ce martyr mérite de figurer au panthéon des héros français.
« Bastien-Thiry avait quelque chose de romantique. Ce sera un bon martyr », avait ironisé le général de Gaulle deux jours après l’exécution du lieutenant-colonel. Ce martyr mérite de figurer au panthéon des héros français.

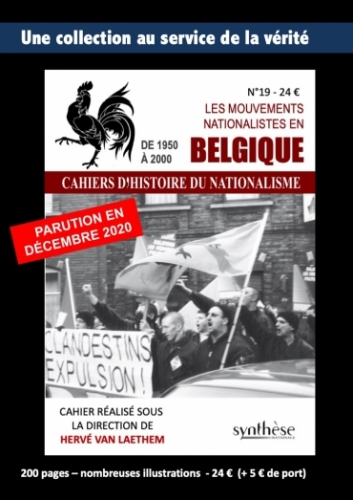 Hervé, pourquoi avoir écrit un tel livre ?
Hervé, pourquoi avoir écrit un tel livre ?