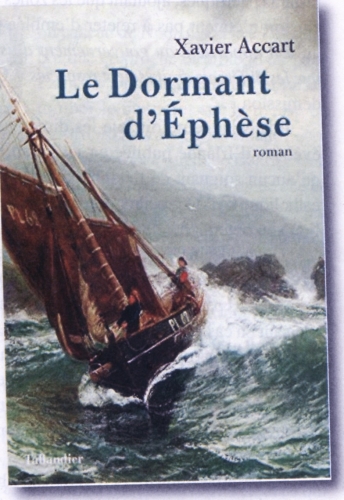 Le Dormant d’Ephèse ? Étrange titre pour un roman dans lequel l’auteur, Xavier Accart, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Prier, prend pour base cette idée simple que toute existence finie est une recherche de Dieu et que les dormants que nous sommes attendent chacun leur résurrection…
Le Dormant d’Ephèse ? Étrange titre pour un roman dans lequel l’auteur, Xavier Accart, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Prier, prend pour base cette idée simple que toute existence finie est une recherche de Dieu et que les dormants que nous sommes attendent chacun leur résurrection…
Propos recueillis par l’abbé G de Tanoüarn
Xavier Accart, votre premier roman se passe en Bretagne, même s’il a besoin du théâtre du monde pour déployer son intrigue. C’est la Bretagne comme terre spirituelle qui vous intéresse, comme le savent les lecteurs de Monde&Vie auxquels j’ai déjà parlé de votre livre dans notre dernier numéro, une Bretagne finalement universelle ?
J’ai une affection très forte pour la Bretagne et cela n’a rien d’universel. Mon grand-père (ndlr : Jean Accart, as de la Bataille de France en 1940), avait une maison sur une île, en Finistère nord. Cette île est devenue pour moi, quelque-chose comme un Eden perdu, le plus bel endroit du monde. C’est, avec le sanctuaire des Sept Saints en Trégor, le point focal d’où l’on part et où l’on revient dans mon roman. C’est la source mystique d’une histoire qui emmène les protagonistes au Maroc, en Égypte et bien sûr, comme l’annonce le titre, à Ephèse. Dans le roman, je l’appelle Locat, le lieu par excellence, un lieu toujours fondateur et à jamais perdu, où je venais enfant passer des vacances, où je suis revenu au hasard des indivisions et je suis parti quand l’indivision a définitivement pris fin. Je me souviens d’une vieille Bretonne, notre voisine qui, m’apercevant après une longue absence, lors d’un de ces retours précaires, me dit, avant de tourner les talons : « toi, tu es d’ici ».
Lire la suite

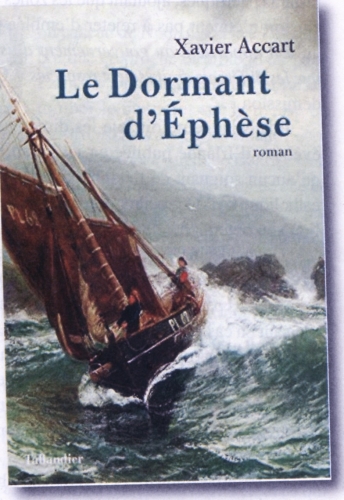 Le Dormant d’Ephèse ? Étrange titre pour un roman dans lequel l’auteur, Xavier Accart, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Prier, prend pour base cette idée simple que toute existence finie est une recherche de Dieu et que les dormants que nous sommes attendent chacun leur résurrection…
Le Dormant d’Ephèse ? Étrange titre pour un roman dans lequel l’auteur, Xavier Accart, par ailleurs rédacteur en chef de la revue Prier, prend pour base cette idée simple que toute existence finie est une recherche de Dieu et que les dormants que nous sommes attendent chacun leur résurrection…