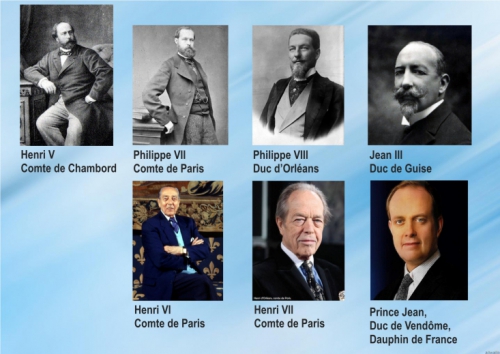S’il serait fou de croire que la liberté d’expression peut être totale, il n’est pas moins insensé de penser que la judiciarisation à la fois pressante et erratique de la parole qui est en cours n’implique pas à une analyse une police du langage d’un tout nouveau genre ou, plutôt, de milices et patrouilles du propos impie. »
La question de la liberté d’expression – et en l’occurrence la mise en évidence de la constante réduction en peau de chagrin de cette liberté fondamentale – est l’un des sujets favoris de Polémia, et de nombreux commentaires et recensions ont été consacrés à ce thème depuis plusieurs années. Parmi les nombreux ouvrages qui ont abordé ce sujet, celui d’Anastasia Colosimo, Les bûchers de la liberté, mérite que l’on s’y arrête quelque peu.
En effet, loin de se borner à une analyse de la législation et de la jurisprudence françaises, ou à une approche pamphlétaire permettant de tirer à boulets rouges sur ceux qui nous gouvernent, qu’ils soient politiciens, juges ou journalistes, cet essai possède une ambition beaucoup plus vaste. Tous les points de vue de l’auteur ne susciteront pas l’adhésion, mais aucun ne laissera indifférent.
Le blasphème, ou comment s’en débarrasser
A la base de son raisonnement l’auteur affirme que les démocraties sont par nature fragiles, car elles peinent à se définir au Mal radical, c’est-à-dire à désigner l’ennemi et à le combattre. S’y ajoute une volonté naïve de transcender les contradictions de la mondialisation, qui trouve sa plus éloquente illustration dans l’éphémère « esprit du 11 janvier », communiant dans le slogan « Je suis Charlie ». Jusque-là, rien qui ne rejoigne nos propres manières de voir.
La thèse centrale du livre est que nous ne parvenons pas à éradiquer du débat la notion de blasphème. Cette actualité du blasphème concerne désormais toute la planète pour devenir culminante dans le monde sunnite, le Pakistan ayant joué un rôle moteur dans cette montée en puissance. Nous en arrivons au point que certains mouvements se réclament de valeurs universelles pour justifier le meurtre au nom de l’identité. Au demeurant, la catharsis révolutionnaire des fondamentalistes dévots dépasse celle des totalitarismes athées, puisque le jugement de Dieu annule l’histoire…
Anastasia Colosimo établit un parallèle intéressant entre l’inflation du blasphème et la substitution de l’affrontement nord-sud à celui qui précédait entre « le monde libre » chrétien et le monde communiste athée. Cette tendance est évidemment facilitée par l’implosion des utopies socialistes et « l’explosion des certitudes religieuses ».
Cette dernière est avant tout l’apanage de l’oumma : tous les pays musulmans sans exception ont une législation contre le blasphème et un arsenal juridique ou une répression de fait pour la faire appliquer. Mais cela ne signifie pas pour autant que le monde occidental est a contrario parfaitement à l’aise avec la notion de blasphème. A travers la description précise de la situation qui prévaut dans différentes catégories de pays européens, une conclusion s’impose : les législations qui tentent de traiter les offenses aux religions et aux croyants au nom de la tolérance et du pluralisme ne parviennent pratiquement jamais à opérer une discrimination satisfaisante entre libertés de conscience, de croyance et d’expression. Et, cerise sur le gâteau, la CEDH considère que la liberté d’expression ne constitue pas un principe en soi absolu et total, mais peut faire l’objet de restrictions et de sanctions.
Au final, « la condamnation unanime, par l’opinion européenne, de la fatwa intolérable contre Salman Rushdie, de la fatwa inconcevable contre Charb, des fatwas insupportables et sans nombre prohibant le blasphème au sein des régimes liberticides, se heurte inlassablement au fait que la question du blasphème continue de hanter les rédactions des médias européens, les parlements des gouvernements européens et les tribunaux des juridictions européennes, et ce, jusque dans le sanctuaire de la conception libérale des libertés qu’aime la Cour européenne des droits de l’homme ». On ne saurait mieux dire…
A travers une exégèse approfondie des principales étapes de la jurisprudence de la CEDH, Anastasia Colosimo montre clairement le relativisme des raisonnements juridiques de la Cour, qui a conduit à retenir une acception toujours plus restrictive des conditions d’exercice de la liberté d’expression. Elle met en particulier en évidence la prévalence d’une notion de « blasphème objectif », qui se révèle être une véritable impasse de la pensée, en opérant un glissement progressif de l’identification de la victime du blasphème : d’abord la Divinité elle-même, puis la communauté dont la Divinité a été offensée, enfin la communauté elle-même divinisée des « croyants humiliés ».
Un tel glissement peut trouver grâce auprès des chrétiens, qui sont légitimement choqués par toutes les manifestations, qu’elles soient médiatiques, publicitaires, « artistiques » ou autres, qui sont perçues comme de véritables insultes à Dieu et la communauté des croyants. L’auteur rappelle, avec des détails souvent très crus, un certain nombre de ces accès de « christianophobie » aiguë, où Charlie n’a d’ailleurs pas été le dernier à s’illustrer, dans des termes en comparaison desquels les caricatures de Mahomet font figure d’images pieuses.
Sur ce point, notre auteur fera grincer quelques dents, car elle consacre quelques développements aux actions menées par l’AGRIF, et montre qu’en se plaçant sur le terrain de l’antiracisme d’une part, et en invoquant la notion de blasphème à l’égard de la communauté catholique d’autre part, elle donne raison aux groupes de pression musulmans qui amalgament islamophobie et racisme. Or, chacun est à même de constater que les musulmans sont beaucoup plus offensifs dans leur stratégie, et que la majorité des Français, inquiète des nuisances bien visibles de la montée de l’islam et de l’immigration, ne juge pas prioritaire de sanctionner quelques caricaturistes ou quelques metteurs en scène de journaux qu’ils ne lisent pas et de spectacles qu’ils n’iront jamais voir.
La question n’est pas de minimiser l’importance et la gravité des démonstrations de « christianophobie », mais de reconnaître que la démarche de l’AGRIF ou de Civitas apporte de l’eau au moulin des islamistes, puisqu’elle s’organise autour d’un noyau identique : l’acte blasphématoire. Ce faisant, elle fait aussi le jeu de tous les « meneurs d’opinion » qui veulent nous faire croire que les Français sont ces êtres phobiques qui rejettent les étrangers, les musulmans, les homosexuels, et de manière générale tout ce qui n’est pas dans la perspective de la doxa du « vivre-ensemble ».
La loi Pleven, axe du Mal
Le lecteur s’arrêtera tout particulièrement sur le chapitre de l’ouvrage intitulé « Une passion française ». L’auteur survole l’évolution du traitement du blasphème dans le droit et la politique français depuis le début du Moyen Age jusqu’à nos jours. Elle constate que l’apogée de la consécration du pluralisme coïncide avec la loi du 29 juillet 1881, « après deux siècles d’affrontements idéologiques d’une violence inouïe ». La loi de 1881 sur la presse est un exemple de texte fondateur dont la robustesse résistera, sous réserve de quelques encoches relativement secondaires, jusqu’au début des années 1970, époque où réapparaissent des questions qui, sans être d’ordre strictement confessionnel, « présentent un caractère de sacralité » (en tête desquelles figurent, on l’a compris, les « discriminations raciales » et la « Shoah »).
C’est en 1972 que la loi Pleven, dont les dispositions principales vont être précisément codifiées dans la loi de 1881, va marquer « une rupture fondamentale dans l’appréhension des limites de la liberté d’expression » (p.159), en instituant un délit de provocation à la discrimination à raison de « l’appartenance ou de la non-appartenance » à une religion. En outre, dans la loi Pleven, la discrimination ne vise plus seulement les personnes, mais aussi les « groupes de personnes ». C’est dans ces brèches que vont s’engouffrer, dans un premier temps, les associations qui ont pour objectif de lutter contre la christianophobie, et désormais, avec beaucoup plus de pugnacité et d’efficacité, les mouvements fondamentalistes islamiques.
Anastasia Colosimo a entièrement raison de considérer que la loi Pleven est la source même de la confusion qui règne dans les textes et dans la jurisprudence depuis plus de 40 ans : c’est elle qui a ouvert la voie à des débats byzantins et à des amalgames ésotériques entre croyance et croyants ; c’est elle qui a permis la floraison des lois « mémorielles » ; c’est à elle que l’on doit la judiciarisation croissante de l’expression des opinions dissidentes et la surenchère législative qui s’organise autour de la notion de « groupe de personnes ».
« En [invitant] les communautés à s’armer les unes contre les autres afin de faire prévaloir leurs droits… la loi Pleven représente une erreur impardonnable car, en autorisant les associations à porter plainte au nom d’un groupe d’une communauté, elle a consacré le règne de l’amalgame. […] Tel est bien le piège communautaire dans lequel [elle] enferme les individus en rouvrant la possibilité de punir le blasphème dès lors que certains peuvent se porter partie civile au nom de tous. […] tels sont les torts fondamentaux de la loi Pleven. Mais ce ne sont pas les seuls. En introduisant par là de nouvelles limites à la liberté d’expression, elle a rendu possible la remise en cause de la loi sur la presse de 1881 ayant pour principe la libre circulation de toute opinion, y compris la plus dangereuse. » (p.200-202).
« Constituer un délit de parole contre un « groupe » relève d’un arbitrage si complexe qu’en mettant ne serait-ce qu’un pied dans la porte, on court à l’effondrement de l’entier édifice », nous dit encore Mme Colosimo (p.219). Force est de constater que l’édifice est déjà largement en ruines. La seule issue satisfaisante serait en l’occurrence de faire table rase et de repartir sur de nouvelles bases.
L’exemple idéal nous vient – une fois n’est pas coutume – des Etats-Unis qui, avec leur Premier Amendement à la Constitution bien « gardienné » par la Cour suprême, ont tout pour plaire. Mais pour rester dans le contexte français, un retour aux fondamentaux de la loi de 1881 (sanction de la diffamation ou de l’injure faite aux personnes) serait déjà un pas énorme dans le bon sens. En mai 2014, dans un commentaire de l’ouvrage de Jean Bricmont, La République des censeurs (*), j’avais plaidé pour une liberté d’expression « une et indivisible ». Les mises en garde contenues dans Les bûchers de la liberté m’incitent à ne pas changer d’un iota mes conclusions de l’époque.
Dans sa conclusion, l’auteur se demande qui en France aurait le courage d’abroger la loi Pleven et les lois mémorielles. Sa conviction personnelle semble être que le piège s’est refermé et favorise « la guerre de tous contre tous au nom d’un utopique vivre-ensemble ». Faisons en sorte que cette prédiction pessimiste, en dépit de tous les signes d’alerte, ne se réalise pas. Nous sommes effectivement en situation de guerre, mais il s’agit jusqu’ici de la guerre menée par les élites contre le peuple et par les minorités agissantes contre la majorité anesthésiée par les drogues du complexe politico-économico-médiatique. L’objectif est d’inverser le rapport de forces. Comme le dit périodiquement Michel Geoffroy : « Et si on donnait la parole aux Français ? (**) »
Bernard Mazin, 10/9/2016
Anastasia Colosimo, Les bûchers de là liberté, Editions Stock, janvier 2016, 232 pages.
Notes :
(*) «La République des censeurs » de Jean Bricmont
(**) : Et si on donnait la parole aux Français ?
http://www.polemia.com/les-buchers-de-la-liberte-danastasia-colosimo/


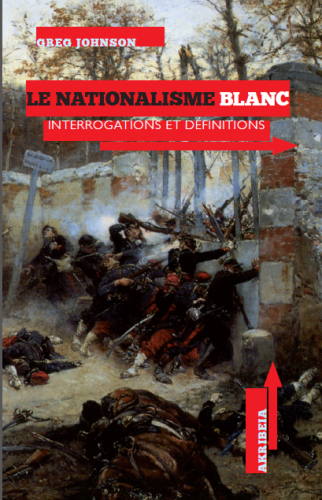 Greg Johnson, Le Nationalisme Blanc, interrogations et définitions
Greg Johnson, Le Nationalisme Blanc, interrogations et définitions