culture et histoire - Page 1160
-
Zoom d'été n°6 avec Philippe Milliau Président de TVL
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
L'Europe des Celtes - La vie quotidienne des Celtes
-
Et si on se passait de gouvernement ?
Lu dans L'Action française 2000 :
 "Plus de six mois après les élections législatives du 20 décembre 2015, l’Espagne est toujours dépourvue de gouvernement. Le Parti populaire de Mariano Rajoy avait obtenu 33,4 % des suffrages, mais il devait composer avec d’autres formations politiques ayant émergé à cette occasion. En juin dernier, compte tenu de cette crise, le roi a dissout l’Assemblée, mais les nouvelles élections ont confirmé le résultat des précédentes, sans permettre de résoudre cette crise institutionnelle. Le gouvernement sortant se contente d’expédier les affaires courantes sans pouvoir présenter des projets de loi devant le Congrès des députés. Néanmoins, malgré cette paralysie, le pays s’en sort bien du point de vue économique, bon an, mal an, avec une baisse du chômage et une croissance satisfaisante.
"Plus de six mois après les élections législatives du 20 décembre 2015, l’Espagne est toujours dépourvue de gouvernement. Le Parti populaire de Mariano Rajoy avait obtenu 33,4 % des suffrages, mais il devait composer avec d’autres formations politiques ayant émergé à cette occasion. En juin dernier, compte tenu de cette crise, le roi a dissout l’Assemblée, mais les nouvelles élections ont confirmé le résultat des précédentes, sans permettre de résoudre cette crise institutionnelle. Le gouvernement sortant se contente d’expédier les affaires courantes sans pouvoir présenter des projets de loi devant le Congrès des députés. Néanmoins, malgré cette paralysie, le pays s’en sort bien du point de vue économique, bon an, mal an, avec une baisse du chômage et une croissance satisfaisante.Le précédent belge
Cette situation rappelle la crise institutionnelle que la Belgique avait vécue à l’issue des élections législatives de juin 2010, demeurant un an et demi sans gouvernement. Dans ce pays composé de communautés culturelles et linguistiques aux relations conflictuelles, les visées sécessionnistes flamandes, encouragées par la NVA, avaient contribué aux blocages politiques. Sans affecter gravement l’économie du pays, cela avait poussé la société civile à prendre une initiative pour sortir du marasme : ainsi des francophones, des néerlandophones et des germanophones s’étaient-ils réunis afin de faire entendre la voie du “pays réel”.
Pas de président au pays du Cèdre
Quant au Liban, dont la constitution a été inspirée par celle de la Belgique et dont la composition communautaire est similaire, il est dépourvu de chef d’État, avec un gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, depuis plus de deux ans. Le processus d’élection du président est identique à celui de la IIIe République française, dont le modèle a lui aussi été transposé au Liban : les députés sont donc appelés à élire le chef de l’État ; mais pour y parvenir, un compromis communautaire est nécessaire. Or ce compromis a toujours été le fruit de tractations étrangères, en fonction des acteurs influents sur la scène libanaise : autrefois la Syrie, Israël, les États-Unis, l’Arabie saoudite et, dans une faible mesure, la France. La situation actuelle au Proche et au Moyen-Orient empêche le déroulement de ce processus électoral. Mais le pays s’en sort bien, grâce au flux financier dont il bénéficie et à la dynamique de la société civile qui s’impose de plus en plus en s’insurgeant contre le système communautaire et celui des partis politiques.
Ces trois exemples illustrent la survie de pays sans véritable gouvernement grâce à la prise de conscience du pays réel – lequel surmonte les crises institutionnelles qui sont les conséquences des conflits entre les partis politiques."
-
[Revue de presse] Livr'arbitres #20
 Revue littéraire du pays réel lit-on sur le site de Livr'arbitres... et, effectivement, on ne pourra nier l'aspect "non-conforme" de cette publication apériodique dont on entend de plus en plus parler. Je l'avais juste feuilletée jusqu'à maintenant et ce numéro 20 est le premier que j'examine en détail. Première constatation: il n'y a pas à être un spécialiste de la littérature pour y trouver son compte. Tout honnête homme ayant un minimum de culture et de connaissance des lettres liées de près ou de loin à nos courants de pensée pourra y satisfaire sa curiosité.
Revue littéraire du pays réel lit-on sur le site de Livr'arbitres... et, effectivement, on ne pourra nier l'aspect "non-conforme" de cette publication apériodique dont on entend de plus en plus parler. Je l'avais juste feuilletée jusqu'à maintenant et ce numéro 20 est le premier que j'examine en détail. Première constatation: il n'y a pas à être un spécialiste de la littérature pour y trouver son compte. Tout honnête homme ayant un minimum de culture et de connaissance des lettres liées de près ou de loin à nos courants de pensée pourra y satisfaire sa curiosité.Ce dernier numéro de Livr'arbitres offre un beau dossier sur Pol Vandromme (1927-2009), critique littéraire belge très réputé dont le maître-ouvrage La droite buisonnière (1960) ainsi que les monographies qu'il consacra à bien des écrivains sulfureux (Céline, Brasillach, Rebatet...) sont précédés d'une belle réputation chez les connaisseurs. D'autres portraits d'écrivains agrémentent cette livraison: ceux de Roger Nimier et de René Fallet.
Livr'arbitres se compose par ailleurs de très nombreuses chroniques de livres ou notes de lecture qui permettent de revenir sur les dernières parutions. Choix complètement subjectif, celles que je tiens à mentionner concernent: le second volume des Etudes rebatiennes; les rééditions de Six heures à perdre de Robert Brasillach et des Réprouvés de Von Salomon; le récent Qui suis-je? sur Léon Degrelle; Eléments pour une pensée extrême de Georges Feltin-Tracol (que j'avais chroniqué ici) et les dernières sorties consacrées à Jean Mabire.
Bien d'autres surprises complètent cette agréable revue, en particulier un article de notre collaborateur Virgile lié à la réédition du Blanc Soleil des vaincus de Dominique Venner. Tout cela pour dire que Livr'arbitres est une publication de qualité dont je lirai les prochains numéros avec plaisir.
Rüdiger /C.N.C
-
Zoom d’été : A la rencontre d’Anne Brassié (Perles de cultures)
-
Le nouveau «système»
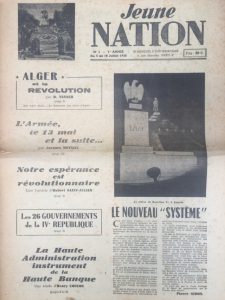 Ce que nous voulions – et avec nous l’immense majorité de nos compatriotes des deux rives de la Méditerranée – c’était un État nouveau en droite ligne du magnifique mouvement de rénovation du 13 mai à Alger.
Ce que nous voulions – et avec nous l’immense majorité de nos compatriotes des deux rives de la Méditerranée – c’était un État nouveau en droite ligne du magnifique mouvement de rénovation du 13 mai à Alger.Ce que nous avons, malgré une grande illusion, c’est un nouveau «système» issu du respect ridicule d’une procédure désuète d’un régime périmé. Ce que le Pays attendait, c’était un gouvernement national de Salut Public animé par des hommes nouveaux aux idées nettes et franches.
Ce qu’il a eu, est une combinaison ministérielle comprenant quatorze parlementaires dont trois anciens présidents du Conseil, tous foncièrement hostiles aux idéaux de la Révolution d’Alger.
Ce que les Français exigeaient, c’était la mise à la porte du parlementarisme ; la fin de la mascarade du Palais-Bourbon.
Ce qu’ils ont, c’est la perspective d’une grande rentrée parlementaire à l’automne avec une comédie électorale en octobre et une autre en novembre, l’ensemble présenté comme un bienfait inestimable.
Ce que la France et son armée espéraient, c’était le coup d’arrêt final à la politique d’abandon et l’affirmation des positions françaises dans toute l’Afrique du Nord.
Ce qu’ils constatent, avec l’abandon des postes au Maroc et des aérodromes de Tunisie, c’est le début d’un second Brazzaville.
Ce que la Métropole et l’Algérie désiraient, c’était des informations françaises accordant la connaissance des nouvelles avec l’intérêt national.
Ce qu’on leur impose, ce sont des chroniqueurs mendésistes à la Radio : c’est une bande d’actualités relatant le premier voyage du général de Gaulle en Algérie, où en un quart d’heure, les mots «Algérie française» ne sont pas prononcés une seule fois par le commentateur : c’est toujours l’abominable presse quotidienne de Paris a la merci des marxistes de toutes obédiences et d’affairistes de toutes origines.
Notre insatisfaction est totale.Entre nous et les méthodes, les idées, les hommes d’hier et d’aujourd’hui, il n’y a rien de commun.
Encore une fois proclamons donc que ce ne sont ni les mortelles habitudes parlementaires, ni le bonnet phrygien, qui rendront à la France sa place de grande nation.
Ce n’est que par la Croix Celtique et le béret de parachutiste que la France sera sauvée.
Pierre Sidos – Jeune Nation, n°1 du 5 au 18 juillet 1958, bimensuel parisien.
-
Zoom d’été : A la rencontre de Christopher Lannes (La petite histoire)
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
Sur Les Traces Des Celtes De Glauberg [ Documentaire Historique ]
-
Chronique de livre : Philippe Baillet "L'autre tiers-mondisme ; des origines à l'islamisme radical"
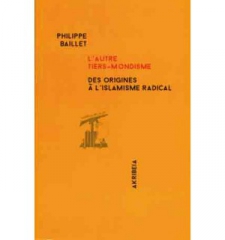 Philippe Baillet, L'autre tiers-mondisme; des origines à l'islamisme radical
Philippe Baillet, L'autre tiers-mondisme; des origines à l'islamisme radicalFascistes, nationaux-socialistes, nationalistes-révolutionnaires entre « défense de la race » et « solidarité anti-impérialiste »
(Akribéia, 2016)
Qu'est-ce que l'autre tiers-mondisme ? Un tiers-mondisme différent de celui que l'on connaît, c'est à dire « classique, progressiste, qu'il soit chrétien, humanitaire et pacifiste, communiste orthodoxe, trotskiste ou encore d'ultragauche » ? Effectivement. L'autre tiers-mondisme est l'expression par laquelle Philippe Baillet désigne tous ceux que l'on pourrait considérer comme tenants d'un « tiers-mondisme de droite » ou plutôt d'extrême-droite (même quand ceux-ci viennent ou sont d'extrême-gauche, à l'image d'un Soral).
L'autre tiers-mondisme est une sensibilité politique qui a, évidemment, évolué avec le temps mais qui s'appuie, dans son acceptation générale, sur certaines idées-clés. Le développement d'une Troisième Voie européenne hostile au communisme et à la démocratie parlementaire en est la base. En découlent logiquement le non-alignement sur les deux blocs (avant la chute de l'URSS) et l' « anti-impérialisme ». Sans surprise, l'incarnation de cette idée se fit donc, chez certains courants ou auteurs, à travers le fascisme ou le national-socialisme... Par ailleurs, « l'autre tiers-mondisme n'est jamais, même quand il s'enveloppe d'une sympathie sincère pour les cultures non occidentales, un internationalisme ». En effet, il « entend s'adresser à des peuples opprimés en respectant les spécificités de chacun ».
Bien antérieur à la conférence de Bandoeng (1955) ou à l'apparition du terme « tiers-monde » dans les dictionnaires, l'autre tiers-mondisme a toujours présenté un double visage. Le premier est politique et stratégique. Il prône l'alliance avec des forces du monde non occidental afin de lutter contre l' « impérialisme ». Il n'implique pas forcément d'attirance particulière pour les peuples du tiers-monde (un cas emblématique: Jean Thiriart) à la différence du second qui est avant tout idéaliste et métapolitique. Ici, l'on a beaucoup plus affaire à des personnalités pouvant être subjuguées par des aspects culturels ou spirituels non-européens, en particulier l'islam. On y trouve ainsi des convertis qui sont des figures de première importance de l'autre tiers-mondisme : Johann von Leers ou Claudio Mutti. Les idées dont l'ouvrage traite se retrouvent avant tout chez les « nationaux-révolutionnaires » mais pas seulement car elles sont le fruit d'une « mouvance, bien plus qu(e d') un phénomène très structuré ».
Sur ce sujet complexe mais ô combien instructif de l'histoire des idées, Philippe Baillet, connu pour être le traducteur français de nombres d'œuvres de Julius d'Evola et, plus récemment, l'auteur d'ouvrages remarqués (voyez ma chronique de son précédent livre : Le parti de la vie), a mené avec la rigueur qu'on lui connaît une étude en profondeur des acteurs, courants, réseaux et mouvements pouvant être rattachés à l'autre tiers-mondisme au sein de la droite radicale européen où celui-ci « a fait son chemin lentement mais sûrement ». Après avoir été longtemps minoritaire, il est devenu, de nos jours, un pan important des idées professées dans (ou autour de) nos mouvances. L'autre tiers-mondisme ne se limite cependant pas à cet aspect et se veut un livre militant qui, à partir de l'analyse des idées de l'autre tiers-mondisme, entend démontrer à quel point elles sont nocives dans le cadre du combat que nous, les nationalistes européens, menons. Le lecteur sera peut-être étonné par la longueur de cette chronique. Il y a deux raisons à cela : la grande richesse du livre que je ne fais ici qu'effleurer et l'importance de cette parution que j'estime fondamentale pour notre courant de pensée.
Un siècle d'autre tiers-mondisme
Baillet estime qu'on retrouve les premières traces de l'autre tiers-mondisme en Europe à Fiume, au lendemain de la Grande Guerre. Se voulant « l'épicentre de la révolution mondiale des peuples opprimés », y est créée La Ligue de Fiume qui dénonce le « trust mondial des Etats riches » qu'est la SDN. Assez peu présente au sein de l'Italie fasciste, c'est dans l'Allemagne des années vingt et trente que la tendance va poursuivre son chemin. On l'observe avant tout au sein de l'aile gauche du NSDAP et chez les nationaux-révolutionnaires (NR) qui en sont, souvent, proches. Deux personnages sont ici à mentionner : Johann von Leers et Friedrich Hielscher. Le premier se rallie au régime national-socialiste et y fera carrière « tout en conservant certaines caractéristiques typiques de l'aile gauche de la NSDAP » tandis que le second y est hostile et en viendra même à le combattre, ayant probablement mal supporté (comme beaucoup de ses camarades NR) de ne pas avoir réussi à faire plus de place à ses idées dans la nouvelle Allemagne... Il faut dire qu'Hielscher, qui avait publié en 1927 un appel aux peuples opprimés d'Asie et du monde arabe -vus comme alliés naturels du peuple allemand face au rationalisme et au culte de l'argent occidentaux- avait sans doute une différence d'appréciation dans la politique à mener envers les peuples non-européens par rapport à la doctrine nationale-socialiste. Si Hitler ou Rosenberg pouvaient, comme on le sait, professer des sentiments bienveillants envers telle culture étrangère ou tel peuple non-européen, la « défense de la race » étaient, pour eux, primordiale et passait bien avant toute considération « anti-impérialiste ». Ne lisait-on pas dans Mein Kampf l'affirmation suivante :
« En raciste qui se base sur la race pour estimer la valeur du matériel humain, je n'ai pas le droit de lier le sort de mon peuple à celui des soi-disant « nations opprimées » connaissant déjà leur infériorité raciale »
Rosenberg, quant à lui, « pressent(ait) qu'un jour le flot montant des peuples de couleur pourrait trouver une direction nette et une forme d'unité grâce à l'islam ». La citation suivant, relevée une fois encore par l'auteur, provient du Mythe du Xxe siècle:
« Face à cette haine des races bâtardes de couleur, conduites par l'esprit fanatique de Mahomet, qui s'allieront peut-être un jour, les races blanches ont plus que jamais toutes les raisons de prendre garde. » Prophétique comme dit Baillet !
Après 1945 et durant deux décennies, l'autre tiers-mondisme entre dans « le temps des réseaux ». Toujours ultra-minoritaire, cette tendance est portée par plusieurs personnages de la droite radicale européenne sur lesquels Philippe Baillet revient plus ou moins longuement : Johann von Leers à qui il consacre un long chapitre, François Genoud, aventurier et éditeur suisse haut en couleur, Maurice Bardèche et d'autres. A partir d'un examen détaillé de leurs écrits, l'auteur estime qu'ils faisaient « leur révolution par procuration à travers Nasser, le FLN algérien et un islam largement fantasmé » (il parle pour Bardèche d' « islam de salon fabriqué à Paris ») ; à l'instar de la gauche française qui, après 1968, a projeté « toutes ses attentes sur le Nouveau Monde latin » (de Guevara et Castro à Chavez). La critique de Baillet va plus loin : les personnages mentionnés oublient la dimension raciale du « fascisme du phénomène européen » et voient du fascisme là où il n'y en a pas (car le fascisme est européen martèle-t-il). Ils auront toutefois de nombreux continuateurs...
Dans les années 1960, l'autre tiers-mondisme, dans sa version politique et laïque, va prendre un réel essor et se structurer théoriquement parlant par l'action du belge Jean Thiriart. Pionnier dans ce domaine, il va développer grâce à ses écrits (dont les journaux « Jeune Europe » puis « La Nation Européenne ») et au mouvement politique « Jeune Europe » l'idée d'une Europe puissance, unitaire et communautaire. S'il prône l' « anti-impérialisme » et l'alliance des militants NR européens avec ceux du tiers-monde, sa vision reste strictement eurocentrique : « il fut très certainement celui qui alla le plus loin dans l'affirmation d'un autre tiers-mondisme politique, mais il fut aussi celui qui se montra le plus incurieux et le plus méprisant envers les peuples et cultures du tiers-monde ».
Thiriart et son mouvement eurent une influence non négligeables sur bien des militants (Christian Bouchet ou Claudio Mutti pour les plus réputés) et on retrouva cette postérité chez des organisations telles que 3ème Voie ou Nouvelle Résistance. En Italie, cette postérité fut un peu plus importante, favorisée par Claudio Mutti qui avait été l'un des principaux cadres de Jeune Europe dans ce pays ; citons par exemple le cas du quotidien « de gauche nationale » Rinascita (qui paraît toujours aujourd'hui). Quoi qu'il en soit, la haine des Etats-Unis (désignés comme « l'ennemi principal ») de Thiriart et ses thèses auront été une étape très importante du logiciel intellectuel et militant d'une certaine partie de la droite radicale européenne qui va désormais se désigner comme nationale-révolutionnaire (en Italie, ce terme s'appliquera justement à ceux ne se reconnaissant pas dans le MSI). Par ailleurs, il faut souligner que l'anti-américanisme de Thiriart était plutôt sommaire ; il sera par la suite fortement approfondi, en particulier au sein de la Nouvelle Droite...
Les idées relevant de l'autre tiers-mondisme se retrouveront également dans le « traditionnalisme-révolutionnaire », sorte de synthèse d'idées d'Evola, de Thiriart et de la gauche fasciste dont le principal organe en France fut la revue « Totalité » (publiée chez Pardès) à partir de 1977. Le soutien à des formes d'islamisme radical y est clair dans plusieurs numéros (auxquels Baillet a lui-même contribué, ayant eu des optiques quelque peu différentes à cette époque)... N'oublions pas l'impact qu'eût alors la révolution iranienne sur les milieux NR! L'attrait envers l'islam devint prépondérant chez certains des acteurs de ce courant, en particulier Claudio Mutti qui « illustre à la perfection les ravages que peut exercer la passion antijuive, y compris chez les plus cultivés et les plus intelligents ». Mutti s'est ainsi converti à l'islam et a abandonné toute forme de racialisme pour se rallier à une vision du monde universaliste (y voyant même une continuité avec le combat national-socialiste!)... Les militants d'aujourd'hui auront bien du mal à le comprendre mais l'islam, il y a trois ou quatre décennies, paraissait à certains un allié de choix. Baillet cite ainsi Alain de Benoist qui écrivait dans Eléments en 1985 que : « Le réveil de l'islam n'est pas à nos yeux une menace mais bien plutôt un espoir. » La passion anti-américaine a fait elle aussi des ravages...
L'auteur du Parti de la Vie examine également l'influence qu'a eu (et a encore) René Guénon. Souvent bien vu dans une partie de nos mouvances, ce converti, qui demanda même la nationalité égyptienne, n'en reste pas moins un auteur méprisant « l'Occident » (donc l'Europe) et idéalisant l'Orient. Aucun racialisme chez lui dont « bon nombre de vues (…) doivent être combattues sans modération ». Ayant contribué à l'entretien d'un climat islamophile en France et ailleurs, Guénon a eu beaucoup de continuateurs plus ou moins directs jusqu'à aujourd'hui. Baillet explore cet aspect culturel de l'autre tiers-mondisme en soulignant à quel point le « parti islamophile » en Europe est dangereux et difficile à combattre à cause de son « caractère polymorphe ». Ayant des ramifications partout (de la politique aux médiats en passant par l'administration et le monde universitaire), le « parti islamophile » voit l'immigration de peuplement comme inévitable et considère que l'implantation de l'islam est positive (quelles qu'en soient les modalités). L'islam a fasciné voire conquis plusieurs tenants de l'autre tiers-mondisme mais souvent pour de mauvaises raisons. Baillet, bon connaisseur de cette religion, revient sur ces errements dans un petit chapitre passionnant : il démonte l'idée de l'islam comme vecteur de virilité (argument souvent cité) et démontre que le double discours, le « mensonge par omission », la « tromperie active » sont des armes qui peuvent être couramment employées par les musulmans en accord avec leurs préceptes religieux et leur objectif de conquête...
Ces dernières années, bien des positions islamophiles liées à tort ou à raison à la droite radicale sont devenues monnaie courante dans ce que Philippe Baillet appelle le « philo-islamisme radical ». Celui-ci est généralement lié à un « sous-marxisme rustique typiquement tiers-mondiste » ou est « emprunt de complotisme à la faveur du développement exponentiel de la « foire aux Illuminés » ». Bien différent du « fascisme comme phénomène européen », ses traits principaux sont : une indifférence plus ou moins marquée envers la « défense de la race blanche », une « véritable passion antijuive » et anti-américaine, une grande hostilité à la finance et au capitalisme, une sympathie pour toutes les causes « anti-impérialistes » et pour l'islam comme religion ou civilisation (l'Islam dans ce cas). Que nous partagions certaines idées de ce courant ne nous en rend pas forcément proche, et je rejoins en cela l'auteur. Celui-ci souligne la diversion effectuée par cette sensibilité chez un grand nombre de personnes qui oublient par ce biais «la priorité absolue» en ce « moment capital de l'histoire de la civilisation européenne »: la perpétuation des peuples européens (de leur partie saine tout du moins). De Roger Garaudy, « illuminé christo-islamo-marxiste » à Carlos et son internationalisme en passant par le chantre de la réconciliation Alain Soral qui « s'inscrit parfaitement (…) dans la vieille tradition des chefaillons et Führer d'opérette chers à la droite radicale française », nombre de figures chères à la frange la plus islamophile de nos mouvances sont ici égratignées par Baillet qui n'a pas son pareil pour souligner leurs contradictions (quand Soral se prétend "national-socialiste français" par exemple)... ou rappeler à notre bon souvenir certaines énormités ou actes pas reluisants. Il souligne ainsi les tentatives d' « islamisation » de la « mouvance nationale » en prenant le cas d'une association telle que celle des « Fils de France » qui se veut un « rassemblement de musulmans français patriotes » et qui a reçu, entre autre, le soutien d'Alain de Benoist. Le philo-islamisme de ce dernier se manifeste depuis bien longtemps. Baillet rapporte d'ailleurs plusieurs citations de celui qu'il qualifie de « toutologue » à ce sujet! Plus ou moins récentes, elles permettent de mieux comprendre le personnage (voir plus haut)... Autant dire qu'on ne peut qu'aller dans le sens de Baillet lorsqu'il argue de l'étendue et de la diversité du « parti islamophile » en France. « Ce n'est pas du tout rassurant », en effet ! Le « parti islamophile » est bien enraciné et doit être combattu « sans faiblesse » partout où il se trouve. Un peu d'espoir cependant :
« Aujourd'hui, on peut penser que « l'autre tiers-mondisme » est voué à connaître, dans les milieux de la droite radicale européenne, un certain reflux, à cause des craintes légitimes engendrées par l'immigration de peuplement, l'installation durable de l'islam dans le paysage ouest-européen, le développement de l'islamisme radical, les crimes du terrorisme islamiste. »
Les Européens et leur survie
La dernière partie de l'autre tiers-mondisme a une dimension beaucoup plus militante. C'est un véritable appel à la résistance face à l'islamisation de notre continent et à son invasion. D'où la nécessité d'avoir étudié les différentes formes de l'autre tiers-mondisme et du « parti islamophile ». Philippe Baillet considère en effet que « la crainte ou la peur de l'islam (…) est parfaitement justifiée » mais le combat contre cette religion doit, avant tout, être mené dans une perspective identitaire, en démontrant toujours plus que l'islam est « incompatible avec l'héritage spirituel et culturel européen ». Il examine (et critique le cas échéant) pour cela les écrits de Guillaume Faye et de Renaud Camus, deux auteurs connus pour leur lutte contre l'immigration-invasion et le « grand remplacement ». Regrettant le rejet par le FN de ce dernier thème et donc le renoncement de fait à celui de la remigration, Baillet estime que ce parti ne peut parvenir au pouvoir légalement étant donné la part grandissante du poids représenté par le vote musulman en France (on peut illustrer la justesse de ce propos avec le cas récent de Londres ou celui, plus ancien, d'Anvers). Qu'a-t-on à attendre de la République française de toute façon ? Elle « n'est que l'affreux miroir grimaçant de la décadence ininterrompue et toujours aggravée du pays. » De plus :
« C'est une illusion de croire que l'on pourra sauver la France de l'islamisation en défendant un régime qui, depuis plus de deux siècles, a tout fait pour détruire chez les Français jusqu'aux dernières traces de conscience raciale. »
Face à l'uniformisation, à « l'effacement de toute humanité différenciée » et à « l'avènement définitif du métis planétaire », de « l'homme remplaçable, interchangeable, substituable à merci », qui sont en somme les « visées profondes du mondialisme », Baillet propose quelques pistes doctrinales, en premier lieu, il loue le « rôle socialement protecteur du préjugé » (thème qu'il explicite plus avant à partir des écrits des conservateurs anglo-américains, Burke en priorité) qui est l'un des « mécanismes de défense immunitaire collective », surtout en ce qui concerne la race. Sa défense est notre combat premier et même si le fait racial « fait de la résistance » par lui-même, le racialisme « ennemi absolu des mondialistes » doit être notre horizon.
« En effet, parce qu'il est radicalement anti-universaliste, le racialisme est seul à même d'assurer dans l'avenir le maintien de la diversité des races, des cultures et des peuples contre le rouleau compresseur de l'uniformisation. »
En France (mais le constat est le même dans le reste de l'Europe de l'Ouest), l'Etat est « illégitime, tyrannique et criminel », il étend en parallèle son emprise totale sur la vie des citoyens en usant en particulier de l'ingénierie sociale (l'auteur mentionne le très bon ouvrage Gouverner par le chaos), nous devons, en conséquence, absolument résister. En effet, « contre un pouvoir qui n'a plus pour lui que la légalité, l'insurrection s'impose », d'autant que « le pouvoir mondialiste ne renoncera à aucun de ses objectifs mortifères. » Il y met toute sa hargne comme sa propagande incessante et sa répression le démontrent. « La sous-humanité du petit bonheur » qu'il propose est un leurre mais les Européens fatigués, lassés « de vivre et de combattre » sauront-ils retrouver un mythe mobilisateur ? Je vous laisse découvrir l'avis de Baillet sur la question... Il ne vous laissera pas indifférent.
Conclusion
Ouvrage dont la double dimension -histoire des idées et optique militante- m'a fortement plu, je ne saurais trop conseiller la lecture attentive de l'autre tiers-mondisme. Ce livre éclaire, démythifie et dénonce bien des idées reçues (par exemple, le manque complet de reconnaissance que les musulmans ayant travaillé avec des membres de la droite radicale ont toujours professé à l'égard de ces derniers...). Il se fait fort de rappeler les fondements essentiels de notre combat et montre que bien des errements sont à corriger dans la "mouvance" (dans certaines de ses sensibilités tout du moins). Comment certains peuvent-ils encore vouloir frayer avec un islam qu'ils fantasment et qui est complètement contraire à ce que nous sommes? « Le Coran est parfaitement indifférent à la dimension raciale » rappelle Baillet. Certains n'avaient peut-être pas encore compris...
J'imagine que l'autre tiers-mondisme fera réagir, ce qui est normal, mais il serait bien malhonnête de mettre en doute le travail de Philippe Baillet qui a épluché une variété de sources immense et n'omet jamais de citer ses références. Pas comme d'autres...
Rüdiger / C.N.C.
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/
-
L'Europe des Celtes - De l'âge du bronze à l'âge du fer