culture et histoire - Page 1405
-
VL : Gilles Ardinat "comprendre la mondialisation en 10 leçons"
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -
Quand les services turcs tuent en plein Paris
Ce 9 avril le quotidien Le Monde faisait connaître une décision du 11 mars : le gouvernement français acceptait de déclassifier es documents émanant de nos services de renseignement à propos d'une affaire qui remet en cause les relations d'État entre la France et la Turquie. (1)⇓
L'assassinat, le 9 janvier 2013, rue Lafayette, à Paris, de trois militantes kurdes pose en effet plusieurs problèmes, que l'on devrait examiner séparément. Depuis septembre 2014 le magistrat instructeur demande cette déclassification dans ces termes : « L’enquête judiciaire,écrit-elle, a mis en évidence que l’un des mobiles les plus plausibles de ce triple assassinat pouvait être mis en relation avec les activités supposées d’Omer Güney [le "tireur présumé" précise Le Monde] en France au sein des services secrets turcs (MIT). »
L'aspect le plus grave, du point de vue français, nous ramène en quelue sorte à l'énorme indignation que remua en son temps l'affaire Ben Barka, en 1965. La même question, 50 ans plus tard, est rappelée par l'avocat des victimes, Me Antoine Comte : « le silence de la France sur ces crimes reviendrait à accorder à des États étrangers le droit de tuer sur le sol français en toute impunité, et nous serions fous de croire que cela ne se reproduirait pas ».
Il y a un demi-siècle la liquidation sur notre sol d'un opposant marocain fut considérée comme un scandale d'État. Ceci avait conduit à la réforme de l'organigramme des services spéciaux français. Aujourd'hui, rien jusqu'ici.
Ne dissimulons pas qu'à quelques jours du Centenaire du génocide arménien de 1915, c'est aussi le rôle de plus en plus trouble du gouvernement turc dans les affaires du proche-orient qui se trouve visé.
D'autre part, en 2013, les trois victimes, Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leyla Söylemez ont été tuées par balles au siège du Centre d’information du Kurdistan. Lié au PKK, cet organisme pose évidemment un problème inhérent à toutes les luttes de libération. Le"parti des travailleurs du Kurdistan", en tant que tel, a été classé parmi les organisations terroristes par l'Union européenne. On ne saurait en dire autant de tous les sympathisants de la cause kurde, auxquels l'État turc, jusqu'à une date récente, n'offrait aucune possibilité d'expression légale.
Le tribunal de grande instance de Paris, le 24 mars, jugeant une affaire mettant en cause des membres du PKK, a précisé – curieuse justice – dans une déclaration liminaire"que l’on devait désormais tenir compte de l’action du PKK contre l’État islamique".
L'État turc l'entend si peu de cette oreille qu'il déclare très officiellement considérer la révolte kurde, avec laquelle il cherche à négocier en position de force, comme plus dangereuse que l'État islamique. En 2014 au parlement d'Ankara un député kémaliste a même diffusé des documents tendant à prouver un soutien des services secrets turcs aux islamo-terroristes. Depuis lors l'ambiguïté de la participation d'Erdogan à la coalition anti "État islamiste" ne s'est jamais démentie. On a même pu présenter le nouveau patron du MIT comme "le contact de Daesh à la tête des services secrets". (2)⇓
La France et l'Europe peuvent certes exiger des exilés établis dans nos pays qu'ils y observent les lois. Mais on ne peut admettre que les services secrets d'Ankara viennent régler leurs comptes sur notre sol.
Or, depuis janvier 2013, l'identité du meurtrier des trois femmes Kurde est pratiquement établie. Il s'agit d'un nationaliste turc Omer Güney, aujourd'hui âgé de 32 ans. Il a été mis en examen dès le 21 janvier, "pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste" et se trouve toujours en détention provisoire en France. Arrivé dans notre pays en 2011, après avoir résidé huit ans en Allemagne, se prétendant faussement kurde, il s'était infiltré parmi les militants de cette cause. On a pu établir, entre autres preuves de son infiltration, qu'il avait transféré 329 photos de fiches d'adhérents d'une association, photographiées sur son téléphone mobile durant la nuit qui a précédé les assassinats.
Depuis le 13 janvier 2014 on a connaissance d'un document confidentiel du MIT, service secret turc : un ordre de mission. La lettre, datant de 2012, deux mois avant le triple meurtre, fait la synthèse des informations recueillies auprès du « légionnaire », nom de code d'Ömer Güney. La démarche du MIT s'inscrit « dans l'objectif de déchiffrer les activités du PKK à Paris et en France, et de rendre inactifs les hauts membres de l'organisation. »
Depuis 3 ans, on sait de façon quasi officielle que des tueurs du MIT sont susceptibles d'opérer impunément dans nos pays.
Plus de deux années se sont écoulées depuis l'assassinat de trois femmes en plein Paris. On commence à voir poindre l'information, en relation avec le malaise de la participation officielle d'Ankara à la coalition anti-terroriste.
Dans mon livre sur "la Question turque et l'Europe" (3)⇓ je crois avoir démontré le caractère permanent de cette ambiguïté, que j'appelle la "diplomatie de la chauve-souris". Elle rend impossible l'appartenance de ce pays à l'Union européenne. Il semble grand temps d'en tenir compte.
Et pour commencer il est temps que cessent les exactions des services turcs sur notre territoire.
JG Malliarakis
Apostilles
- cf. Le Monde en ligne 09.04.2015 à 16h32… "Une enquête met en cause les services secrets turcs" ⇑
- cf. Présent N° 8295 du 17 février 2015. ⇑
- cf. "La Question turque et l'Europe" que l'on peut se procurer en ligne sur la page dédiée des Éditions du Trident ou en adressant par correspondance un chèque de 20 euros franco de port aux Éditions du Trident, 39 rue du Cherche-Midi, 75006 Paris en mentionnant le titre du livre commandé. ⇑
→ Pour être tenu au courant de nos chroniques, il suffit de s'inscrire à la liste de diffusion de L'Insolent en adressant un message à : <courrier.insolent-subscribe@europelibre.com>
http://www.insolent.fr/2015/04/quand-les-services-turcs-tuent-en-plein-paris.html
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -
Trouble Makers - 1534
-
"La Prison" du goupe Insurrection
-
Histoire : République et démocratie en France, une histoire troubleNotes :
Quiconque a un peu de culture politique sait que « République » et « démocratie » ne sont pas des termes synonymes et interchangeables. La République populaire de Chine, la République de Cuba ne sont pas démocratiques. A contrario, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Danemark sont des monarchies démocratiques. Il n’est même pas besoin d’aller chercher les exemples à l’étranger : la Première République ne fut pas démocratique (1) ; alors que le Second Empire fut démocratique (bien que les élections furent sévèrement encadrées).
La République moderne française, née en 1870 (ou 1875 selon l’importance accordée à l’amendement Wallon) était-elle aussi parfaitement démocratique ? L’Histoire montre que si ce régime puise sa légitimité du suffrage universel, les républicains ont été plus d’une fois mal à l’aise avec le principe démocratique. C’est l’historien et sociologue Pierre Rosanvallon qui pose la question : « les républicains sont-ils philosophiquement vraiment des démocrates ? ». Il répond : « Le doute secret [sur la supériorité intrinsèque du suffrage universel] qui travaille en profondeur la foi des pères fondateurs [de la IIIe République] ne procède pas seulement d’une déception devant l’ingratitude des masses, il plonge aussi ses racines dans un indéniable dualisme philosophique de la pensée républicaine » (2).
Philosophiquement, ces pères fondateurs étaient tiraillés entre l’exigence de la rationalité (qui ne saurait se retrouver dans les masses, sujettes à l’émotion, en partie irrationnelles) et l’exigence de l’égalité politique (la démocratie : un individu, un vote). D’un côté Voltaire (la raison), de l’autre Rousseau (la souveraineté populaire).
Ces contradictions se traduisent dans des actes. En 1884, pour mettre fin à la hantise d’une restauration royale ou impériale par la voie des urnes, les républicains procèdent à une révision constitutionnelle (à l’initiative de Jules Ferry). A cette époque, les républicains ne sont réellement au pouvoir que depuis 1879 (Chambre, Sénat et présidence de la République), et ils ont face à eux une opposition royaliste et bonapartiste qui demeure solide. L’article 2 de cette révision constitutionnelle indique : « La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision ».
Cela revient à mettre la République au-dessus du suffrage universel, à l’abri des masses électorales. Le lien entre République et démocratie est rompu ; ce qui fait alors les choux gras des conservateurs. Si la République est au-dessus du suffrage universel, obligatoire et non négociable, alors quelle est la source de sa légitimité ? Le député bonapartiste Paul de Cassagnac parlera ironiquement de « République de droit divin ».
Un autre exemple de la méfiance des républicains à l’égard du suffrage universel tient dans le référendum. Quoi de plus démocratique que le référendum ? Pourtant, après mai 1870, les Français devront attendre la Ve République, soit près d’un siècle, pour le voir réapparaître. Utilisé par Napoléon III, il fut longtemps perçu comme un instrument du césarisme par les républicains. De plus, la plupart des républicains, tel Jules Simon, considèrent la représentation parlementaire comme un « filtre » nécessaire entre une masse électorale jugée quelque peu irrationnelle, mouvante, imprévisible, et la question à trancher (l’exigence de la raison déjà évoquée). Paradoxalement, dans la Chambre des députés de la IIIe République, ce sont les conservateurs non-républicains qui défendent l’usage du référendum.
Si le référendum est absent des usages de la IIIe République au niveau national, quelques référendums locaux se tiennent à la fin du XIXe siècle. La municipalité de Cluny questionne ainsi ses habitants en 1888. Le conseil municipal avait été élu notamment sur la promesse de ne créer aucun impôt nouveau et de ne faire aucun emprunt ; cependant la ville souhaitait obtenir du ministère de la Guerre un bataillon d’infanterie et construire un casernement pour l’abriter. Les clunisiens sont appelés à trancher la question financière. D’autres municipalités, souvent conservatrices, suivent l’exemple de Cluny, ce qui amène le ministre de l’Intérieur à adresser aux préfets une circulaire leur enjoignant de prononcer de nullité tout appel des conseils municipaux au référendum. A la Chambre des députés, un projet de loi permettant les référendums locaux est déposé en 1890 par un bonapartiste rallié aux orléanistes, le baron de Mackau (un des chefs du groupe parlementaire de l’Union des droites, avec Piou et de Cassagnac). Le projet de loi est repoussé par la majorité républicaine.
D’autres exemples, moins importants historiquement mais significatifs, pourraient être donnés (décret du 31 janvier 1871, interdiction des candidatures multiples en 1889 lors de l’épisode Boulanger, etc.).
Mais au-delà des exemples donnés, remarquons que, tout au long de l’Histoire de la République, le pouvoir a cherché à canaliser l’expression du suffrage universel, jugé potentiellement dangereux. Historiquement, trois moyens principaux peuvent être dégagés :
Le mode de suffrage (indirect – pour l’élection du Sénat par exemple – ou direct),
Le mode de scrutin (proportionnel ou majoritaire à un tour, à deux tours),
Les conditions requises pour être électeur et éligible (autrefois le cens, le domicile ; aujourd’hui la question du droit de vote des étrangers) (3).
Des moyens plus anecdotiques furent utilisés, comme les redécoupages de circonscriptions (toujours d’actualité), ou le changement du lieu de vote (sous la IIIe République, voir note 4).
Ainsi, avec la même opinion publique, les assemblées et conseils élus peuvent se trouver d’une composition radicalement différente. Les dernières élections départementales viennent récemment de le démontrer une nouvelle fois, par l’écart entre le nombre de suffrages en faveur du Front National et le nombre d’élus de ce parti.Aetius
Notes :
(1) Même après la Terreur, le mode de scrutin à degrés et l’absence totale de campagne électorale interdisent de qualifier cette République de « démocratique » au sens moderne du terme.
(2) Pierre Rosanvallon, Le Sacre du citoyen, p. 452 de l’éd. de poche.
(3) Sous la IIIe République, la révision constitutionnelle de 1884 interdit aux membres des familles ayant régné sur la France de briguer les suffrages (afin d’éviter l’apparition d’un nouveau Louis-Napoléon Bonaparte). Dans la première moitié du XXe siècle, la réticence de la gauche à accorder le droit de vote aux femmes s’explique en partie par la crainte d’un vote à droite de leur part.
(4) En 1871, le lieu de vote fut transféré, par le gouvernement républicain de Défense nationale, de la commune au chef-lieu de canton. Cela avait pour effet d’écarter du vote une partie des paysans, ceux-ci votant généralement pour des royalistes ou bonapartistes (il fallait parfois trois heures de marche pour aller au chef-lieu et autant pour revenir à la commune, de quoi en dissuader plus d’un, notamment les vieillards et malades).
http://www.fdesouche.com/587819-histoire-republique-et-democratie-en-france-une-histoire-trouble
-
Insurrection - Société de supermarché
-
Passé Présent n°48 - Mannerheim, la Finlande face aux Rouges
-
Lucien Cerise à Lille les 30 et 31 mai 2015 (E&R Lille)
Atelier de ré-information active le 30 mai 2015 à 15h :
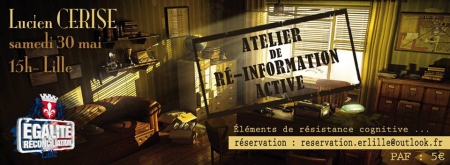
Conférence : "Libérale et sécuritaire, la gauche liberticide" le 31 mai à 14h :
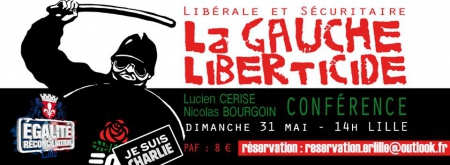
Note du C.N.C. : Nous remercions E&R Lille d'avoir organisé son programme pour permettre aux dissidents qui le souhaitent de participer à la conférence que nous organisons le 30 mai à 19h00 avec Alain de Benoist.
-
Les croisades n’ont rien à voir avec le djihad
Pour ceux qui ont encore quelques doutes, voici une petite vidéo qui remet les idées en place (et il y aurait bien d’autres choses à dire).
Une vidéo de l’américain Bill Warner, propriétaire du site Political Islam :Source : NDF
-
Après l'UMP, «Les Républicains» : savent-ils encore ce qu'est la République ?
L'historien Louis Manaranche analyse le choix de Nicolas Sarkozy de changer le nom du mouvement. Il rappelle la signification profonde du terme républicain.
La République. Il n'est sans doute aucun autre concept qui, dans l'histoire de France, aura tant passionné, déchiré, puis rassemblé. Transposition en français du concept latin de res publica, traduit habituellement par «bien commun», celui-ci désignait originellement ce qui, dans un corps politique, doit être recherché comme le bien de tous. Le Moyen-âge en a fait grand usage, sans jamais cliver autour de la forme du régime, considérée d'un autre ordre. De même, après la Renaissance, Bodin la définissait encore en 1576 comme le «droit gouvernement de plusieurs ménages et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine».
C'est la Révolution française qui allait consacrer le sens donné à la République de corps politique sans roi, gouverné par des représentants du peuple. À la suite de la République anglaise - le Commonwealth de Cromwell, en 1649 - et de l'affirmation républicaine de l'indépendance américaine, en 1776, les Français ont adopté en 1792 une forme de régime dont la matrice est l'opposition au pouvoir monarchique, volontiers ramenée à une «tyrannie». En cela, ils se faisaient les héritiers de la Rome antique, où tout pouvoir personnel était une menace supposée envers l'harmonie civique. D'harmonie autour du sentiment républicain, il n'y en eut pourtant guère durant les années révolutionnaires. La République s'est rapidement érigée comme une entité absolue qui exigeait le consentement total à l'ordre nouveau. «Unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort» proclamaient alors estampes et gravures. Il a fallu l'épisode bonapartiste et impérial pour que la concorde revienne et plus d'un siècle et demi pour que la République soit l'objet d'un réel consensus massif. Cela a été rendu possible par la diffusion profonde des symboles et rites républicains au long des années, notamment durant la Première guerre mondiale. Néanmoins, c'est aussi la conséquence d'un élagage du concept initial. La République a paradoxalement puisé davantage, au fil des années, dans les principes de 1789 que dans ceux de 1793. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, l'abolition des privilèges ou encore la fête de la Fédération, ont été heureusement préférées à Robespierre et à Turreau. De même, les principes traditionnels de respect de l'autorité légitime, d'attachement à la famille, à la culture et à la foi de ses aïeux, d'amour des terroirs, ont été admis dans l'enceinte républicaine, où ils été associés à la liberté, à l'égalité et à l'émancipation. Sans cette lente maturation, un homme comme de Gaulle n'aurait pas été compté parmi les républicains. La Ve République elle-même, donnant une autorité forte à son président, aurait été considérée comme une tromperie.
Cette évolution a néanmoins eu un pendant négatif. Depuis les années 1980, les tenants de la déconstruction de tout ce qui fonde une culture et une identité communes, ceux à qui l'idée même de nation est insupportable, ceux qui sont prompts à ramener toute fidélité à la réaction, donnent trop volontiers l'adjectif «républicain» à leur démarche d'exclusion. Dire «républicain» est devenu une manière de ne jamais dire «français». La République a ainsi servi de prétexte à un refus de transmission délétère pour la République elle-même: ses plus récents enfants ont été trop souvent empêchés de recevoir ce qui a fait la France sous prétexte de républicanisme. Cette forme dévoyée de république, qui confond accueil de la culture de l'autre et maelström multiculturel, laïcité et amnésie, émancipation et culte de l'individualisme, a puissamment contribué au délitement du lien dans la Cité, pierre d'angle de tout projet politique.
Ainsi, se dire républicain aujourd'hui ne peut être qu'un défi. Il s'agit d'abord de reconnaître tout ce que la France doit à la République. Il s'agit ensuite de mettre la quête d'un bien commun - qui n'est pas le banal «intérêt général» - au coeur de nos attitudes civiques et politiques. Il s'agit enfin de voir dans la République le régime et l'attitude collective qui permet à la France de mieux exprimer son génie propre. Ne pas prendre la mesure de l'ambition d'un tel projet serait un grand pas en avant dans l'immense discrédit dont souffre la parole politique.notes
Louis Manaranche est agrégé d'histoire et président du laboratoire d'idées Fonder demain. Son livre «Retrouver l'histoire» vient de paraître aux éditions du Cerf.
Le Figaro :: lien