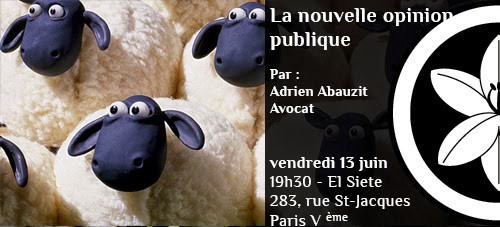Jean de Rouen est l’auteur d’Apprendre à penser à l’école du réel, initiation à la philosophie (que nous avions évoqué ici, et qui est disponible ici).
Nous reproduisons ci-dessous l’entretien qu’il a donné au site NDF :
Jean de Rouen, pensez-vous, en écrivant une initiation à la philosophie, que la philosophie soit destinée à tous ?
La philosophie est un exercice naturel à l’intelligence humaine. « Tous les hommes désirent naturellement savoir », observe Aristote en exergue de sa Métaphysique. N’est-ce pas ce dont témoigne le questionnement intarrissable de l’enfant ? L’homme est en effet un « animal raisonnable » : il est donc fondamentalement en quête de sens. Or, c’est précisément la philosophie qui portera à son aboutissement la réflexion qui se trouve en tout homme. D’ailleurs, notre manière de vivre, à elle seule, induit une philosophie : c’est dire à quel point il est difficile d’y échapper.
Si la philosophie est naturelle à l’intelligence humaine, pourquoi a-t-on souvent l’impression qu’elle est réservée à une élite ?
Pour chaque réalité naturelle, la philosophie recherche l’explication la plus ultime. En ce sens, la philosophie est la plus élevée des sciences. Elle aborde des vérités universelles, non sensibles, qui ne nous sont pas familières parce qu’elles sont les plus éloignées de notre expérience. Aristote nous avise, dans la Métaphysique, que notre esprit se tient, devant les objets les plus élevés de la philosophie, aveuglés comme les yeux d’une chouette devant le soleil.
Cela explique le découragement que peut ressentir l’intelligence devant une science aussi exigente. Un découragement souvent accru car l’on entend trop souvent affirmer, au regard des contradictions qui subsistent dans le domaine des idées, que l’intelligence n’est finalement pas faite pour atteindre des vérités certaines et définitives. Mais affirmer qu’il n’y a pas de vérité, n’est-ce pas déjà affirmer une vérité ?
Ne faut-il pas adopter une certaine attitude intellectuelle pour entrer en philosophie ?
La relation que l’intelligence entretient avec le monde extérieur est le creuset d’où jaillit son questionnement. Lorsque l’intelligence affronte le réel, les interrogations qu’elle formule supposent et révèlent son étonnement face à des réalités qui semblent d’abord lui échapper. Ces réalités sont de tous ordres : anthropolgique, éthique, politique, métaphysique, artistique. Il reste que les choses ne répondent qu’aux questions qu’on leur pose : si ces réalités n’éveillent pas d’abord notre curiosité et ne provoquent pas notre questionnement, nous ne progresserons jamais dans leur connaissance. Il faut donc apprendre à s’émerveiller face au réel ! Cette admiration que nous portons sur les choses maintient l’intelligence en éveil. Ensuite, la philosophie s’emploiera à apporter à nos interrogations la plus haute explication susceptible d’étancher notre soif de connaître.
N’est-ce pas orgueilleux de se prétendre philosophe ?
Au contraire ! Etymlogiquement, la philosophie signifie l’amour de la sagesse : or, on est toujours privé de ce à quoi l’on aspire. C’est Pythagore qui sera le premier à utiliser le terme de philosophie : alors que ses contemporains le qualifiaient de sage, il récusa lui-même cette appellation, se présentant plus modestement comme un ami de la sagesse.
Socrate lui-même, lorsqu’il affirme « Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien », est parfaitement philosophe ! Car il affirme par là qu’il est à la recherche de la vérité : il ne prétend pas la posséder. En ce sens, il est davantage philosophe, c’est-à-dire amoureux de la vérité, que sophiste, c’est-à-dire possesseur du savoir.
En même temps, pas davantage le savant qui sait déjà ne recherche le savoir, pas davantage l’ignorant qui ignore ce dont il est privé ne le recherche… Le philosophe est donc tout à la fois savant et ignorant : car il ignore et il sait qu’il ignore. Cette prise de conscience est le point de départ de toute recherche philosophique loyale et désintéressée.
Vous consacrez également, dans votre ouvrage, une partie à la logique et à la méthodologie ? Sont-elles réservées aux étudiants ?
Non. Pour entamer une démarche philosophique honnête, l’intelligence doit d’abord adopter certaines dispositions dont se font notamment l’écho les exigences méthodologiques auxquelles un étudiant doit faire face.
Ainsi, pour obtenir les bonnes réponses, il faut d’abord poser les bonnes questions : c’est tout l’art de la problématisation. Celle-ci traduit l’étonnement du philosophe face à un aspect du réel mis en lumière dans le sujet : une bonne problématique suscite une curiosité pour le sujet et rend intellectuellement disponible l’interlocuteur ou le lecteur. Poser un problème, c’est finalement provoquer l’intelligence afin de lui arracher une délibération : lorsqu’elle se heurte à une difficulté et qu’elle s’emploie à la surmonter, elle est alors excitée à développer un discours qui fait progresser la connaissance.
Une autre exigence dans l’art de penser consiste à conceptualiser, c’est-à-dire définir ce dont on parle avant d’en parler ! Il n’est pas rare, dans une discussion, d’employer les même mots sans leur faire recouvrir la même signification : on ne parle plus alors de la même chose. Dans l’Antiquité grecque, les sophistes tiraient profit des mots mal définis, les vidaient de leur signification intellectuelle, et pouvaient alors affirmer tout et le contraire de tout… Socrate, en réhabilitant le sens de la définition, réhabilitera le sens de la vérité : face aux sophistes, il apparaîtra comme le médecin des intelligences malades et rongées par le scepticisme. La philosophie est sauvée.
http://www.contre-info.com/la-philosophie-est-elle-destinee-a-tous-entretien-avec-jean-de-rouen#more-32963