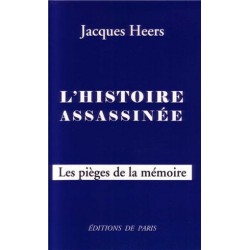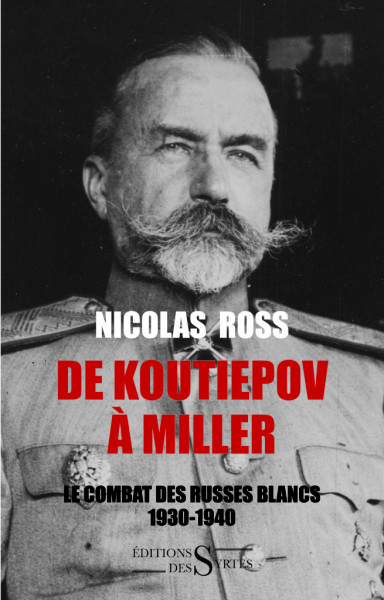La nature du soulèvement carliste ne compte guère d’autre précédent que celui des guerres de Vendée et de la Chouannerie mais elle se colore d’une teinte supplémentaire, celle de « l’illustration lyrique » dont on relèvera longtemps les traces dans d’autres révoltes et d’autres guérillas, de la guerre civile de 1936 aux maquis d’Amérique latine des années soixante. Dolorès Ibarruri, la pasionaria du frente popular de 1936 se revendiquera toujours d’un certain atavisme carliste.