Le célèbre Vercingétorix du grand maître Camille Jullian doit aller dans toutes les bibliothèques de qualité. On verra par l'article de Marcel Brion l'intérêt de la personnalité du jeune chef gaulois. Elle permet un saisissant rapprochement avec notre temps. Elle montre - quelle leçon pour aujourd'hui - la France souvent vaincue par elle-même. Comme le dit Marcel Brion, la stratégie gauloise était périmée, et périmée aussi cette passion pour la liberté qui leur faisait préférer l'anarchie et la discorde à l'établissement d'un gouvernement durable. La foi religieuse, elle non plus, n'animait plus suffisamment ce peuple.
culture et histoire - Page 454
-
Vercingétorix ou la gloire des vaincus
-
Les idéologues des Lumières n’ont jamais cru en l’égalité du genre humain
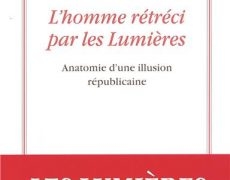
Chaque jour dans les médias, sur la scène politique et dans notre enseignement, l’on entend dire que les “Lumières”, fierté française, ont découvert et apporté à l’univers l’idée majeure d’une unité du genre humain. Exorbitante anomalie : car c’est l’inverse ; mettant en doute cette unité, en réalité elles ont disloqué la famille humaine, ou obstinément incliné à le faire.
-
Comparer la terreur talibane à "la grande clarté du Moyen-Âge" ? Une grande stupidité...

Comparer l'Afghanistan des Talibans et notre grandiose et magnifique Moyen-Âge, comme on le fait si facilement un peu partout, en ce moment, c'est tout simplement une stupidité désolante. Une insanité...
Notre Moyen-Age chrétien c'est l'amour courtois et les Troubadours, les enluminures et les débuts de la peinture, la chevalerie, les cathédrales, les Universités et bien d'autres grandes choses encore, bien loin de tous ces "rétrogrades", "primitifs" et "obscurantistes" effrayants que sont ces barbus sales et laids, qui font "peur" et provoquent, instinctivement, un sentiment de recul, de rejet, de dégoût...
Afin d'alimenter le débat, et nourrir la réflexion, nous redonnons ci-après notre Grands Textes 44, constitué de l' "Avant-dire" et de l' "Avant Partir" du merveilleux ouvrage de Gustave Cohen, La grande clarté du Moyen-Âge...:
GRANDS TEXTES (44) : La grande clarté du Moyen-Âge, par Gustave Cohen
Historien médiéviste, Gustave Cohen est né à Saint-Josse-ten-Noode le 24 décembre 1879 et mort à Paris le 10 juin 1958
-
6 février : à bas les voleurs
Place de la Concorde, dans la nuit de l'hiver où se détachent deux autobus qui brûlent, quatorze morts et quarante blessés gisent sur le pavé de Paris. En ce 6 février 1934, un régime aux abois a fait tirer sur la foule.
Foule protestataire, où se cotoient Anciens Combattants, militants des ligues nationales et Parisiens exaspérés par accumulation des scandales, qui révèlent à quel point le régime est corrompu, pourri jusqu'à la moelle.
-
Le réalisme politique : un art de l'action (Nicolas Machiavel)
-
JEAN MARKALE
"Le renouveau du celtisme est une richesse pour tout le monde"
Reconnu comme l'un des spécialistes français du monde celtique Jean Markale a publié plus de 80 ouvrages qui nous conduisent à la découverte d'un passé qui semble revenir sur le devant de la scène. Avant de nous recevoir, Jean Markale a tenu à préciser qu'il ne partage pas les thèses ou opinions du Front National, et même qu'il se situe aux antipodes de sa doctrine. C'est donc par esprit de tolérance et par volonté de dialogue qu'il a répondu à nos questions sur le celtisme, et que, de notre côté, nous lui donnons la parole !
-
La Première Guerre mondiale ne s’est pas terminée le 11 novembre 1918 – Explications avec Bernard Lugan

C’est en effet le 25 novembre 1918, 14 jours après la signature de l’Armistice du 11 novembre, que les derniers combattants allemands déposèrent les armes. Loin des fronts d’Europe, en Afrique, où, commandés par le général Paul-Emil von Lettow-Vorbeck, ces irréductibles invaincus avaient résisté quatre ans durant à 300 000 Britanniques, Belges, Sud-africains et Portugais.
Au mois de janvier 1914, quand il débarqua à Dar es Salam, la capitale de l’Est africain allemand, en dépit d’une considérable infériorité numérique et matérielle, le colonel von Lettow-Vorbeck, nouveau commandant militaire de la colonie, était bien décidé, en cas de guerre, à ne pas se contenter de livrer un baroud d’honneur. Son but était en effet de soulager les forces allemandes qui seraient engagées sur les fronts européens en obligeant les Alliés à maintenir des dizaines de milliers d’hommes en Afrique de l’est.
-
Trois Europe, trois pays 2/2
L’État soviétique fut très fort mais tout le monde sait, aujourd’hui, quelle fut sa triste fin. Je note avec inquiétude tous les signes d’engourdissement de notre État et j’observe avec envie la vie politique orageuse, tempétueuse, de l’Europe orientale : Pologne, Roumanie, Ukraine. Vraiment, il y a deux Europe. La première est celle des pays où les sentiments nationaux demeurent aigus, où l’énergie non épuisée des peuples trouve à se manifester vers l’extérieur. Et puis, il y a celle où les sentiments sont émoussés, où règne l’apathie, l’indifférence et le je-m’en-fichisme.
-
Livre : Hurrah Raspail ! Hommages, témoignages & études, sous la direction d’Adrien Renouard et Anne Letty
Il y a un peu plus d’un an, le 13 juin 2020, s’en allait, au Septentrion éternel, par-delà les mers, Jean Raspail, consul général de Patagonie, autoproclamé dans cette dignité par décision souveraine de Sa Majesté Orélie-Antoine de Tounens, roi d’Araucanie et de Patagonie.
-
Champs de bataille : 1915, La bataille du Vieil Armand

A l’égal des plus beaux noms de victoires, l’Hartmannswillerkopf résonne comme un écho de tous les héroïsmes français lors de la Grande Guerre.
Le 21 décembre 1915, des dizaines de soldats Français montent à l’assaut du sommet d’un promontoire rocheux dominant la plaine d’Alsace, Belfort et Mulhouse: l’Hartmannswillerkopf pour récupérer l’Alsace et la Lorraine. Baptisé Vieil-Armand par les Français, l’Hartmannswillerkopf fut dénommée par les survivants « La mangeuse d’hommes » :
