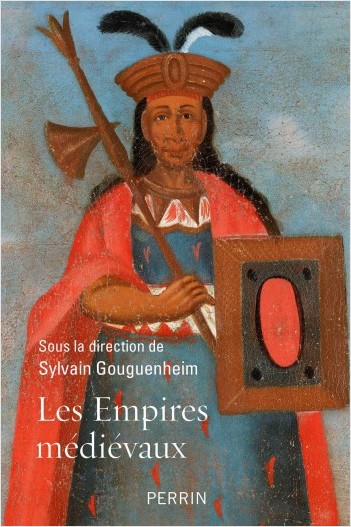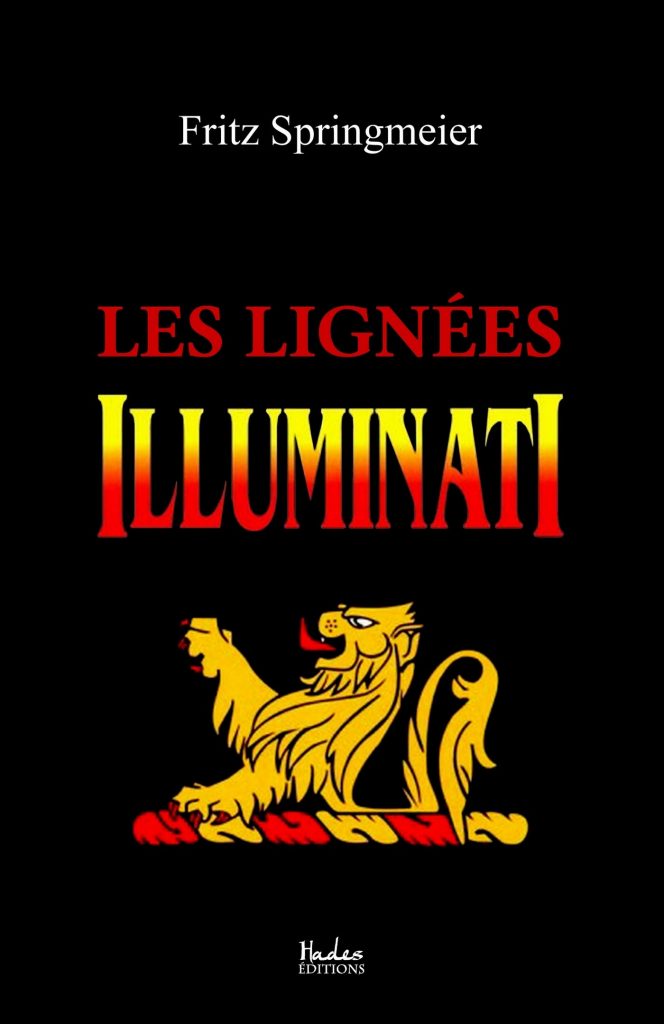(Charles VI, pris de folie, attaque son frère dans la forêt du Mans. Chronique de Monstrelet. Source : Herodote.net )
Cet article a fait l’objet d’une parution sur le site d’information Vexilla Galliae.
« Et si le roi était fou ? Comment ferions-nous ? » Vous connaissez tous cette ritournelle. Royalistes, on vous l’a souvent servie pour vous placer, pensait-on, devant les contradictions de vos beaux systèmes. Républicains, vous avez toujours pensé une fois à cette possibilité, vous disant qu’au moins on pouvait se débarrasser d’un mauvais président, mais pas d’un roi fou.
La réponse royaliste toute trouvée est de dire que l’institution royale est assez solide et vertueuse pour suppléer à la folie du roi. L’histoire vient au secours du débatteur, lui rappelant qu’en quinze siècles, la royauté française n’aurait connu qu’un seul roi fou, Charles VI.