
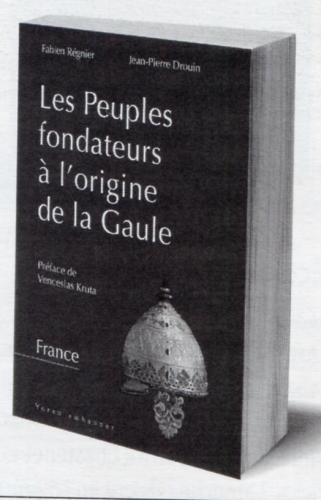 La présence sous-jacente du monde celtique antique ne s'est jamais limitée à la Gaule, mais concerne une bonne vingtaine de pays actuels. Pour apprécier les faits antérieurs à la conquête romaine, il faut donc remonter très haut pour découvrir l'origine des peuples gaulois, dont les auteurs anciens (Hérodote, Plutarque, Appien, etc.) indiquent qu'ils ne formaient pas moins de 300 à 400 « nations ». C'est à ce travail de fourmi que se sont attelés Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avec un résultat vraiment impressionnant, car ce ne sont pas seulement les peuples les plus connus (Sénons, Eduens, Arvernes, Rèmes, Cénomans, Allobroges, Bituriges, Vénètes, Sequanes, Lingons, Volques, etc.), mais des centaines de tribus d'origine celtique qui sont ici recensées, présentées et minutieusement étudiées. En dehors des spécialistes, qui connaissait jusqu'à présent les Viducasses, les Abrincates, les Calètes, les Diablintes, les Lexoviens, les Vellaves, les Tarusques, les Nitiobrogés, les Elusates, les Médules, pour ne citer que ceux-là, dont la mémoire a surtout été conservée par la toponymie ? Grâce à cet ouvrage monumental, on en apprend beaucoup sur eux. D'autant qu'au dictionnaire proprement dit s'ajoute tout un appareil de références, de cartes et d’index propre à satisfaire les plus exigeants. « Le XIXe siècle, écrivent Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avait tenté de nous convaincre que l'essentiel de notre héritage était dû aux bienfaits de l'intégration de la Gaule dans l'orbite de Rome ». La Gaule étant déjà fortement celtisée à la fin de l’Âge du Bronze, il faut désormais regarder plus loin vers une civilisation celtique apparue au IIe millénaire av. notre ère, dont les peuples fondateurs des terroirs de la France furent les héritiers.
La présence sous-jacente du monde celtique antique ne s'est jamais limitée à la Gaule, mais concerne une bonne vingtaine de pays actuels. Pour apprécier les faits antérieurs à la conquête romaine, il faut donc remonter très haut pour découvrir l'origine des peuples gaulois, dont les auteurs anciens (Hérodote, Plutarque, Appien, etc.) indiquent qu'ils ne formaient pas moins de 300 à 400 « nations ». C'est à ce travail de fourmi que se sont attelés Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avec un résultat vraiment impressionnant, car ce ne sont pas seulement les peuples les plus connus (Sénons, Eduens, Arvernes, Rèmes, Cénomans, Allobroges, Bituriges, Vénètes, Sequanes, Lingons, Volques, etc.), mais des centaines de tribus d'origine celtique qui sont ici recensées, présentées et minutieusement étudiées. En dehors des spécialistes, qui connaissait jusqu'à présent les Viducasses, les Abrincates, les Calètes, les Diablintes, les Lexoviens, les Vellaves, les Tarusques, les Nitiobrogés, les Elusates, les Médules, pour ne citer que ceux-là, dont la mémoire a surtout été conservée par la toponymie ? Grâce à cet ouvrage monumental, on en apprend beaucoup sur eux. D'autant qu'au dictionnaire proprement dit s'ajoute tout un appareil de références, de cartes et d’index propre à satisfaire les plus exigeants. « Le XIXe siècle, écrivent Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avait tenté de nous convaincre que l'essentiel de notre héritage était dû aux bienfaits de l'intégration de la Gaule dans l'orbite de Rome ». La Gaule étant déjà fortement celtisée à la fin de l’Âge du Bronze, il faut désormais regarder plus loin vers une civilisation celtique apparue au IIe millénaire av. notre ère, dont les peuples fondateurs des terroirs de la France furent les héritiers.
A. B. éléments n°147 avril-juin 2013
Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, Les peuples fondateurs à l'origine de la Gaule, Yoran embanner (71 rue Mespiolet, 29170 Fouesnant), 903 p., 39 €, préface de Venceslas Kruta.
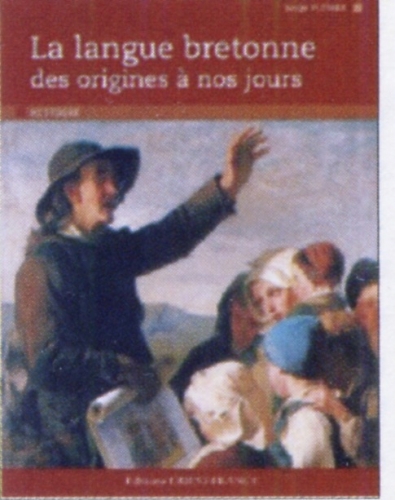 Un beau livre sur l'histoire de la langue bretonne, qui vient de paraître, vient rappeler l'importance du patrimoine linguistique pour notre identité.
Un beau livre sur l'histoire de la langue bretonne, qui vient de paraître, vient rappeler l'importance du patrimoine linguistique pour notre identité.
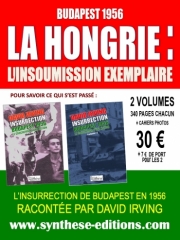
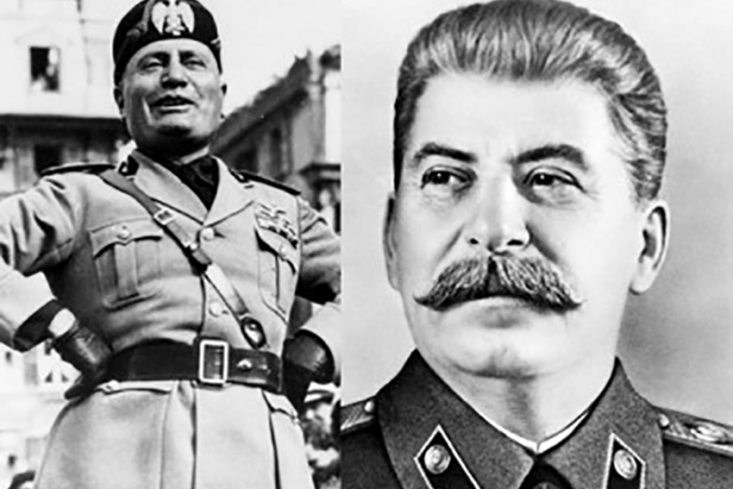

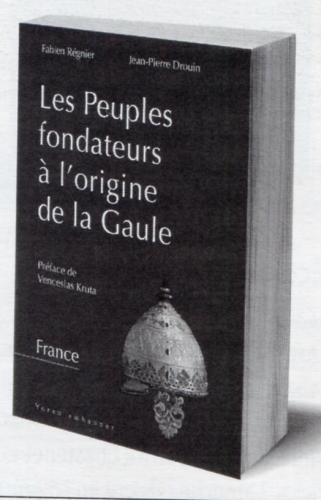 La présence sous-jacente du monde celtique antique ne s'est jamais limitée à la Gaule, mais concerne une bonne vingtaine de pays actuels. Pour apprécier les faits antérieurs à la conquête romaine, il faut donc remonter très haut pour découvrir l'origine des peuples gaulois, dont les auteurs anciens (Hérodote, Plutarque, Appien, etc.) indiquent qu'ils ne formaient pas moins de 300 à 400 « nations ». C'est à ce travail de fourmi que se sont attelés Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avec un résultat vraiment impressionnant, car ce ne sont pas seulement les peuples les plus connus (Sénons, Eduens, Arvernes, Rèmes, Cénomans, Allobroges, Bituriges, Vénètes, Sequanes, Lingons, Volques, etc.), mais des centaines de tribus d'origine celtique qui sont ici recensées, présentées et minutieusement étudiées. En dehors des spécialistes, qui connaissait jusqu'à présent les Viducasses, les Abrincates, les Calètes, les Diablintes, les Lexoviens, les Vellaves, les Tarusques, les Nitiobrogés, les Elusates, les Médules, pour ne citer que ceux-là, dont la mémoire a surtout été conservée par la toponymie ? Grâce à cet ouvrage monumental, on en apprend beaucoup sur eux. D'autant qu'au dictionnaire proprement dit s'ajoute tout un appareil de références, de cartes et d’index propre à satisfaire les plus exigeants. « Le XIXe siècle, écrivent Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avait tenté de nous convaincre que l'essentiel de notre héritage était dû aux bienfaits de l'intégration de la Gaule dans l'orbite de Rome ». La Gaule étant déjà fortement celtisée à la fin de l’Âge du Bronze, il faut désormais regarder plus loin vers une civilisation celtique apparue au IIe millénaire av. notre ère, dont les peuples fondateurs des terroirs de la France furent les héritiers.
La présence sous-jacente du monde celtique antique ne s'est jamais limitée à la Gaule, mais concerne une bonne vingtaine de pays actuels. Pour apprécier les faits antérieurs à la conquête romaine, il faut donc remonter très haut pour découvrir l'origine des peuples gaulois, dont les auteurs anciens (Hérodote, Plutarque, Appien, etc.) indiquent qu'ils ne formaient pas moins de 300 à 400 « nations ». C'est à ce travail de fourmi que se sont attelés Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avec un résultat vraiment impressionnant, car ce ne sont pas seulement les peuples les plus connus (Sénons, Eduens, Arvernes, Rèmes, Cénomans, Allobroges, Bituriges, Vénètes, Sequanes, Lingons, Volques, etc.), mais des centaines de tribus d'origine celtique qui sont ici recensées, présentées et minutieusement étudiées. En dehors des spécialistes, qui connaissait jusqu'à présent les Viducasses, les Abrincates, les Calètes, les Diablintes, les Lexoviens, les Vellaves, les Tarusques, les Nitiobrogés, les Elusates, les Médules, pour ne citer que ceux-là, dont la mémoire a surtout été conservée par la toponymie ? Grâce à cet ouvrage monumental, on en apprend beaucoup sur eux. D'autant qu'au dictionnaire proprement dit s'ajoute tout un appareil de références, de cartes et d’index propre à satisfaire les plus exigeants. « Le XIXe siècle, écrivent Fabien Régnier et Jean-Pierre Drouin, avait tenté de nous convaincre que l'essentiel de notre héritage était dû aux bienfaits de l'intégration de la Gaule dans l'orbite de Rome ». La Gaule étant déjà fortement celtisée à la fin de l’Âge du Bronze, il faut désormais regarder plus loin vers une civilisation celtique apparue au IIe millénaire av. notre ère, dont les peuples fondateurs des terroirs de la France furent les héritiers.