culture et histoire - Page 983
-
Louis XIV, mythes et realites [Au coeur de l'histoire]
-
La liquidation brutale des opposants par la Tchéka
Le service de renseignement politique créé par Lénine usa de méthodes radicales et extrêmes dans la neutralisation des trotskistes.La multiplication des affaires mouillées (enlèvements ou assassinats orchestrés) nécessite la création de nouveaux organes. L’« Administration des missions spéciales » (comprendre : les assassinats) est créée en décembre 1936. Elle fait ses premières armes en Espagne. Après le déclenchement de la guerre civile espagnole, en juillet 1936, le principal souci de Staline demeure en effet moins la victoire de Franco que l’infiltration trotskiste. Le Guide provoque « une guerre civile au sein de la guerre civile » en cherchant à éradiquer les sympathisants trotskistes du Poum, le Parti marxiste espagnol. Alexandre Orlov, de son vrai nom Leïba Fedbine, un Biélorusse, est missionné pour coordonner les opérations sur place, tandis que Serebrianski est chargé de celles à l’extérieur.Au printemps 1937, Serebrianski et Orlov reçoivent l’ordre de mettre en œuvre la liquidation pure et simple des dirigeants trotskistes. S’y illustre l’espion sans doute le plus décoré d’Union soviétique, futur héros de la grande guerre patriotique : Stanislav Vaoupchasov. A partir du milieu des années 1920, il dirige une unité secrète de l’OGPU qui s’active à la frontière polono-lituanienne. Pendant la guerre d’Espagne, il est chargé, non sans l’aide de complices tels que le dirigeant communiste français André Marty, « un bourreau plus stalinien que tous les staliniens de l’URSS », de la construction et de la surveillance d’un four crématoire où disparaissent sans laisser de traces les victimes du NKVD.Parmi elles, on dénombre Andés Nin, cofondateur du Poum en 1935 et ancien secrétaire de Trotski. Nin meurt dans des souffrances qui rappellent l’époque d’Ivan le Terrible. Pratiques qui n’ont, hélas, rien d’exceptionnel depuis la guerre civile, où toutes sortes de tortures – allant de l’écorchement à l’empalement, pour ne citer que les plus « classiques » – ont été utilisées par les services secrets soviétiques, mais aussi par les Blancs. Un confrère de Nin, José Diaz, le secrétaire général du Parti communiste espagnol, sera quant à lui « simplement » défénestré par les agents de Staline – à Tbilissi en 1942, où il trouve refuge après la victoire de Franco. Diaz en savait trop sur le meurtre de Nin et, en général, sur les actions du NKVD pendant la guerre civile espagnole.L’Espagne n’est pas, cela va de soi, le seul théâtre d’opérations pour les affaires mouillées. L’Europe de l’Ouest est largement concernée. Dès 1928, le réseau de Serebrianski compte quelque 212 illégaux dans 16 pays, dont 14 Européens. Quelques mois après l’assassinat de Nin, en septembre 1937, la police suisse retrouve près de Lausanne le corps criblé de balles d’Ignace Poretsky, un illégal d’origine polonaise soupçonné d’être un trotskiste infiltré au NKVD. Dans la serviette abandonnée par son assassin, le « grand illégal » Roland Abbiate, plus connu sous son pseudonyme François Rossi, la police découvre un plan détaillé de la villa de Trotski à Mexico, une véritable forteresse.De fait, l’étau se resserre autour du Vieux. Son fils Lev Sedov meurt dans d’atroces souffrances en février 1938, après avoir été soi-disant opéré d’une crise d’appendicite dans une clinique parisienne, infiltrée par le NKVD. Les causes exactes de son décès restent à ce jour non élucidées – même si l’implication du « laboratoire des poisons » ne fait pratiquement aucun doute. Son remplaçant à la IVe Internationale, Rudolf Klement, est quant à lui retrouvé décapité dans la Seine après son enlèvement en juillet de la même année. L’œuvre serait celle d’un officier turc téléguidé par un agent prometteur, Alexandre Korotkov. Staline est satisfait, mais continue de réclamer une autre tête, celle de Trotski.Andreï Kozovoï, Les services secrets russes -
La Journée de Synthèse nationale comme si vous y étiez... suite
Gabriele Adinolfi, Projet Lansqenets
Alban d'Arguin, Eoliennes un scandale d'Etat
-
Guillaume Bernard - Reconquérir les idées
-
La Journée de Synthèse nationale comme si vous y étiez...
Hugues Bouchu,
Les Amis franciliens de Synthèse nationale
Philippe Randa, directeur de EuroLibertés
Vincent Vauclin, Président de la Dissidence française
-
Terres de Mission : Les guerres de religion. Tuer et mourir pour Dieu
-
Les agents secrets de Louis XIV (Au Coeur de l'Histoire)
-
Hegel et Schopenhauer par André Vergez
-
Marseille, mercredi 4 octobre, Hilaire de Crémiers parlera de Maurras en son Chemin de Paradis

Rendez-vous au 14 rue Navarin, à 18h30 !
-
La vérité sur la Terreur

Les fusillades de Nantes
 Le 24 juin 1793, l'Assemblée adoptait une nouvelle Constitution, ratifiée par plébiscite le 9 août suivant. Cette Constitution était suspendue dès le 10 octobre, la Convention décrétant que « le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix » . C'était le triomphe du régime d'exception, le pays se trouvant aux mains du Comité de salut public où siégeaient Robespierre et Saint-Just. Se fiant à cet enchaînement des faits, toute une tradition historiographique rapporte que, le 5 septembre 1793, « la Terreur a été mise à l'ordre du jour ». Or, souligne Jean-Clément Martin, la Terreur, ce jour-là, n'a nullement été l'objet d'un débat ou d'une délibération à l'Assemblée, constat dont il se targue pour soutenir que la Terreur n'a été « mise à aucun ordre du jour, que ce soit celui de la Convention, de la nation Ou de la Révolution ».
Le 24 juin 1793, l'Assemblée adoptait une nouvelle Constitution, ratifiée par plébiscite le 9 août suivant. Cette Constitution était suspendue dès le 10 octobre, la Convention décrétant que « le gouvernement provisoire de la France sera révolutionnaire jusqu'à la paix » . C'était le triomphe du régime d'exception, le pays se trouvant aux mains du Comité de salut public où siégeaient Robespierre et Saint-Just. Se fiant à cet enchaînement des faits, toute une tradition historiographique rapporte que, le 5 septembre 1793, « la Terreur a été mise à l'ordre du jour ». Or, souligne Jean-Clément Martin, la Terreur, ce jour-là, n'a nullement été l'objet d'un débat ou d'une délibération à l'Assemblée, constat dont il se targue pour soutenir que la Terreur n'a été « mise à aucun ordre du jour, que ce soit celui de la Convention, de la nation Ou de la Révolution ».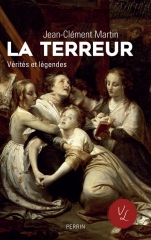 Cette remarque se situe au début d'un petit volume piquant et plein d'érudition, mais dont la lecture provoque une irritation croissante car son signataire, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française et universitaire émérite, se surpasse dans un art qu'il pratique, ouvrage après ouvrage, depuis une vingtaine d'années. Convaincu des bienfaits de la Révolution française, Jean-Clément Martin n'a de cesse de présenter les violences d'Etat, les exactions et l'arbitraire de cette époque - dont il ne nie pas la réalité - comme des accidents dus aux concurrences des factions ou à la vacance du pouvoir, et non comme le fruit d'une idéologie ou d'un mécanisme déroulant ses effets. Sous prétexte de dissiper les légendes sur la Terreur, l'auteur noie continûment le poisson. Il établit ainsi des. comparaisons hors sujet avec d'autres périodes - par exemple les guerres de Religion, alors que la loi des suspects du 17 septembre 1793 n'a pas son équivalent dans cette guerre civile - ou il nie l'évidence, spécialement en assurant que la Vendée n'a pas été victime de la Terreur. Dans un maître livre (La Politique de la Terreur, Fayard, 2000), l'historien Patrice Gueniffey avait naguère dit l'essentiel : « L'histoire de la Terreur commence avec celle de la Révolution et finit avec elle. » Cette ombre au tableau est peut-être gênante pour la gloire nationale, elle n'en est pas moins là.
Cette remarque se situe au début d'un petit volume piquant et plein d'érudition, mais dont la lecture provoque une irritation croissante car son signataire, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française et universitaire émérite, se surpasse dans un art qu'il pratique, ouvrage après ouvrage, depuis une vingtaine d'années. Convaincu des bienfaits de la Révolution française, Jean-Clément Martin n'a de cesse de présenter les violences d'Etat, les exactions et l'arbitraire de cette époque - dont il ne nie pas la réalité - comme des accidents dus aux concurrences des factions ou à la vacance du pouvoir, et non comme le fruit d'une idéologie ou d'un mécanisme déroulant ses effets. Sous prétexte de dissiper les légendes sur la Terreur, l'auteur noie continûment le poisson. Il établit ainsi des. comparaisons hors sujet avec d'autres périodes - par exemple les guerres de Religion, alors que la loi des suspects du 17 septembre 1793 n'a pas son équivalent dans cette guerre civile - ou il nie l'évidence, spécialement en assurant que la Vendée n'a pas été victime de la Terreur. Dans un maître livre (La Politique de la Terreur, Fayard, 2000), l'historien Patrice Gueniffey avait naguère dit l'essentiel : « L'histoire de la Terreur commence avec celle de la Révolution et finit avec elle. » Cette ombre au tableau est peut-être gênante pour la gloire nationale, elle n'en est pas moins là. PAR JEAN SEVILLIA
La Terreur. Vérités et légendes, de Jean-Clément Martin, Perrin, 238 p., 13 €.
Figaro magazine, 22.09