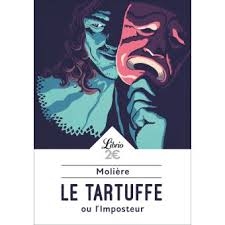La 13e édition de la marche parisienne pour la vie s'est distinguée cette année par la jeunesse de ses participants et une nouvelle liberté bienvenue, lors des prises de parole officielles l'indicible a été dit : l’avortement tue.
Avec ses 50 000 participants revendiqués, relégués par la préfecture dans les avenues tranquilles, reliant la porte Dauphine à la place du Trocadéro, la Marche pour la vie a pourtant enfin percé l'omerta médiatique. Du sujet sur LCI en passant par la dépêche somme toute honnête de l'AFP au « papier » du Point (illustré, il est vrai, par une image de la Marche 2018 !) l'éventail était large. L'avortement est de nouveau un sujet. C'est peut-être là le premier le plus grand succès de cette Marche elle rend témoignage à la vérité - ce qui est un bien et une exigence en soi - en rappelant à une culture qui l'a largement occultée que cette vérité existe.