Voilà bien une idée saugrenue que celle de dénommer « Hauts de France », le « plat pays » que chantait Jacques Brel, et dont Pierre Bachelet nous contait qu’il n’avait que les terrils pour uniques montagnes. C’est là un indice de plus de la superficialité de la pensée politique qui règne aujourd’hui en France. On ne cherche qu’à créer une image flatteuse, fausse mais médiatique, de soi. En l’occurrence, on invente une verticalité géographique incongrue (le haut en question étant celui d’une carte qu’on colle au mur) au lieu d’appeler la région par les noms des provinces qu’elle réunit : Artois-Flandre-Picardie. Trop simple ou, qui sait, trop dangereux…
magouille et compagnie - Page 2017
-
Une réforme régionale inutile qui se couvre de ridicule
-
Alain Soral: l'islam, un opposant utile qui n'existe pas (1/2)
-
Pâques sanglantes, les Français dans l’arène ?
Les chrétiens du monde entier fêtaient Pâques cette fin de semaine, à l’exception des orthodoxes qui, pour cause de calendrier julien, célébreront la résurrection du Christ le 1er mai. Chrétiens qui ont été de nouveau visés dimanche par les fanatiques islamistes. En Syrie, alors que les troupes légalistes reprenaient la cité antique de Palmyre des mains de l’Etat Islamique, une femme portant une ceinture d’explosifs, s’est fait sauter dimanche à Ra’s al-‘Ayn (province d’Hassaké), devant l’église syriaque orthodoxe Saint-Georges, tuant et blessant plusieurs fidèles. Au Pakistan, le même jour, c’est à Lahore dans le parc d’attraction de Gulshan-e-Iqbal, près de l’aire de jeux pour enfants, qu’un commando de fous d’Allah a déposé une bombe dans ce lieu fréquenté par des familles chrétiennes et musulmanes. L’attentat a été revendiqué par Ehansullah Ehsan, porte-parole du groupe islamiste local Tehreek-e-Taliban, affilé au Jamaat ul Ahrar: « Nous voulions attaquer les chrétiens qui célébraient Pâques.» Le dernier bilan fait état de 72 morts et 350 blessés hospitalisés au chevet desquels ce sont rendus notamment le Premier ministre Nawaz Sharif et le ministre de l’Intérieur Chaudhry Nisar. Le quotidien pakistanais The Nation s’est indigné du peu de protections dont bénéficient les chrétiens dans le pays et a rappelé que l’année dernière plus de 115 attentats islamistes ont été recensés au Pakistan, entraînant le mort de plus de 1700 personnes.
C’est dans ce contexte de terrorisme accru en Europe même que le successeur de Myriam el Khomri à la tête du ministère de la Ville, Patrick Kanner, a manifesté officiellement son inquiétude. Invité dimanche du Grand rendez-vous Europe 1-iTELE-Le Monde, M. Kanner a déclaré que les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises «ont permis manifestement un développement du salafisme» dans les quartiers pluriels, où des «prédateurs» se sont incrustés. Il a affirmé qu’«une centaine de quartiers en France» présentaient «des similitudes potentielles avec Molenbeek», cette commune bruxelloise dont sont issus les membres de la cellule de l’EI responsables des attentats de Paris et Bruxelles.
Hier, interrogé dans Le Parisien, le ministre de la Ville a enfoncé le clou : «Nous avons 1 500 quartiers prioritaires — soit 5,5 millions de Français — qui ne sont pas des Molenbeek, mais où il faut être extrêmement vigilant. Il ne faut pas faire d’amalgame — ce serait scandaleux pour ceux qui y vivent — mais pas d’angélisme non plus, car il y a une volonté claire des salafistes de prendre le pouvoir dans certains de ces quartiers.»
L’aveu de Patrick Kanner a créé l’émoi, bien hypocrite, de la classe politicienne. Le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a tenu à minorer la situation décrite par le ministre: il n’y a «pas de quartiers» présentant le profil de celui de Molenbeek . «Je ne suis pas pour ce discours », il ne faut pas « dissoudre la concorde nationale ». «On doit avoir une stratégie vis-à-vis du terrorisme, c’est de ne pas isoler les musulmans, mais d’isoler (les terroristes islamistes).»
Un discours lénifiant, une volonté d’occulter une réalité qui ne cadre pas avec le dogmemulticulturel qui a été repris par Julien Dray lors de son passage au Grand jury » RTL-LCI-Le Figaro: «Depuis 20 ans, il y a une ghettoïsation sociale qui donne lieu (…) à une montée de la délinquance et puis aussi à des noyaux islamistes qui essaient d’instrumentaliser des points sociaux.» «Ce sont des points communs» avec Molenbeek, mais «je n’aime pas qu’on stigmatise car la majorité de la population de ces quartiers en a assez d’être désignée à la vindicte populaire» a ajouté le très décrié amateur d’horlogerie suisse et cofondateur de SOS racisme.
Même son de cloche du président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde qui, sur RMC, s’est dit «très agacé» par la franchise des propos de Patrick Kanner, «parce que c’est le genre de formule qui débilise, qui mutile le débat politique français» (sic). «Je ne crois pas du tout qu’il y ait des centaines de Molenbeek en France. La vérité, c’est qu’on a des quartiers qui sont ghettoïsés.»
Certes, dirigeants socialistes, centristes, républicains se retrouvent autour du vœu, formulé plus ou moins explicitement, de ne pas de stopper l’immigration, mais de la disperser, comme le suggère le discours de certains « spécialistes » .
Moins de trois semaines après les attentats contre Charlie-Hebdo, le JDD mettait en ligne Le 26 janvier 2015, un article sur cette France urbaine marquée par l’immigration : «En restructuration urbaine depuis trente-cinq ans, quelque 500 quartiers ont bénéficié d’une succession de dispositifs, avec chacun son acronyme (ZUS, Cucs, ZRU, ZFU…). Intégrer une immigration massive est un processus long, rapporte (la géographe) Béatrice Giblin. Depuis quelques années, on commence à dédensifier les cités. Pour le sociologue Éric Maurin , ces logements sociaux ne doivent pas être concentrés aux mêmes endroits, au risque de reproduire les mêmes erreurs, mais disséminés partout dans la ville, voire saupoudrés dans des immeubles, par étages. »
«La poursuite d’une immigration massive pousse les pouvoirs publics à cette dissémination, les immigrés eux-mêmes faisant le choix de la mobilité. Le géographe Christophe Guilluy, cité dans ce même article, rappelait que «ces quartiers produisent tout de même une classe moyenne. La population bouge, dire que rien ne change est une erreur. Le jeune chômeur d’aujourd’hui n’est pas celui de demain, mais les meilleurs partent et sont remplacés par des plus précaires. L’immigration aussi a changé, avec une population d’abord européenne puis maghrébine et africaine, maintenant sri-lankaise.»
«Dans les 80 ZSP (zones de sécurité prioritaires), créées depuis 2012 », «la proportion de Français d’origine étrangère et d’immigrés se situe entre un tiers et 50% de la population » affirmait alors Myriam El Khomri. « =Elle atteint même les deux tiers en Île-de-France« , précisait encore (l’ex) secrétaire d’État à la Ville. Maghrébins et Africains subsahariens constituent la majorité de ces populations, la plupart de culture musulmane (…) . Si les services publics n’investissent pas le terrain, ce sont les barbus qui assurent le service social, résume un policier, qui souligne que la carte des ZSP recoupe aussi en partie celle des départs pour le djihad syrien…».
Il est de tout de même consternant constate Bruno Gollnisch, que les Français soient obligés d’attendre que le sang coule pour qu’un ministre ose dire ce que tous les citoyens un peu informés savent déjà. Faudra-t-il attendre de nouvelles Pâques sanglantes, cette fois sur notre territoire, pour que cette certains politiciens du sérail aillent encore plus loin dans la confession? A droite, les propos de M. Kanner ont été le prétexte à des tentatives, bien maladroites, d’exonérer les années de gouvernance Chirac et Sarkozy de toutes responsabilités dans la montée d’un communautarisme islamiste qui se nourrit mécaniquement de l’immigration-invasion. Le phénomène bien sûr, ne date pas de l’élection de François Hollande. Il prend sa source dans l’accumulation de toutes les démissions, de tous les reniements, de toutes les aberrations à la tête de l’Etat et dans les assemblées depuis le septennat de Giscard d’Estaing.
http://gollnisch.com/2016/03/29/paques-sanglantes-francais-larene/
-
Racisme : c’est mon peuple qu’on assassine !
Les attentats de Bruxelles viennent de provoquer une victime collatérale : la campagne dite « antiraciste » du gouvernement. N’en déplaise aux vidéos obscènes du pouvoir socialiste, la haine a un visage, et ce n’est pas celui des petits Blancs bêtes et méchants que montre la propagande gouvernementale.
Nous n’avons plus d’existence officielle. Nous ne sommes même plus des sous-hommes, mais des non-êtres, des êtres niés.
Cette propagande a atteint un tel degré d’ignominie dans la stigmatisation d’une population qu’elle s’est retournée contre ses promoteurs. Il faut entendre le misérable pathos du délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, un certain Gilles Clarveul, sur l’antenne de RMC, pour justifier l’absence du racisme anti-Blanc dans les vidéos, face à la charge implacable de Gilles-William Goldnadel qui s’indignait de l’occultation du racisme anti-Blanc. Nous n’avons pas mis les Roms non plus, bafouillait-il, les exemples étaient trop nombreux, il fallait faire un choix, mais, évidemment, nous dénonçons toutes les formes de racisme ! Comme par hasard, ce choix, tout à fait neutre et impartial bien sûr, n’a pas retenu les victimes blanches. Pas de chance !
Ils nous prennent vraiment pour des billes. Nous pratiquons le devoir de mémoire, et nous n’oublions pas que depuis plus de 30 ans la stratégie à la « Touche pas à mon pote » construit une représentation hideuse et tronquée de la réalité française, sur le mode de l’union « black-beur-feuj » contre le racisme des beaufs indigènes. Ce racisme d’Etat, tranquille et légal, a servi d’idéologie officielle à l’asservissement d’un peuple. Le film, La Haine, au cœur des années 1990, a incarné pour une génération cette vision haineuse de la France blanche. La génération précédente, en 1975 exactement, sur le même thème, avait son Dupont la Joie, chronique de la haine ordinaire du Blanc populaire.
Le parti de la haine
Aujourd’hui, la génération Bataclan a le droit aux clips d’une propagande d’Etat grossière que ne renieraient ni les nazis ni les bolcheviks, et que nous finançons avec nos deniers. Plus besoin même de raconter une histoire bidon, l’image réduite à sa plus simple expression brute suffit. Pauvre génération qui hérite des désastres que ses aînés laissent derrière eux !
Où s’arrêteront-ils, ceux qui nous gouvernent, jusqu’où descendront-ils ? Ils sont devenus fous ! Quatre mois après le Bataclan, et des centaines de jeunes Français massacrés – dans un continent dont les frontières ont rompu sous la pression d’une « immigration-invasion » – ils osent nous rejouer le coup du racisme blanc contre les « pauvres » minorités, alors que le citoyen ordinaire, chaque jour, subit les violences de la diversité imposée et ne sait plus où se planquer pour les éviter.
Mais où vivent-ils, dans quels quartiers sont-ils, où sortent-ils, quels moyens de transport utilisent-ils, dans quelles écoles vont leurs enfants, pour que cette réalité, jamais, ne leur saute aux yeux comme un coup de pied au derrière ? Dans quelle logique infernale sont-ils enfermés pour nier avec autant d’arrogance une réalité qu’il n’est plus possible de ne pas croiser ? Cette logique infernale, on la connaît finalement : elle n’a rien à voir avec la naïveté, ni avec la cécité, mais tout avec la haine de soi ; jusqu’au désir d’anéantir sa propre matrice civilisationnelle. Cette haine froide, désormais, forme le substrat mental de la caste dominante, comme une seconde nature inconsciente.
Comment ont-ils pu ne pas comprendre que leur campagne de propagande ne pouvait qu’aller à l’encontre de leurs intentions, tant elle contredit violemment les réalités que les gens vivent et perçoivent ? Pour plagier Audiard : décidément, « ils osent tout… et font tout pour que l’on les reconnaisse ». Pauvre Valls, commanditaire de cette initiative « citoyenne », ses nerfs doivent le trahir : face à la concurrence d’un Macron, fin et fluide, qui, inexorablement, bouche son espace politique, il ne sait plus quoi inventer pour reprendre la main.
C’est la faute à la statistique
Cauteleux et sinueux, le délégué interministériel, lui, pour justifier cette manipulation infâme, se retranche derrière la statistique, évoquant le fait que le gouvernement a juste respecté la réalité chiffrée des violences racistes, qui, explique-t-il, montre bien que ce sont les Arabes, les Juifs et les Noirs qui sont les plus agressés. Le mensonge s’ajoute au mensonge pour justifier le mensonge !
Et pour cause, M. Clarveul oublie juste de nous préciser que la catégorie « racisme anti-Blanc », ou « anti-Français », n’est pas pris en compte dans les statistiques. La multitude des agressions du quotidien subie par le Français lambda n’est donc jamais comptabilisée dans les évaluations des violences racistes.
Depuis plus de 20 ans, le rapport annuel du CNCDH (*), qui sert de document officiel sur le racisme en France, n’intègre pas ce type de violence comme une catégorie en soi. Comment peut-on alors comparer quelque chose qui existe à quelque chose qui n’existe pas ? Un organisme de la République institutionnalise ainsi une discrimination raciale pour fonder sa définition du racisme, sans qu’aucune autorité politique ou morale n’ait jamais dénoncé cette supercherie. Tout cela est passé comme une lettre à la poste. Et chaque année, au retour du printemps, les médias, pieusement, font leur Une sur la « montée inquiétante du racisme en France », sur une base statistique tronquée qu’ils avalisent comme un seul homme.
Nous n’avons plus d’existence officielle. Nous ne sommes même plus des sous-hommes, mais des non-êtres, des êtres niés. On ne peut plus être nommé et il est interdit de nous nommer nous-mêmes. C’est une première dans l’histoire : la disparition par la négation – on pourrait presque dire « en douceur » ! Et tout ça, « au nom des grands principes, en vertu des bons sentiments », comme le chantait le poète…
Didier Beauregard, 23/03/2016
(*) « Rapport annuel sur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie » de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).
http://www.polemia.com/racisme-cest-mon-peuple-quon-assassine/
-
Des milliards d’euros pour les « immigrants-réfugiés » ?
La grande question qui agite depuis peu les sommités européennes et les eurodéputés – tous gens d’une grande utilité pour les Nations européennes, comme chacun peut aisément s’en rendre compte – est de déterminer le nombre de milliards d’euros que l’on va donner au gouvernement turc pour qu’il cesse d’enrichir l’Europe d’immigrés économiques, mêlés aux réfugiés politiques (par ailleurs épicés de quelques milliers d’honorables djihadistes).
Noble tâche que celle des commissaires exécutifs et des élus des Nations ! Distribuer une partie du produit des impôts prélevés sur les Européens pour l’exporter vers un gouvernement islamique, qui est responsable en partie du bourbier syro-irakien – qu’on l’appelle Daesh, État Islamique ou califat ressuscité ne change, hélas, rien à la réalité –, et qui achète des armes en grande quantité, ce qui est naturel puisque le Grand Turc Erdogan est le maître de l’avant-poste des USA dans la lutte d’influence contre la Russie.
D’abord, on ne se savait pas si riches : gaspiller 2, 3 ou 5 milliards d’unités de compte, alors que les agriculteurs crient misère en divers pays d’Europe et qu’il existe un énorme chômage en France, en Belgique, en Espagne, etc., n’est-ce pas une véritable provocation envers les autochtones, par ailleurs soumis quotidiennement, dans des milliers de cités, au racisme anti-Blancs, au racket, aux vols et aux viols, spectacle généreusement offert aux Européens de souche par les fruits pourris de cette immigration-invasion ?
-
Syrie : Mais où en sont les Américains ?
Le cessez-le-feu conclu en Syrie sous l’égide des Russes et des Américains tient bon… En surface. Car le feu couve encore sous la braise. Ankara l’attise, les Américains sont déboussolés et les Russes gardent leurs fers au feu.
Personne ne croyait vraiment au cessez-le-feu qui est entré en vigueur en Syrie le 27 février, y compris les Russes et les Américains, parrains de l'accord. Pourtant, il semble être globalement respecté et si le bruit médiatique reflète bien celui des canons, un calme relatif est revenu en Syrie. Ce n'est bien sûr pas si simple.
En premier lieu, la cessation des hostilités ne concerne que les « opposants modérés » et exclut donc les terroristes de l'État Islamique et du Front Al-Nosra. Pomme de discorde entre les USA et la Russie, la définition de l'introuvable « opposition modérée » a été réglée de manière imparable par Moscou : sont qualifiées de modérées les milices qui viennent s'enregistrer comme telles auprès du "Centre pour la réconciliation des parties en conflit syrien", près de Lattaquié, soit à ce jour environ 30 groupes de taille très variable. Cela leur assure d'être épargnés par les trappes russes ou américaines, mais ils doivent alors renoncer à renverser Assad et s'engager dans un processus politique en faveur d'une Syrie laïque et démocratique, donc abandonner le rêve d'un État islamique. Ils sont donc assez peu nombreux à avoir franchi ce pas, ce dont l'ONU et les USA ont dû convenir à mots couverts : les organisations classées « terroristes » par l'ONU couvrent une majorité absolue des forces anti-Assad.
Vers un processus politique avec Assad
Les autres sont invitées à la table des négociations à Genève du 14 au 24 mars. Conséquence diplomatique directe et majeure : plus personne ne parle d'exclure le président syrien légal du processus politique.
Autre conséquence, loin du regard un peu gêné des médias qui suivent docilement la politique américaine, les offensives se poursuivent tous azimuts contre les terroristes. La bavure qui remettrait en cause le fragile cessez-le-feu est donc toujours possible et même activement recherchée par le Front Al-Nosra, par des provocations à rencontre des Russes.
Front Al-Nosra que la Turquie et l'Arabie Saoudite considèrent comme un interlocuteur tout à fait valable et soutiennent activement. Car ces deux pays font tout pour faire capoter le timide début de processus politique. Si l'Arabie Saoudite joue pour le moment les faire-valoir, la Turquie y est allée franco, en bombardant régulièrement les forces kurdes anti-islamistes du YPG qui progressent le long de la frontière turco-syrienne.
Mieux, la Russie et la presse turque libre accusent Ankara, preuves à l'appui, d'alimenter en continu le Front Al-Nosra et d'autres groupes islamistes en armes, notamment dans les provinces d'Idlib et d'Alep. Les blessés de ces groupes sont d'ailleurs souvent soignés en Turquie. Une politique jusqu'au-boutiste qui isole le pays sur le plan international : l'OTAN a fait savoir qu'en cas d'agression turque en Syrie, Ankara ne serait pas soutenu.
Qui veut la paix ?
Outre sa guerre à outrance contre les Kurdes, sur son territoire et plus ou moins directement en Syrie, la Turquie soutient des « rebelles » turkmènes qui tiennent notamment la ville de Jisr Al-Shughur, entre Lattaquié et Alep. Une offensive de l'armée syrienne contre cette localité stratégique serait probablement considérée comme un casus belli par Ankara.
L'autre acteur qui ne veut pas être entraîné malgré lui dans les frasques d'Erdogan, ce sont les États-Unis. Leur diplomatie est en KO technique face à la Russie qui a su dicter ses conditions pour lancer le cessez-le-feu et le processus politique. Pire, l'Oncle Sam s'empêtre dans ses contradictions. Il somme Ankara d'arrêter ses bombardements contre ses affidés kurdes, mais rejette à l'ONU une résolution allant précisément dans ce sens. Allez comprendre... Plus fort encore, les Kurdes, soutenus par le Pentagone, ont attaqué la milice arabe Furqa al-Sultan Murad... soutenue par la CIA ! Bref, soit Washington est en pleine déconfiture sur le terrain, soit elle garde plusieurs fers au feu. Sa menace d'un plan B sous forme de confrontation militaire avec l'armée syrienne en cas d'échec des négociations est à prendre au sérieux, tant il serait étonnant que les USA renoncent aussi facilement à leur projet de destitution d'Assad. Comme l'a souligné le ministre russe des Affaires étrangères, « les États-Unis et leurs alliés sont à la recherche de la guerre et non de la paix en Syrie. »
Richard Dalleau monde&vie 16 mars 2016
-
Contrer l'agitation gauchiste
L'extrême-gauche est en train de se servir de ces manifestations contre la loi Travail pour deux choses :
1/ Tenter de fédérer autour de son impulsion décisive les jeunes et les racailles afin de créer un mouvement, même temporaire, de déstabilisation de l'état et de cette tranquillité "bourgeoise" qu'ils haïssent.
2/ Influencer un maximum de personnes de ces deux milieux (cités et jeunes générations) afin que ses idées (http://www.ventscontraires.fr/2016/03/comprendre-le-gauchisme.html) se répandent.
Les militants et sympathisants gauchistes tentent de réaliser cela alors même qu'il suffirait d'une seule voix audible de la part de gens intelligents pour que leur fragilité intellectuelle soit dévoilée et les condamne à cet oubli auquel ils tentent d'échapper depuis des décennies. -
Violences policières: indignation sélective…
Aux bien-pensants qui dénoncent la grosse patate envoyée par un CRS à un lycéen qui manifestait devant le lycée Bergson à Paris, il est opportun de demander d’expliquer leur silence lorsque ces mêmes agents ont tabassé des militants patriotes ou gazé des gosses dans des poussettes lors des Manifs pour tous… Peut-être les idées d’un lycéen en grève (refusant donc de s’instruire), et à l’origine ethnique moins gauloise justifient-elles ce deux poids – deux mesures…?
-
ANTI RACISME : DES SPOTS « PUBLICITAIRES », VRAIMENT ?
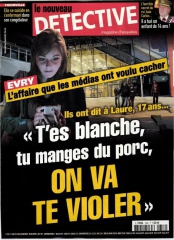 Le bloc-notes de Jean-Claude Rolinat
Le bloc-notes de Jean-Claude RolinatDepuis lundi une campagne « contre le racisme et l’antisémitisme » envahit nos petits écrans avec des spots d’un goût douteux et, surtout, d’un scandaleux parti pris. On ne visionne que des agressions de personnes de confession juive, des africains ou des maghrébins, avec en fond sonore des commentaires haineux ou sarcastiques dignes des « brèves de comptoirs » du café du commerce…
Vous pensiez que le Service d’Information du Gouvernement (SIG) serait objectif et qu’il n’oublierait pas les nombreux actes anti-chrétiens ou anti-Français qui, de jour en jour, émaillent le quotidien de vos… quotidiens ? Que nenni. Rien sur les insultes du type « sale Français » ou « têtes de fromage », rien sur les aimables slogans « Français dehors » qui fleurissent sur les murs antillais ou corses – j’ai des photos à la disposition de ce « SIG » - rien sur les agressions des forces de l’ordre, pompiers et autres praticiens de SOS médecins qui sont, forcément, Français… Pas un mot pour les « petits blancs » qui survivent dans les « cités de non droit » et autres « quartiers difficiles » en rasant les murs ou pour les commerçants qui désertent ces mêmes quartiers pour cause d’insécurité, une insécurité due, essentiellement, à leurs origines autochtones. Et que dire des aimables paroles qui fleurissent dans les litanies des rappeurs ? Le « cassage de gueule » du « de souche » ou la profanation du cimetière chrétien, cela ne semble pas intéresser, pas vraiment, les ligues de vertu comme SOS RACISME, la LICRA, le MRAP ou la LDH. Pourquoi ?
Les victimes, pour ces associations-là dont certaines vivent grâce aux subventions, ce sont forcément les immigrés ou les descendants de migrants pour utiliser un mot à la mode. Mais les faits sont têtus et des slogans comme « Tous unis contre la haine » sont cruellement démentis par une brûlante actualité. Car tous ne sont pas « unis contre la haine », tant s’en faut. Après les massacres de Charlie Hebdo et du supermarché kasher, après les exactions commises par des gens « dérangés » contre un commissariat ou une rame Thalys, après les mitraillages des terrasses de restaurants et de la salle du Bataclan ou encore le froid assassinat d’une jeune femme à Villejuif - j’en oublie - on peut effectivement dire que « Le racisme commence par des mots, ça finit par des crachats, des coups, du sang » et on pourrait même ajouter, « par des bombes », comme à Bruxelles ! Depuis des années, des torrents de haine se déversent sur nos vieux pays d’Europe, des torrents alimentés par une pensée religieuse pervertie sans aucun doute, poussée au paroxysme, chauffée jusqu’à l’incandescence.
Une bande de saltimbanques du PAF, de Claire Chazal, vous savez la smicarde du petit écran, à Sébastien Folin en passant par le précieux Stéphane Bern, parrainent cette initiative à sens unique. Cela ne fait pas honneur à leur sens de l’équité, mais que pouvons-nous attendre de ces gens-là qui vivent dans leurs ghettos de riches ?
UNE PROPAGANDE DIGNE D’UN ETAT TOTALITAIRE
L’INED, l’Institut National des Etudes Démographiques qui ne saurait être soupçonné de sympathie pour « l’extrême droite », avait reconnu et identifié dans une étude rendue publique en 2008, les termes de « majoritaires » pour désigner les « blancs » et « minoritaires » pour les autres ethnies. On pouvait lire, sans rire, que « le racisme des minoritaires à l’encontre des majoritaires peut blesser verbalement, voire être agressif physiquement ». Mais c’était aussitôt un rétropédalage pour minorer ce constat et pratiquer la politique de l’excuse : « 15% seulement des majoritaires en ont été victimes » et cela n’était « qu’une réaction face à des personnes qui, par leur origine, leur apparence, leur couleur, leur position sociale ou leur comportement peuvent incarner la classe ou la “ race ” - le vilain mot ! – des dominants et des racistes ». Fermez le ban ! Et si ces gens là, les « riches », forcément « blancs », avaient utilisé la cinglante répartie de Jean Gabin, « salauds de pauvres » dans le merveilleux film La traversée de Paris ? Le clivage social recoupant le clivage « racial » ? La vérité est toute autre. Alors que cette campagne « publicitaire » - « propagandastaffel », vous avez dit « propagandastaffel » ? – va s’étaler sur nos petits écrans pendant une bonne semaine, les fous furieux se réclamant d’une religion de « paix et d’amour » fourbissent leurs armes. Hier Londres, Madrid, Paris et Copenhague, aujourd’hui Bruxelles, à qui le tour demain ? Nous, en bons citoyens, nous ne pratiquons pas l’amalgame, nous sommes cohérents avec nous-mêmes… Nous savons que si tous les musulmans dans leur immense majorité ne sont pas, Dieu merci, des « terroristes », tous les terroristes islamistes se réclament du Prophète. Alors, dans cette ambiance nauséabonde, à qui sert cette campagne qui stigmatise, qu’on le veuille ou non, les « majoritaires » pour emprunter le vocable de l’INED en 2008 ? Elle ne rend pas service au pays et, au pire, risque d’aboutir à l’opposé de ce que recherchent leurs initiateurs.
Nous savons que « Jupiter rend fous ceux qu’il veut perdre ». Alors nous, les Français nationalistes, identitaires et nationaux, gardons la tête froide et ne tombons pas dans le piège tendu par nos adversaires. Mais disons tout haut et bien fort que nous ne sommes pas dupes…
-
Présidentielles : Marion Maréchal-Le Pen défend le respect de l'anonymat pour les parrainages