tradition - Page 121
-
Alain Escada à la Marche pour la vie
-
50 000 manifestants à la Marche pour le vie 2017 !
-
Nos raisons pour la Monarchie - 3
-
« Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps » (entretien avec Marie Cachet)
Moins connue que son compagnon Varg Vikernes (l’un des forgerons de la musique black metal), Marie Cachet n’en est pas moins aussi créative et soucieuse de préserver notre culture européenne plurimillénaire. À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Le Secret de l’Ourse, Europe Maxima est allé à la rencontre de cette maman en révolte contre le monde moderne.
Europe Maxima : Les lecteurs d’Europe Maxima vous connaissent sans doute en tant que compagne de Varg Vikernes, artiste prolixe qui a à cœur, tout comme vous, de promouvoir notre héritage et notre culture européenne. En ce qui vous concerne comment avez-vous pris conscience de l’importance de « notre plus longue mémoire » comme le rappelait, après Nietzsche, feu Dominique Venner ?
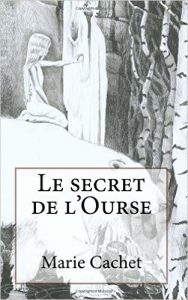 Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.
Marie Cachet : En fait, depuis toujours. Quand j’étais petite, je me demandais pourquoi je ne pouvais contrôler que moi-même, pour ainsi dire. Je m’interrogeais sur la différence entre autrui et moi-même, sur l’individualité, sur l’infinitude de l’univers. J’étais une enfant renfermée à l’intérieur, et j’avais quelques particularités sensorielles qui n’aidaient pas à mon adaptation sociale. J’avais un attrait viscéral pour la Nature. Je me souviens de la sensation unique, presque oppressante que procuraient les grandes et sombres forêts de châtaigniers en Corse, les sommets des Alpes, les étoiles du ciel. J’observais tout ce que la Nature nous donnais à voir, et je lisais des livres sur la faune sauvage.C’est cette sensation vertigineuse d’infinitude qui m’a fait prendre conscience de l’importance de notre plus longue mémoire. Plus tard, mais toujours enfant, j’ai farfouillé dans les bibliothèques et ouvert quelques livres de Platon, et surtout les stoïciens, Kierkegaard et Perceval.
Europe Maxima : Ce n’est un secret pour personne que votre compagnon et vous-même êtes extrêmement sévères à l’égard du christianisme et plus largement des monothéismes abrahamiques. Vous ne cachez pas non plus votre paganisme. De ce fait comment envisagez-vous votre identité française ? En effet vous n’êtes pas sans savoir que la France est la fille aînée de l’Église…
Marie Cachet : La fille aînée de l’Église ? La France est beaucoup de choses. La France, c’est aussi le pays avec le plus de vestiges paléolithiques en Europe. Vestiges jalousement gardés et dissimulés par l’Église, pendant longtemps.
La France, c’est La Ferrassie, la plus vieille nécropole du monde (- 39 000 ans), inconnue et abandonnée près d’une route, à peine ouverte à la visite, Le Regourdou, avec le plus vieux « dolmen » du monde (- 70 000 ans), Bruniquel, avec le plus vieux « Mithraeum » du monde (- 126 000 ans). La France, c’est les premiers squelettes d’enfants, de bébé et de foetus au monde (Le Moustier, La Ferrassie, Pech de l’Azé, La Quina), Lascaux, Chauvet, Rouffignac, Pech Merle, Cosquer, Gargas, Font-de-Gaume, Mas d’Azil, la Madeleine, Cro-Magnon… Il y en a tellement que vous vous ennuieriez si j’en faisais la liste.
La France, c’est aussi les innombrables tumulus, cairn, dolmens et menhirs, présents non pas seulement en Bretagne, mais dans tout le pays. À chaque fois que vous voyez une croix, vous pouvez être à peu près sûrs qu’il s’agissait d’un lieu important pour nos ancêtres païens.
Elle est là, notre plus longue mémoire. L’Église, a adopté, pour mieux nous attirer, nous tromper et nous soumettre, quelques-uns de nos rituels multi-millénaires. Elle a aussi détruit des vestiges sacrés, constructions gigantesques pour l’époque, posées pour durer des millénaires, comme témoins des énigmes du passé, que vous et moi avons le devoir de savoir lire. Platon disait que la réincarnation d’une âme durait de 3 000 à 10 000 ans ; dans le monde moderne, notre vision du temps est incroyablement étroite. 2 000 ans de christianisme, à l’échelle de nos ancêtres, c’est une poussière de temps.
La France, mon identité française, et l’identité de chaque Européen dont de nombreux ancêtres y ont vécu, c’est tout ce qui est enterré là, sous nos pieds, des milliers d’années de couches de terre, et les trésors qui s’y cachent. La France, c’est le plaisir de savoir qu’en veillant sur un hectare de terre, vous veillez peut-être sur d’importants vestiges.
Europe Maxima : Comment êtes-vous venu au paganisme et comment définirez-vous votre paganisme ? Vous considérez-vous comme völkisch ?
Marie Cachet : Je n’ai pas appris la mythologie. La mythologie c’était pour moi un fouillis de choses diverses. Varg m’en parlait parfois, et alors, avec ma perspective qui était différente, j’ai subitement tout vu clairement. Mon paganisme ? Le paganisme de nos ancêtres était une science, une explication profonde du fonctionnement de la Nature et du monde. De même, la réincarnation est une vérité.
Les traditions, mythologies et contes sont les vecteurs de cette science, et également des outils pour nous sortir de l’Amnésie.
Je ne connais pas les Völkischen, vous savez, je suis loin de toutes ces appellations.
Europe Maxima : Dans l’une des vidéos de votre chaîne YouTube vous affirmez que la permaculture relève du paganisme. Pourriez-vous développer ?
Marie Cachet : La permaculture c’est le paganisme. S’il fallait définir en quelques mots l’opposition fondamentale du paganisme et des religions du désert, je le ferais ainsi : les religions du désert placent l’homme au dessus de la Nature, pour elles, la Nature est l’esclave de l’homme, et l’homme n’a rien a apprendre d’elle, au contraire, il doit la soumettre. Le paganisme, c’est l’exact inverse : l’homme est partie de la Nature, et il est soumis à ces lois, s’il n’obéit pas à ces lois, alors il sera lui-même détruit (bien sûr pas immédiatement, mais après plusieurs milliers d’années). L’homme doit observer la Nature, et apprendre d’elle. Voilà concrètement mon paganisme.
Europe Maxima : Vos positions sur le paganisme, votre critique virulente du christianisme ainsi que votre penchant pour l’écologie peuvent rappeler Robert Dun. Connaissez-vous son œuvre ?
Marie Cachet : Malheureusement, non, sur certains sujets je suis totalement ignorante. Je m’informerai.
Europe Maxima : L’intérêt que vous montrez pour l’Europe en tant que culture s’accompagne-t-il d’un intérêt pour une Europe politique ?
Marie Cachet : Non. Je crois qu’on a fini avec la politique. Les jeux sont faits. La solution moderne revient toute seule : le tribalisme, aussi appelé « communautarisme », l’autonomie et la décroissance. Laissons-les s’amuser avec leur jeu d’échec et disparaissons pendant qu’il en est encore temps. Utilisez l’énergie qu’il vous reste, au sens littéral du terme (le pétrole) pour préparer l’avenir, dans lequel les meilleurs survivront. C’est mon opinion.
L’effondrement de la politique et de l’économie sera alors la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quand j’étais ado, ce qu’il fallait faire pour s’en sortir aujourd’hui, c’était apprendre les codes informatiques, aujourd’hui, ce qu’il faut faire, c’est apprendre la permaculture et la décroissance. C’est ça la vraie modernité, c’est ça la vraie révolution.
Europe Maxima : Quel est votre sentiment sur la situation en France et en Europe ?
Marie Cachet : Ne pas s’agiter, ne pas sommeiller, ne pas faire semblant.
Europe Maxima : Vous êtes une adepte du survivalisme. L’autonomie maximum possible et la préparation à des temps difficiles sont souvent les motivations premières lorsque l’on entreprend une telle démarche. Est-ce aussi à vos yeux une façon de se rapprocher du mode de vie de nos aïeux ?
Marie Cachet : Oui, c’est les deux à la fois. C’est aussi la découverte d’une vie beaucoup plus rassasiante. La permaculture procure un bonheur intense. Réparons le désert laissé par les générations précédentes !
Europe Maxima : À l’instar de votre compagnon vous êtes à l’évidence quelqu’un de créatif. Vous avez réalisé un film intitulé ForeBears, vous animez un site où vous faites part de vos recherches sur l’homme de Néandertal et vous venez de sortir votre deuxième ouvrage Le secret de l’Ourse . Comment vous êtes-vous intéressée à ce lointain ancêtre ?
Marie Cachet : Vous l’avez dit vous-même : notre plus longue mémoire. La même passion que celle qui a poussé Roger Constant à creuser un trou gigantesque dans son jardin, jusqu’à la sépulture Néandertalienne du Regourdou, le flair, l’envie de remonter au bout du bout.
Europe Maxima : Des chercheurs ont récemment attesté, grâce à des preuves « irréfutables » trouvées dans la grotte de Goyet en Belgique, que l’homme de Néandertal était anthropophage. Qu’en pensez-vous ?
Marie Cachet : Néandertal n’était pas anthropophage, c’est mon avis. Ces fameuses « preuves », à Goyet, ou sur d’autres sites, sont des traces de découpe sur les fémurs et sur la nuque. J’explique clairement dans mon dernier livre et à travers les rituels et traditions européennes, pourquoi l’on prélevait les fémurs et/ou têtes des ancêtres. Les tombes renfermant des squelettes sans têtes sont innombrables dans l’histoire de l’Europe. Dans le site du Regourdou (Neandertal, – 70 000 ans), la tête (Mimir) est manquante et les jambes ont été remplacés par des jambes d’ours. Ce rituel a été imagé dans le film ForeBears, et était encore d’actualité chez les Celtes.
Europe Maxima : Vous avez sorti en décembre 2016 votre second ouvrage Le Secret de l’Ourse. Pourriez-vous présenter ce second effort aux lecteurs d’Europe Maxima ? Est-ce la suite de votre livre Le Besoin d’Impossible ?
Marie Cachet : Le Secret de l’Ourse, c’est une clef pour comprendre toutes nos traditions, nos mythologies et nos contes classiques. Absolument tout, des sorcières aux différents dieux, en passant par les dolmens, les grottes ornées, et même par les rituels étranges comme « la petite souris », « la galette des rois » et que sais-je encore…
En un sens oui, c’est la suite du premier livre Le Besoin d’Impossible, mais plutôt pour moi-même, car objectivement, les deux livres sont très différents.
Europe Maxima : Votre théorie est donc que nos mythes, contes et légendes sont en réalité « codés » et qu’ils ne sont pas juste de simples histoires pour les petits et les grands. Selon vous, peut-on parler d’ésotérisme ?
Marie Cachet : Oui, dans le sens réel du terme, on peut parler d’ésotérisme. Ce système de mémoire est génial. Tout un chacun, petit et grand, peut se rappeler de ces histoires simples et appliquer des traditions millénaires, ainsi, les énigmes restent disponibles, et puis certains les comprendront.
Europe Maxima : La lecture que vous faites de tous ces mythes et de facto très matriarcale. Vous êtes vous-même mère de cinq enfants. Cela a-t-il d’une manière ou d’une autre influencé ou « guidé » vos recherches ?
Marie Cachet : On m’a dit cela plusieurs fois, mais je crois que ce n’est pas juste. On est habitué à la dichotomie matriarcal/patriarcal, moi, je n’en vois pas. Le rituel de réincarnation est symbolisé par la grossesse, qui, inévitablement, se passe dans un corps féminin. Cependant la mémoire, l’ancêtre, est souvent imagé par le masculin.
La maternité m’a aidé à comprendre des symbolismes énigmatiques que je n’aurais sans doute pas saisi autrement. Un accouchement naturel, pour une femme, c’est une sortie brutale de la domestication moderne, c’est un rituel de passage. Après mon premier accouchement, la sage-femme m’a demandé : « vous voulez voir le placenta ? ». Moi, j’avais 19 ans, j’aurais eu envie de dire non, mais ma belle-mère, qui étais avec moi, a tout de suite répondu « oui ». C’est alors que j’ai vu cet organe mystérieux, ce jumeau, et qu’elle m’en a expliqué le fonctionnement.
D’ailleurs, comme je le précise dans mon livre, le placenta, c’est le père.
Europe Maxima : À travers la lecture de votre livre on se rend compte de l’importance du placenta, ce qui en définitive est le simple reflet de la réalité. Vous êtes-vous intéressée à l’isotropie placentaire, dorénavant illégale dans ce pays de liberté que l’on nomme France, et à ses bienfaits ?
Marie Cachet : Lors de mon dernier accouchement, à cause des pratiques médicales modernes, j’ai vécu une grave hémorragie de la délivrance. Pour me remettre sur pied, j’ai pu éviter une transfusion, mais j’ai dû avoir des perfusions de fer à haute dose. Si j’avais vécu la même chose en situation dégradée, peut-être que je l’aurais mangé, ce placenta, comme le font tous les animaux, car il est rempli de fer facilement assimilable. En cas d’accouchement normal, je ne l’aurais pas jeté, comme c’est le cas dans les hôpitaux aujourd’hui, mais je l’aurais enterré et j’aurais planté un arbre à ses côtés.
Vous savez, en France, vous pouvez toujours négocier…
Europe Maxima : Votre livre soulève la question de nos vies antérieures, et le constat que vous faites est que l’ancêtre « lutte » pour renaître. Cela expliquerait ainsi les souvenirs de vies antérieures de certaines personnes. La prochaine étape pour vous n’est-elle pas justement de vous remémorer ces vies, de développer une nouvelle forme de maïeutique ?
Marie Cachet : Je ne sais pas. Je crois que ces choses sont trop intimes pour être dévoilées, mais je me trompe peut-être.
Europe Maxima : En définitive faire des enfants serait donc un moyen d’être immortel…
Marie Cachet : En quelque sorte…
• Propos recueillis par Thierry Durolle.
• Marie Cachet, Le secret de l’Ourse. Une clé inattendue pour la compréhension des mythologies, traditions et contes européens, préface de Varg Vikernes, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, 344 p., 32,60 €.
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -
Les différends discours entendus à la marche pour la vie
Discours de Benoît Sévillia à la Marche pour la vie, pour les Eveilleurs d'Espérance
-
50 000 marcheurs pour demander le retrait du texte sur le délit d'entrave
-
#MPLV2017 : fin du direct de la Marche pour la vie 2017
Le cortège n'est pas encore parti de la place Denfert-Rochereau et
#MPLV2017 est déjà en TT France !Cette année, la marche pour la vie prend une dimension particulière avec le vote du délit d'entrave, cette loi totalitaire qui interdit toute personne de dire la vérité sur l'avortement, qui punit quiconque avance un argument contraire à ceux qui promeuvent le meurtre de l'enfant à naître.
Le collectif s'est élargi, la communication s'est portée sur de nouveaux segments et a été particulièrement dynamique!
Et c'est parti place Denfert-Rochereau : la sono a démarré !
Beaucoup de monde donc, malgré les insultes et l'insoutenable appel aux meurtres des vivants des antifas sur le parcours de la #MPLV2017 :
-
La Manif pour tous : retour de boomerang ?
Le plus grand mouvement de contestation vu en France depuis mai 68, aura, par une mauvaise stratégie, perdu le combat qui avait tant mobilisé.
Lors de la dernière Manif pour tous du 16 octobre, Ludovine de La Rochère avait déclaré :
« Je lance un appel solennel aux famille de France : mobilisez-vous, engagez-vous et votez lors des primaires des partis dont vous vous sentez proches. Votez lors des futures élections présidentielle et législative pour les candidats qui prendront en compte la famille. »
Un site d’information a également été lancé pour informer sur la position de chaque candidat à ces primaires et qui sera certainement utilisé pour la présidentielle. Il faut cependant constater qu’aucune grille de lecture récapitulative n’a été faite, et que l’utilisateur doit chercher les informations en lisant toutes les déclarations.
Pour la primaire de la droite, seul Jean-Frédéric Poisson avait des positions conformes aux positions des militants de la Manif pour tous, ce qui ne se voyait pas sur le site, certainement en raison du noyautage du mouvement par Sens commun. Ce manque de lisibilité a probablement permis le détournement des électeurs proches de la Manif pour tous par François Fillon.
Pour la primaire de la gauche, aucun candidat n’a de position compatible avec le combat.
Du côté du Front national, aucune primaire n’est prévue, puisque la candidate du parti, Marine Le Pen, a déjà été choisie. Marine Le Pen a, de toute façon, une position claire sur l’abrogation.
Pour l’élection présidentielle, seule Marine Le Pen souhaite l’abrogation (parmi les candidats médiatiques) ; bien qu’elle soit pour un « PACS amélioré », cette mesure va dans le bon sens. François Fillon, de son côté, ne fait qu’affirmer que cette loi est gravée dans le marbre : si, après une alternance, la loi n’est pas abrogée, alors les chances d’abrogation future seront fortement réduites. De la part d’Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon ou du candidat socialiste, il n’y a rien à espérer, bien au contraire. Et parmi les petits candidats déclarés, il y a bien Robert de Prévoisin qui souhaite l’abrogation : oserai-je demander aux élus qui me lisent d’avoir le courage de lui apporter son parrainage ?
Pour les législatives, on pourra s’attendre à une nouvelle charte, qui sera signée par de nombreux candidats « Les Républicains », qui voteront pourtant toutes les lois LGBT. Faute d’avoir soutenu le seul candidat qui aurait pu défendre la famille lors de la primaire de la droite et du centre, ses électeurs sont privés d’un candidat à la présidentielle, et d’investitures de candidats pro-famille aux législatives. Certains passeront peut-être au vote Front national, en espérant que le candidat investi pour leur circonscription ne soit pas un proche de Florian Philippot.
Ainsi, le plus grand mouvement de contestation vu en France depuis mai 68 aura, par une mauvaise stratégie, perdu le combat qui avait tant mobilisé. En lançant le boomerang, les responsables de la Manif pour tous auraient dû se souvenir qu’un tel instrument peut leur revenir en pleine figure et leur faire très mal ! Serait-il possible d’espérer que, pour l’élection présidentielle, les responsables de la Manif pour tous lancent un appel clair à voter pour le ou les candidats qui veulent réellement l’abrogation, sans condition ?
http://www.bvoltaire.fr/benjaminleduc/manif-retour-de-boomerang,307361
Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, tradition 0 commentaire -
Les Réprouvés d’Ernst Von Salomon : Grandeurs et limites de l’activisme
Bréviaire de plusieurs générations d’aventuriers et de militants (de « gauche » comme de « droite »), « Les Réprouvés » est l’analyse la plus fine des grandeurs et des limites de l’activisme. A travers le récit d’Ernst Von Salomon, on découvre une époque troublée où les explosifs les plus violents étaient les esprits embrasés et où les hommes pouvaient encore jouer à avoir un destin. « Nous croyons aux instants où toute une vie se trouve ramassée, nous croyons au bonheur d’une prompte décision ».
« Peu importe ce qu’on pense. Ce qui compte c’est la manière de le penser »
L’épopée romantique, ne doit pas faire oublier que ce récit est surtout un témoignage sur une expérience personnelle à laquelle l’Histoire a donné une dimension tragique. Von Salomon se garde de tomber dans le manichéisme, sachant par expérience que les idéologies ne sont que des masques pudiques pour les passions humaines. Reconnaissant la valeur de l’adversaire, que ce soit les insurgés communistes poursuivant sous d’autres drapeaux un combat comparable au sien ou bien Walter Rathenau, à qui il rend un hommage riche d’enseignement, il tire de son époque une morale de l’action qui transcende les clivages : « Agir, agir n’importe comment, tête baissée, se révolter par principe, tendre ses énergies par tous les moyens, avec toutes les audaces, le sang ne coule jamais en vain ! ». Les seuls être qui ne trouvent nulle grâce à ses yeux sont les bourgeois, leur lâcheté les lui rend à jamais méprisables.
Malheureusement cet élan vital ne suffira pas pour faire triompher les valeurs portées par les « réprouvés ». Car le manque d’expérience politique et l’ignorance des forces en jeu amènera les soldats perdus à servir les intérêts de cette classe bourgeoise tant haïe. Qui ne s’enracine pas dans le peuple, se laisse emporter par le vent de l’Histoire. C’est toute l’ambiguïté d’une partie de cette génération de combattants qui s’était sacrifiée pour sa Nation. En réalité, celle-ci les avait cyniquement instrumentalisés alors qu’ils pensaient lutter pour des valeurs héritées, dignes d’êtres défendues. Néanmoins, ils s’étaient plutôt construit une Nation idéale mais, d’une certaine façon, concrètement vécue sur la ligne du front, au coeur de la guerre. Toutefois, que pouvait-elle valoir, lorsque que ces hommes revinrent à la vie civile? Condamner la médiocrité de la vie bourgeoise prosaïque témoigne bien d’une certaine conscience de l’aliénation vécue quotidiennement mais ne suffit pas, pour remettre clairement en question, les fondements du système ayant conduit à la boucherie de la guerre impérialiste.
« La guerre est finie : les guerriers marchent toujours »
Elevé pour servir un ordre qui s’écroule avec l’armistice de Novembre 1918, Von Salomon se retrouve orphelin d’un Empire idéalisé. Il va rejoindre les colonnes revenant du front et, qui comme lui se sentent perdues dans cette Allemagne au bord du chaos.
Seules subsistent encore les valeurs guerrières forgées par les années de tranchées, la communauté fraternelle des camarades servant de refuge face aux bouleversement de leur époque. « La Patrie était en eux, et en eux était la Nation » écrit Von Salomon qui comprit que lorsque la majorité décide de capituler, il ne reste aux hommes libres qu’à rester fidèles à eux-mêmes.
Ces troupes seront mises à contribution par la République de Weimar afin de liquider la révolution spartakiste dans un Berlin surréaliste, où la luxure des cabarets côtoie les derniers combats de rue. Sale besogne qui entachera les drapeaux des corps-francs. Les guerriers vont comprendre trop tard qu’ils ont sauvé leur pire ennemi, la bourgeoisie, et se condamner. C’est alors que vers l’Est de nouveaux combats éclatèrent. La nouvelle époque, celle du Baltikum, permit d’oublier l’amère « victoire » de Berlin. Voulant garantir les frontières de l’Allemagne à l’Est, ils furent utilisés par le système pour faire barrage à l’avancée communiste de la jeune Union Soviétique.
Les « desperados de la Nation » traînèrent leurs guêtres de la Lettonie à la Silésie, combattant sans cesse pour finir une nouvelle fois poignardés dans le dos par le régime de Weimar. « Nous avons tendu la victoire comme une coupe précieuse sur nos mains prêtes au sacrifice. Mais ils l’ont laissé tomber par terre, et elle s’est brisée sur leurs pieds ». La marche vers l’Est avait été un moyen de fuir les bassesses de la démocratie, qui finirent pourtant par les rattraper. Leur retour à la vie civile les laissèrent sans repère : « A l’époque, l’Allemagne était pour lui un pays de soixante millions d’hommes qui avaient le sentiment de ne pas être à leur place et de quelques autres qui n’étaient pas du tout à leur vraie place ».
La Nation Impossible
Condamnés à revenir vers ce monde qu’ils fuyaient, soldats sans armée, il ne leur restait qu’à devenir des terroristes. Ce plongeon dans la clandestinité donne à l’aventure un tournant individualiste qui fait de Von Salomon plus un aventurier qu’un militant. D’abord, dans la Ruhr occupée par les alliés, puis en menant un activisme débridé contre l’Etat. La violence que ces soldats perdus exerceront contre leur propre gouvernement ne pouvait être comprise par les masses.
Le choix d’assassiner Walter Rathenau s’éclaire au soleil noir d’un nihilisme refusant totalement une société négatrice de leurs valeurs (dont le ministre social-démocrate était l’incarnation intolérable). Il fut donc leur victime expiatrice, non du fait qu’il était le responsable de l’armistice ou parce qu’il était d’origine israélite, mais parce qu’il incarnait, par sa valeur, l’avenir du système…
Fournissant la voiture qui servit aux lieutenant de vaisseaux Kerm et Fischer pour abattre leur victime, Von Salomon sera traqué dans sa tentative de retrouver ses camarades encerclés. Ils se suicideront pour éviter la capture, ce destin ne sera pas offert à l’auteur. Arrêté, il passera plusieurs années en prison. Au bout de trois années d’isolement, on l’autorisera à recevoir un livre, Le Rouge et le Noir de Stendhal et à en écrire un, Les Réprouvés. Dès sa publication, il exercera une fascination qui est loin d’être éteinte.
Von Salomon à sa sortie de prison devra assurer sa survie par de multiple petits boulots, avant de trouver sa voie comme scénariste pour les studios de cinéma. Amoureux de la France, il s’installe un temps au Pays Basque. Toujours en contact avec la mouvance national-révolutionnaire, il observe la montée du nazisme. Après la prise de pouvoir par Hitler, il refuse les honneurs que lui offre le régime et s’enferme dans un «exil intérieur» comparable à celui d’Ernst Jünger. A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, il sera inquiété par les Américains . Ceux-ci n’ayant rien à lui reprocher au final, il sera libéré après plusieurs mois d’internement et reprendra son activité cinématographique,avant de mourir en 1972.
http://www.voxnr.com/7466/les-reprouves-dernst-von-salomon-grandeurs-et-limites-de-lactivisme
-
Samedi dernier : c'était la journée de la fierté parisienne et la marche en honneur à Sainte Geneviève
Samedi 14 janvier, l’association Paris Fierté invitait une nouvelle fois les Parisiens à venir célébrer la culture et l’histoire de leur ville.
A 15 h, le public était accueilli sur une péniche pour se retrouver dans un bistrot guinguette à la parisienne. La péniche a vite été pleine à craqué, et la bonne humeur était de rigueur !
A l’issue de la journée, mille Parisiens se sont rendus aux flambeaux en l’honneur de Sainte-Geneviève. Les musiques populaires ont succédé aux slogans à la gloire de Paris, dans un spectacle son et lumière qui a ravi les passants.
Le formidable succès de cette journée prouve, une fois de plus, que les parisiens ne sont pas prêts d’abandonner leur ville : demain comme aujourd’hui, ils défendront Paris !
