En 1979 mourrait Herbert Marcuse, le penseur utopiste de la Nouvelle Gauche soixante-huitarde. Werner Olles, ancien agitateur des barricades allemandes à la fin des années 60, fait le point vingt ans après cette date et rappelle l’engouement de sa génération pour Éros et civilisation et L’Homme unidimensionnel.
***
Marcuse nous disait : « Je pense qu’il existe pour les minorités opprimées et dominées un droit naturel à la résistance, à utiliser des moyens extra-légaux dès que les moyens légaux s’avèrent insuffisants. La loi et l’ordre sont toujours et partout la loi et l’ordre de ceux que protègent les hiérarchies établies. Il me paraît insensé d’en appeler à l’autorité absolue de cette loi et de cet ordre face à ceux qui souffrent sous cette loi et cet ordre et les combattent, non pas pour en tirer des avantages personnels ou pour assouvir une vengeance personnelle, mais tout simplement parce qu’ils veulent être des hommes. Il n’y a pas d’autre juge au-dessus d’eux sauf les autorités établies, la police et leur propre conscience. Lorsqu’ils font usage de la violence, ils n’amorcent pas un nouvel enchaînement d’actes violents, mais brisent les institutions établies. Comme on pourra les frapper, ils connaissent les risques qu’ils prennent, et quand ils ont la volonté de se révolter, aucun tiers n’est en droit de leur prêcher la modération, encore moins les éducateurs et les intellectuels ».
Ces quelques phrases sur la « tolérance répressive », tirées de sa Critique de la tolérance pure ont eu un impact considérable et durable sur le mouvement étudiant de 1968. Dès mai 1966, Herbert Marcuse, professeur de philosophie sociale à l’Université de Californie à San Diego, avait prononcé la conférence principale lors d’un congrès sur la guerre du Vietnam tenu à l’Université de Francfort à l’invitation du SDS (le mouvement des étudiants gauchistes allemands de l’époque). Devant 2.200 personnes, Marcuse constatait que « toutes les dimensions de l’existence humaine, qu’elles soient privées ou publiques étaient livrées aux forces sociales dominantes » et que le système ne connaissait plus aucun « facteurs extérieurs » :
« La politique intérieure, dont la continuation est la politique extérieure, mobilise et contrôle l’intériorité de l’homme, sa structure pulsionnelle, sa pensée et ses sentiments ; elle contrôle la spontanéité elle-même et, corollaire de cette nature globale et totale du système, l’opposition n’est plus d’abord politique, idéologique, socialiste (…). Ce qui domine, c’est le refus spontané de la jeunesse d’opposition de participer, de jouer le jeu, c’est son dégoût pour le style de vie de la “société du superflu” (…). Seule cette négation pourra s’articuler, seul cet élément négatif sera la base de la solidarité et non pas son but : il est la négation de la négativité totale qui compénètre la “société du superflu” ».
Dutschke défendait l’attitude de l’intellectuel
En juillet 1967, Marcuse, devant 3.000 personnes entassées dans les auditoires bourrés de la Freie Universität de Berlin-Ouest, prononçait sa série de conférences en quatre volets, « La fin de l’Utopie ». Sans cesse interrompu par les applaudissements des étudiants, le penseur dissident du néo-marxisme explicitait une fois de plus ses positions sur le « problème de la violence dans l’opposition ». Lors de la troisième soirée, une discussion a eu lieu sous la direction du philosophe et théologien Jacob Taubes : y participaient plusieurs membres du SDS, dont Hans-Jürgen Krahl, Rudi Dutschke, Peter Furth et Wolfgang Lefèvre, ainsi que les professeur d’université sociaux-démocrates Richard Löwenthal et Alexander Schwan. Ils engagèrent tous un débat avec Marcuse sur le thème : « Morale et politique dans la société d’abondance ». Lors de la quatrième soirée, Marcuse, Dutschke, Peter Gäng, Bahman Nirumand et Klaus Meschkat ont discuté du « Vietnam : le tiers-monde et l’opposition dans les métropoles ». Ce fut surtout Marcuse qui tenta de donner une explication de cette question en parlant du rôle que pouvaient jouer les intellectuels dans le processus d’éclosion et de consolidation des mouvements de libération dans les métropoles. Pour Marcuse, le rôle des intellectuels consiste à éclairer les masses en révolte en « reliant la théorie et la pratique politique ». Il proclama également la constitution « d’une anti-politique dirigée contre la politique dominante ».
Mais un an plus tard, toujours dans le grand auditoire de l’Université Libre de Berlin, il essuie le refus concentré des étudiants, lorsqu’il prononce sa conférence sur « l’histoire, la transcendance et la mutation sociale » ; il dit clairement aux activistes de la Nouvelle Gauche qu’il ne songe nullement à donner sans détour des conseils pour organiser la révolution ni a y participer. Plus tard, Rudi Dutschke a dit qu’il comprenait l’attitude de Marcuse à l’époque. Il l’a défendu âprement face aux critiques acerbes des étudiants les plus radicaux qui voulaient infléchir le processus révolutionnaire dans une seule dimension, celle, exagérée, de la guerre civile.
Herbert Marcuse, mélange génial de Marx, Freud et Isaïe, penseur éclectique, subjectiviste et néo-marxiste, figure du père dans la révolution culturelle de 68, est né le 19 juillet 1898 dans une famille de la grande bourgeoisie juive de Berlin. Devenu membre de la SPD sociale-démocrate, il appartenait aux courants vitalistes des jeunes socialistes, proche du mouvement de jeunesse. Après l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg, il quitte la SPD et adhère à l’USPD (les socialistes indépendants plus radicaux et révolutionnaires). En 1918, il est membre d’un conseil de soldat à Berlin-Reinickendorf. Ensuite, il s’en va étudier à Berlin et à Fribourg, où il passe son doctorat en rédigeant une thèse sur Schiller. À Fribourg, il a été pendant un certain temps l’assistant de Heidegger. Mais les éléments nettement conservateurs de la pensée de Marcuse ne lui viennent pas directement de Heidegger mais d’une lecture très attentive de Hans Freyer, dont l’ouvrage Theorie des gegenwärtigen Zeitalters (Théorie du temps présent) a fortement imprégné les thèses exposées plus tard dans L’Homme unidimensionnel. Pedro Domo démontre dans Herrschaft und Geschichte : Zur Gesellschaftstheorie Freyers und Marcuses (Domination et histoire : À propos de la théorie de la société chez Freyer et Marcuse) que l’influence de Freyer s’est exercée sur Marcuse tout au long de sa vie. Même affirmation chez un autre analyste, Wolfgang Trautmann (in : Gegenwart und Zukunft der Industriegesellschaft : Ein Vergleich der soziologischen Theorien Hans Freyers und Herbert Marcuses ; Présent et avenir de la société industrielle : Comparaison des théories sociologiques de Hans Freyer et de Herbert Marcuse). À cette influence de Freyer dans la composante conservatrice de Marcuse, il faut ajouter le véritable culte qu’il vouait à Schiller, héritage de la vénération que lui vouait le mouvement de jeunesse socialiste au tournant du siècle. Ce culte de Schiller a très vraisemblablement entraîné le mépris quasi féodal de Marcuse pour les sciences, la technique et la démocratie. Kolakowski l’a d’ailleurs décrit comme « le prophète d’un anarchisme romantique sous une forme hyper-irrationnelle ».
En effet, Marcuse propageait un « socialisme des oisifs ». Dans leur recherche d’un sujet révolutionnaire après la fin du marxisme et du progrès, les intellectuels de la classe moyenne aisée et les franges politisées du Lumpenproletariat ont fini par rencontrer cet idéologue de l’obscurantisme, qui constituait une symbiose entre Marx et Freud. En bout de piste, cela a donné l’utopie de la Nouvelle Gauche. Marcuse interprétait toutefois Marx à l’aide de critères pré-marxistes ; il voyait en lui un sociologue et non un économiste scientifique. Ensuite, il voyait en Freud un « adepte sceptique des Lumières ». Ce mélange a produit finalement cette idéologie de 68, caractérisée par le non sérieux relatif de la vie de l’éternel étudiant.
Cohn-Bendit a diffamé Marcuse en l’accusant d’être un agent de la CIA
Herbert Marcuse a quitté l’Allemagne sous la République de Weimar, en 1932, quand les nationaux-socialistes n’avaient pas encore pris le pouvoir. Il émigre aux États-Unis. Il y devint conseiller en guerre psychologique à l’Office of Strategic Services (OSS), une organisation militaire qui a préfiguré la CIA. C’est de cette époque que datent les études que l’on appelle “analyse de l’ennemi”. Le passé de Marcuse à l’OSS a induit Daniel Cohn-Bendit, un jour, à diffamer Marcuse, qu’il a accusé à Rome d’être un agent de la CIA, ce qui est objectivement faux.
Plus tard, Marcuse a enseigné la philosophie à l’Université d’État en Californie à San Diego. En ce temps-là, il vivait à La Jolla en Californie. À l’âge de 81 ans, le 29 juillet 1979, il meurt à Starnberg en Allemagne, à la suite d’une thrombose. Aujourd’hui, notre intention ne saurait être de récupérer et de redécouvrir Marcuse dans un sens “conservateur-révolutionnaire”. La pensée de ce néo-marxiste a été beaucoup trop influencée par la mystification de la révolution mondiale, même s’il ne plaçait plus aucun espoir dans la classe ouvrière, mais, au contraire, dans les groupes marginalisés de la société, refusant toujours davantage le système.
Ensuite, autre volet de la pensée de Marcuse : il concevait la « société technologique » de plus en plus comme un moyen d’asservir le prolétariat ; celui-ci était de toute façon lié au système capitaliste de la satisfaction et de l’élargissement des besoins. Dans un tel contexte, la position du prolétariat est purement défensive. L’économie, pour Marcuse, est toujours une économie politique qui ne produit jamais une « économie psychologique ». L’économie dominante gère les besoins que réclame le système, jusqu’aux pulsions les plus élémentaires.
Puisque le capitalisme a absorbé le « potentiel révolutionnaire » et que l’ère révolutionnaire du prolétariat est définitivement passée, n’explique pas pourquoi la « théorie critique » et la « praxis politique » n’ont pas coïncidé partout. Pourtant Marcuse voyait dans l’indépendance nationale un facteur positif. Il soutenait la guérilla nationale-communiste au Vietnam, corollaire de sa définition des États-Unis comme « héritiers historiques du fascisme ». Aucun immigrant n’avait formulé auparavant une critique aussi acerbe contre la politique américaine. Mais Marcuse n’avalisait pas pour autant la politique soviétique, qui convergeait de plus en plus avec celle des États-Unis. Il la qualifia un jour de « honteuse », ce qui lui a valu la haine tenace des gauches fidèles à Moscou. Il était cependant assez réaliste pour reconnaître que la Nouvelle Gauche n’allait jamais devenir un mouvement de masse. Raison pour laquelle il a limité sa thématique aux perspectives pluri-dimensionnelles de la théorie dialectique, visant la suppression de la « société d’abondance », le prise de conscience psychologique et sensitive de la répression dans les métropoles occidentales et de l’oppression flagrante et impérialiste des peuples du tiers-monde.
Par ailleurs, Marcuse prônait l’instauration d’un « pré-censure », qu’il nommait avec euphémisme un « idéal platonicien », et une dictature provisoire de la gauche, qu’il baptisait « éducation » (Erziehung), et qui devait préparer l’avènement d’une « société humaine ». Dans l’existence qui attendait les hommes au sein de cette « société humaine », le rois-philosophes d’inspiration platonicienne devaient veiller sans discontinuité à ce qu’il n’y ait plus jamais de guerre, de cruauté, d’agressivité, de stupidité, de brutalité et de racisme. Dès que cette hydre à têtes multiples se manifestait, les rois-philosophes devaient intervenir et sévir. Ainsi, l’utopie deviendrait possible, elle serait une société véritablement libre. Cette vision marcusienne contredit toutefois à terme son idéal libertaire d’inspiration nietzschéenne, héritée du mouvement de jeunesse. La “pré-censure” et “l’éducation” indiquent une contradiction majeure dans cette pensée subversive de gauche.
Max Horkheimer a reproché à Marcuse de se retrancher derrière le concept « d’homme nouveau ». Horkheimer s’insurgeait avec véhémence contre la domination du principe de plaisir et contre l’idée naïve qu’une société de masse puisse vivre sans aucune contrainte. De la pensée de Marcuse, il restera donc cette dénonciation de la rationalité technologique comme expression de l’arbitraire, tendant vers le totalitarisme. Sa thèse disant que « la technologie livre la grande rationalisation pour la non-liberté de l’homme » est restée actuelle et réelle. Elle exprime clairement les sentiments d’un philosophe qui a vécu et pensé la crise de l’existence humaine comme une crise de la philosophie. Restent également sa critique de la « société unidimensionnelle », de la liberté illusoire (qui risque de chavirer dans « le déluge de scepticisme »). Unidimensionnalité et liberté illusoire ont conduit à des quiproquos philosophiques terribles dont souffrent encore nos sociétés de masses modernes.
Le “grand refus” de Marcuse
Le “grand refus” de Marcuse n’offrait toutefois pas de contre-modèle concret à l’unidimensionnalité du capitalisme tardif. Il n’a pas été capable de générer une conception de la vie, un “oïkos” alternatif, susceptible d’offrir à l’individu un éventail de possibilités afin d’échapper ou de résister à « la destruction totale et incessante des besoins de l’homme dans la conscience même de l’homme » (Hans-Jürgen Krahl). Telle a bien été la plus grande faiblesse de cet éclectique qui n’a pas pu se corriger, même dans la lutte collective pour l’émancipation menée par la Nouvelle Gauche (pour laquelle Marcuse a toujours témoigné sa sympathie). La raison de cet enlisement provient de ce que les contradictions quotidiennes du système capitaliste tardif ne se reflètent plus dans la conscience des masses. La subtilité des rapports de domination finit par conditionner la psychologie même des hommes.
Ainsi, la répression assortie de l’accord tacite entre le facteur subjectif et le maintien tel quel de la réalité de classe, dans un système de pouvoir très complexe, anonyme et technocratique, a conduit à l’échec du mouvement de 68.
► Werner Olles, Nouvelles de Synergies Européennes n°41, 1999.
(texte issu de Junge Freiheit n°31-32/1999)

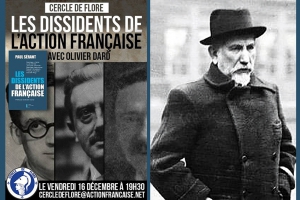 Olivier Dard
Olivier Dard

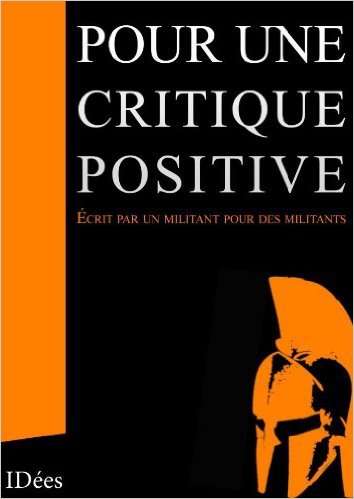 Pour une critique positive est une œuvre singulière dans la bibliographie de Dominique Venner. Singulière car c’est un texte du Venner combattant politique avant qu’il ne devienne l’historien méditatif que nous connaîtrons par la suite, singulière par ses conditions de rédaction (en prison où l’opposition radicale de Dominique Venner au général De Gaulle l’avait mené), singulière car Venner finira par ne plus reconnaitre cet écrit de jeunesse, singulière enfin parce qu’en faisant ainsi, Venner allait laisser Pour une critique positive acquérir une vie propre et devenir le Que faire de la mouvance nationaliste.
Pour une critique positive est une œuvre singulière dans la bibliographie de Dominique Venner. Singulière car c’est un texte du Venner combattant politique avant qu’il ne devienne l’historien méditatif que nous connaîtrons par la suite, singulière par ses conditions de rédaction (en prison où l’opposition radicale de Dominique Venner au général De Gaulle l’avait mené), singulière car Venner finira par ne plus reconnaitre cet écrit de jeunesse, singulière enfin parce qu’en faisant ainsi, Venner allait laisser Pour une critique positive acquérir une vie propre et devenir le Que faire de la mouvance nationaliste. Voici le nouveau numéro de l’excellent magazine L’Héritage (« revue d’études nationales »), que nous vous recommandons vivement.
Voici le nouveau numéro de l’excellent magazine L’Héritage (« revue d’études nationales »), que nous vous recommandons vivement.