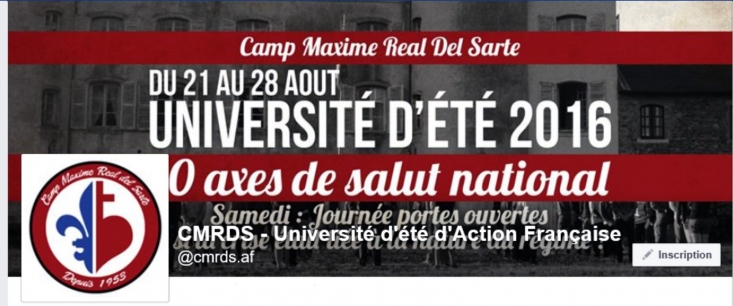Séance de travail de la nouvelle jeunesse d'Action française au Camp Maxime Real Del Sarte
Voici quelle était l'introduction - de 1972 - du « carnet de chants » que plusieurs générations de militants d’Action française ont tenu dans leurs mains, lors de leurs repas ou de leurs veillées. Et, comme dit Brasillach, « nos feux de camp parmi la nuit », dont voici la saison revenue, ce weekend d'août ... Mais les jeunes d’Action française d’aujourd’hui chantent aussi, beaucoup et plutôt bien. Et le « créneau » que nous signalait l’auteur de ces lignes - qui était aussi l'auteur de ce carnet de chants - demeure ouvert et libre. Après tout, un véritable « printemps français » aura aussi besoin de chants puisés à notre Tradition … Une fois faites les actualisations nécessaires, ce qui est proposé ici nous semble aussi pertinent qu’il y a quarante ans. Réfléchissons-y ! LFAR
« NARCISSISME » de la boue (Koestler) ou toxicomanie musicale, l'éthique pop ne prend pas en France. Le hululement électronique des orchestres livides et chevelus nous laisse froids : l'échec des festivals de l'été démontre le fossé culturel qui sépare l'underground américain du malaise français. Seuls se sentiront concernés par les valeurs de Woodstock les chrétiens-progressistes et les bourgeois d'âge mûr qui se bousculaient à Hair. De fait, le refus d'une certaine société de consommation s'exprime des deux côtés de l'océan selon des structures différentes. Nous sommes trop enracinés pour nous réfugier dans les « arrières-mondes consolateurs » et les paradis artificiels ; trop occidentaux pour sombrer avec les clochards hippies dans un dévergondage du bouddhisme. Contrairement aux jeunes « contestants » américains, nous ne combattons pas cette société mercantile comme l'aboutissement logique de nos valeurs héritées (nos « préjugés » en langage maelstrom mais comme leur despotique contraire. Là ou les radicaux d'outre-Atlantique, coupés de tout capital séculaire, sautent dans l'informe et l'indéfini, l’instinct national guide notre révolte vers un retour aux sources françaises.
Ceci pour en arriver au succès des « folk-singers » à la française qui recèle, dans le cas d'Ogeret, Rocheman ou Kerval, un contenu politique implicite. Ceux-là sont gauchistes ou gauchisants, par mode ou conviction, et s'efforcent de raccorder leur sélection musicale au folklore de mai 68, clause sine qua non d'une honnête diffusion commerciale par les capitalistes du disque. Mais le phénomène est en lui-même ambigu, voire contradictoire : l'écho, la vibration profonde éveillée par les mélodies frustes ou raffinées de l'ancienne France, submergent les méticulosités doctrinaires de la rive gauche.
C'est une adhésion de la sensibilité, un sentiment de « déjà vécu » traduisant l'inconsciente fidélité au passe national comme l'attachement quasi-biologique, à la particularité française. Ceci est infiniment plus fort que d'artificieux parallèles entre l'histoire et les comédies barbares de Nanterre. Les refrains des grenadiers de Montcalm, les complaintes acadiennes, les ritournelles en l'honneur du roi, les malédictions paysannes contre le « maître de la guerre » ou le prince-évêque de Montbéliard, ou les gracieux couplets parisiens de « la Bataille de Fontenoy », sont irréductibles aux vivisections marxistes. La chanson traditionnelle en France est par nature engagée dans le nationalisme, et résiste au nivellement cosmopolite.
Le fait se vérifie autour des brasiers nocturnes de Carnac, dans les bistrots rochelais ou les campings méridionaux, quand les vacanciers se muent en auditeurs et bissent ces jeunes inattendus qui chantent sur des rythmes familiers la gloire et la douceur anciennes...
La chanson populaire est, à l'échelon culturel, un appréciable véhicule de propagande « tous azimuts » : la communication entre classes d'âge différentes, entre parisiens et régionalistes, entre jeunes d'obédiences politiques antagonistes, devient possible et fructueuse le temps d'une rencontre, quand se recompose au hasard d'un refrain cette « joie Ancien Régime » dont parle La Varende (les Manants du roi) comme d'une rare étincelle dans l'orage moderne. Au-delà des démonstrations objectives de la science politique, le mode d'expression du « folk-song » représente à la fois le cri d'un traditionalisme et la manifestation d'une large « amitié française ».
Les jeunes d'A.F. sentent l'occasion payante d'intervenir sur un terrain à peu près inoccupé pour l'instant. Il s'agit de récupérer le courant qui se dessine et de lui rendre son contexte politique normal. Un train vient déjà d'être manqué avec la résurrection musicale bretonne, trop souvent contrôlée par des noyauteurs qui lui insufflent un contenu européoséparatiste ; d'autres trains s'ébranlent vers de fausses directions, particulièrement en terre occitane où s'évertuent les gauchistes sur consignes parisiennes. Le moment est opportun d'entamer sur ce terrain nouveau l’action qui ajoutera au travail d'Action française, une antenne supplémentaire, et qui soustraira aux adversaires de l'unité nationale le monopole de fait dont ils jouissaient jusqu'a présent. L'affaire est sérieuse et intéressante.