Pour la Russie et la Liberté,
Nous sommes prêts, nous les Kornilovtzy,
A nous jeter à l'eau,
A nous jeter au feu!
Marchons au combat, au sanglant combat!
Chant de marche des Volontaires, Campagne du Kouban, 1918.
Lors du cinquantième anniversaire du coup d'État bolchévique en 1967, on assista dans le monde entier, et tout spécialement en France, à une débauche de propagande et de bourrage de crâne en faveur du régime rouge: ce fut le délire, un délire soigneusement organisé, subsidié et contrôlé par les “Organes”. Combien d'intellos parisiens n'ont pas émargé aux fonds secrets soviétiques? Certains (les mêmes parfois) touchent aujourd'hui d'autres chèques... Ainsi va (leur) monde... En réaction contre cette désinformation, il y eut le livre de Marina Grey et de Jean Bourdier consacré aux Armées blanches (Stock 1968, paru en Livre de Poche, n°5116). Marina Grey est la fille du Général Dénikine, qui commanda la fameuse Division de Fer lors de la Première Guerre mondiale: le Maréchal Foch et Churchill ont dit de lui qu'il avait contribué à la survie des Alliés sur le front ouest. Anton Dénikine, pourtant acquis aux idées libérales et critique à l'égard des insuffisances de Nicolas II, sera Régent de Russie et l'un des principaux chefs blancs.
Sa fille, née en Russie libre, a écrit une excellente évocation de l'épopée des Vendéens russes, ces rebelles qui, refusant la servitude et la terreur bolchéviques, se battent à un contre cent avec un panache extraordinaire. Cette étude écrite comme un roman, se fondait sur des archives privées d'émigrés, des revues parues en exil, à Buenos Aires, Paris ou Bruxelles (saluons au passage Sa Haute Noblesse feu le capitaine Orekhoff, éditeur à Bruxelles de La Sentinelle et, en 1967, du Livre blanc sur la Russie martyre!), des mémoires rédigés en russe par des officiers rescapés du génocide communiste (au moins dix millions de morts pour la Guerre civile). P. Fleming, le frère de Ian, avait signé un beau livre sur l'amiral blanc Koltchak et plus tard, Jean Mabire avait sorti la belle figure d'Ungern de l'oubli dans un roman, qui a marqué toute une génération. Mais les Blancs, malgré ces efforts, restaient des maudits, bien plus en Occident qu'en Russie occupée!
Vers 1980, un texte du samizdat russe expliquait que, dans les cinémas soviétiques des années 70, lorsqu'on montrait des Gardes blancs (vrais ou non, mais montrés du doigt comme des vampires), souvent les jeunes se levaient d'un bloc, sans un mot. Un de ces adolescents avait écrit à une revue émigrée, une superbe lettre ouverte aux derniers Blancs pour leur dire son admiration. La SERP nous offre toujours un bel enregistrement de marches de l'ancienne Russie et les Cosaques de Serge Jaroff nous restituaient les chants des Blancs... autrement plus beaux que les chœurs de la défunte Armée rouge qui, pourtant, avaient une classe indéniable par rapport aux misérables chansonettes des armées anglo-saxonnes qu'on tente de nous faire passer pour le comble du génie.
Mais voilà que Dominique Venner, déjà auteur d'une Histoire de l'Armée rouge (ouvrage couronné par l'Académie française), vient combler ce vide regrettable. Il s'attaque à la Guerre civile, épisode soigneusement occulté de l'histoire soviétique. L'hagiographie marxiste passait sous silence la résistance des Blancs, ou alors ne parlait que de “bandes” de réactionnaires au service du capital, etc. Venner s'est replongé dans cette époque tout compte fait mal connue: peu de livres en langue occidentale, censure générale sur le sujet (tabou dans les universités européennes, alors que les chercheurs américains ont publié pas mal de thèses sur les Blancs), et surtout blocage mental sur ces épisodes qui contredisent la version officielle des faits pour une intelligentsia européenne qui subit encore une forte imprégnation marxisante, souvent inconsciente: une résistance populaire à la “révolution” communiste ne va pas dans le “sens de l'histoire”! Comme le dit justement Gilbert Comte dans le Figaro littéraire du 6 novembre 1997: «Triste modèle des démissions de l'intelligence, quand l'histoire écrite par les vainqueurs devient la seule qu'il soit possible d'écouter». On connaît cela pour d'autres épisodes de notre histoire et le procès Papon, une gesticulation inutile, en est le dernier (?) exemple. Il n'y a pas qu'à Moscou que les procès sont des farces orwelliennes...
Venner a donc lu des témoignages écrits à chaud (voyageurs, diplomates, journalistes), ce qui lui permet de rendre l'esprit de l'époque. Une seule critique vient à l'esprit à la lecture de son beau livre: peu de sources russes et pas de témoignages de première main. Il est vrai que pour trouver des rescapés des Armées blanches en 1996... Mais ces hommes, officiers, civils, soldats ont laissé des écrits: mémoires, archives, articles dans la presse émigrée. Paris, Kharbine en Mandchourie, Bruxelles, Berlin ou Buenos Aires furent des centres actifs de l'Emigratziya. Les revues, journaux, livres rédigés par des combattants blancs se comptent par centaines. Il y a là une masse de documents énorme à analyser. Il existe encore des Associations de la Noblesse russe où de Volontaires qui possèdent des archives du plus haut intérêt et les archives soviétiques doivent aussi receler des trésors... Mais ne faisons pas les difficiles! Le travail de Venner est une réussite complète. Signalons seulement qu'il reste du pain sur la planche pour de futurs chercheurs!
Venner étudie les Rouges et les Blancs, ce qui est neuf: il analyse les points forts et les faiblesses des uns et des autres. Sa description des événements est précise, militaire: il montre bien à quel point la guerre fut atroce. Surtout, il prouve que les Blancs, ces “vaincus” de l'histoire officielle, ne furent pas loin de l'emporter sur les Rouges. Fin 1919, Lénine s'écrie: «nous avons raté notre coup!». C'est Trotsky qui sauvera le régime, avec ses trains blindés et sa vision très militariste de la révolution. Il y a d'ailleurs chez Lev Davidovitch Bronstein un côté fascistoïde avant la lettre!
Pour la Russie, l'alliance avec la France fut une catastrophe: l'Etat-Major impérial est fidèle à ses promesses, jusqu'à la folie. Mal armée (usines d'armement peu productives), mal commandée (généraux incapables), sans doute trahie au plus haut niveau (la Tsarine ou son entourage), l'armée russe subit une terrible saignée: 2,5 millions de tués en 1915! Ces millions de moujiks tués ou estropiés sauvent la France du désastre: si le plan Schlieffen ne réussit pas à l'ouest, c'est en partie grâce aux divisions sacrifiées de Nicolas II. En 1940, ce même plan, actualisé (frappes aériennes et panzers) réussira grâce à l'alliance de fait germano-russe (pacte Ribbentrop-Molotov). En 1917, l'armée est à bout, et 1a personnalité du monarque, une vraie fin de race, n'arrange rien. Seul le Grand-Duc Nicolas aurait pu sauver la mise, après la mort de Stolypine (assassiné en 1911 par un revolutionnaire juif), ce qui fut un désastre pour toute l'Eurasie. Les trop vagues projets de coup d'état militaire visant à renverser ce tsar incapable ne se réalisent pas... mais le corps des officiers est préparé à lâcher ce dernier, que même le roi d'Angleterre n'a pas envie de sauver.
Ce sont des officiers comme Alexeiev ou Korniloff, futurs chefs blancs, qui joueront un rôle dans son abdication tardive. Preuve que les Blancs n'étaient pas des nostalgiques de l'ancien régime, mais des officiers qui souvent servent d'abord Kerenski, même s'ils méprisent à juste titre ce bavard incapable (un politicien). On peut d'ailleurs se demander si le ralliement au régime rouge de tant d'officiers tsaristes n'a pas été partiellement facilité premièrement par les revolvers (Nagan, au départ une conception liégeoise) délicatement braqués dans leur nuque, mais aussi par le dégoût inspiré par la cour de Nicolas II. Dénikine lui-même avait été scandalisé par le lâchage par le tsar de son meilleur ministre, Stolypine.
Un des nombreux mérites du livre de Venner est de camper tous ces personnages historiques avec un talent sûr. Le portrait de Lénine, qui était la haine pour le genre humain personnifiée, celui de Trostky, sont remarquables. Venner montre bien que là où les Bolchéviks trouvent face à eux une résistance nationaliste, ils sont vaincus, comme en Finlande, en Pologne. Les armées de paysans attachés à leurs traditions ancestrales sont toujours plus fortes que celles des révolutionnaires citadins, fanatiques mais divisés en chapelles. Un des mérites du livre est d'insister sur la respansabilité de Lénine dans le génocide du peuple russe: c'est lui qui met en place le système du goulag, et non Staline. Les premiers camps d'extermination communistes datent de l'été 1918. Toutes ces ignominies, dont Hitler ne fut qu'un pâle imitateur, découlent de l'idéologie marxiste, qui est celle de la table rase (au moins 25 millions de tués de 1917 à 1958!). La révolution blochévique vit une véritable colonisation de la Russie par des étrangers: Polonais, “Lettons”, et surtout des Juifs, animés d'une haine viscérale pour la Russie traditionnelle, qui ne leur avait jamais laissé aucune place au soleil.
Cette révolution est en fait le début d'une gigantesque guerre civile d'ampleur continentale: le fascisme, le nazisme sont des ripostes à cette menace, avec toutes les conséquences que l'on sait. L'historien allemand Ernst Nolte l'a très bien démontré au grand scandale des historiens établis qui aiment à répéter les vérités de propagande dans l'espoir de “faire carrière”. Mais ces vérités, dûment démontrées en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, passent mal en France où sévit encore un lobby marxisant, qui impose encore et toujours ses interdits. Voir les déclarations ridicules de Lionel Jospin, impensables ailleurs en Europe. Voir le scandale causé par le livre de S. Courtois sur les 85 millions de morts du communisme, qui réduit à néant les constructions intellectuelles du négationnisme des établissements, qui, s'ils ont souvent trahi leurs idéaux de jeunesse, ont gardé intactes leur volonté de pourrir notre communauté. Mais ces viles canailles politiques n'ont plus l'ardeur de la jeunesse: ils ne croient plus en rien et n'ont plus au cœur que la haine et le ressentiment pour toutes les innovations qui pointent à l'horizon. A leur tour de connaître la décrépitude et le mépris, des 20 à 30% de jeunes qu'ils condamnent au chômage, en dépit de leur beaux discours sur le “social”. Remercions Venner de nous avoir rendus, avec autant de sensibilité que d'érudition, les hautes figures de l'Amiral Koltchak, des généraux Dénikine, Korniloff ou Wrangel, de tous ces officiers, ces simples soldats blancs, héros d'autrefois qui nous convient à résister sans faiblir aux pourrisseurs et aux fanatiques.
Patrick CANAVAN.
Dominique VENNER, Les Blancs et les Rouges. Histoire de la guerre civile russe, Pygmalion 1997. 293 pages, 139 FF.
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
http://vouloir.hautetfort.com/index-2.html
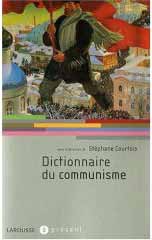 Ce livre sort au même moment que le « Livre noir de la Révolution française » et nous retrouvons le rôle majeur de Stéphane Courtois. Cette fois, il a rassemblé vingt auteurs parmi les meilleurs spécialistes du communisme comme Françoise Thom, Marc Lazar, Pierre Rigoulot ou Jacques Rupnik.
Ce livre sort au même moment que le « Livre noir de la Révolution française » et nous retrouvons le rôle majeur de Stéphane Courtois. Cette fois, il a rassemblé vingt auteurs parmi les meilleurs spécialistes du communisme comme Françoise Thom, Marc Lazar, Pierre Rigoulot ou Jacques Rupnik.