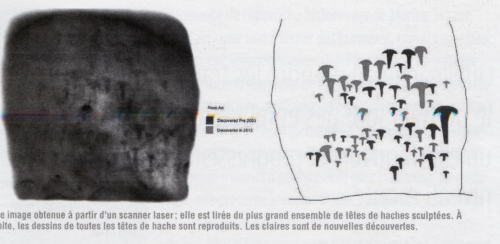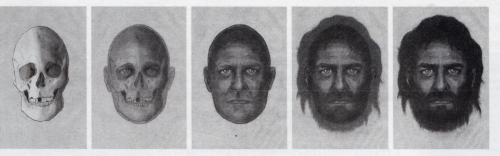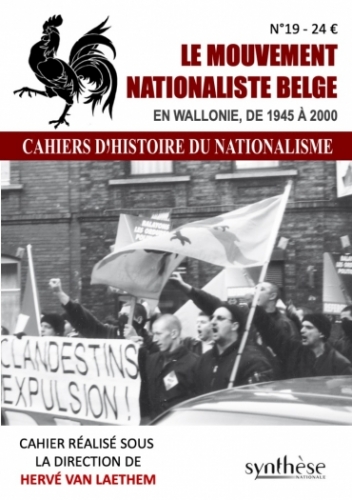Je dois vous parler ce soir de la mort héroïque en Grèce. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas vraiment par quel bout commencer tant ils sont nombreux. Le plus simple est de débuter par le personnage qui incarne à nos yeux, et aux yeux des Grecs déjà, l'idéal de l'homme héroïque et de la mort héroïque : Achille. Dans les récits qui le concernent, non seulement dans l'Iliade mais dans des récits légendaires qui nous ont été transmis par d'autres sources, le dilemme est clairement posé à son propos d'un choix presque métaphysique entre deux formes de vie qui s'opposent. Achille est le fils d'un simple mortel, Pélée, et d'une déesse, Thétis — elle a essayé d'échapper à cette union avec un mortel que les dieux lui imposaient, en prenant toutes sortes de formes. Finalement, le vieux Pélée s'est uni à elle et ils ont eu beaucoup d'enfants au statut équivoque et que Thétis aurait voulu immortaliser. Dans le cas d'Achille, le tenant par le talon, elle le plonge, nouveau-né, dans les eaux du Styx. S'il arrive à se sortir de cette épreuve terrifiante — car le Styx c'est, d'une certaine façon, la mort —, toute la partie du corps qui aura été en contact avec l'eau deviendra immortelle. C'est ce qui arrive à Achille. Il est donc un être humain qui par sa personne, son passé, sa généalogie se situe au croisement du divin et de l'humain. Seul un petit bout de son corps est resté mortel : le talon — car il fallait bien que Thétis le tienne par un bout — et c'est de là qu'il périra.