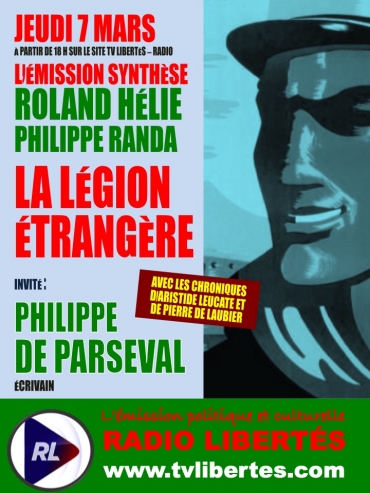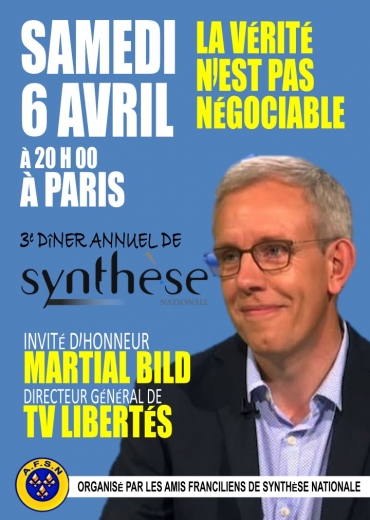culture et histoire - Page 776
-
Zoom – Laurent Izard : la France perd le contrôle de son patrimoine
 Laurent Izard, normalien et agrégé d’économie, présente son ouvrage “La France vendue à la découpe”. Il dresse un constat alarmant de la dépossession du patrimoine économique et culturel français en faveur de repreneurs étrangers.
Laurent Izard, normalien et agrégé d’économie, présente son ouvrage “La France vendue à la découpe”. Il dresse un constat alarmant de la dépossession du patrimoine économique et culturel français en faveur de repreneurs étrangers. -
Du (mauvais) cinéma
 Il a beau s’en défendre, depuis le lancement du Grand débat, Emmanuel Macron est bien en campagne pour les élections européennes, Au moment ou celui-ci achève de s’enliser, il publie pour se relancer et occuper l’espace médiatique une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne » (sic) promettant une remise à plat de la construction bruxelloise. Fort ( ?) des ralliements tout récent de Jean-Pierre Raffarin et d’Alain Juppé, M Macron, moderne Louis-Philippe, espère ramener dans ses filets la bourgeoisie de gauche et la frange européiste de la bourgeoisie de droite. Diffusée dans les quotidiens à tonalité européiste de 28 pays membres de l’UE, cette missive se veut la réponse bruxelloise au « repli nationaliste »; comprendre au réveil des peuples de notre continent qui exigent respect de leur identité et de leur souveraineté, revendications bien naturelles mais qui effrayent en haut lieu.
Il a beau s’en défendre, depuis le lancement du Grand débat, Emmanuel Macron est bien en campagne pour les élections européennes, Au moment ou celui-ci achève de s’enliser, il publie pour se relancer et occuper l’espace médiatique une tribune intitulée « Pour une renaissance européenne » (sic) promettant une remise à plat de la construction bruxelloise. Fort ( ?) des ralliements tout récent de Jean-Pierre Raffarin et d’Alain Juppé, M Macron, moderne Louis-Philippe, espère ramener dans ses filets la bourgeoisie de gauche et la frange européiste de la bourgeoisie de droite. Diffusée dans les quotidiens à tonalité européiste de 28 pays membres de l’UE, cette missive se veut la réponse bruxelloise au « repli nationaliste »; comprendre au réveil des peuples de notre continent qui exigent respect de leur identité et de leur souveraineté, revendications bien naturelles mais qui effrayent en haut lieu. Comme il l’avait fait lors de son discours devant les jeunes agriculteurs lors de son passage au Salon de l’Agriculture, M. Macron tente dans cette tribune de rattraper par la manche un électorat qui constate chaque jour un peu plus les ravages de la politique initiée par la technostructure bruxelloise. Pour tenter de se démarquer d’un projet dont il est pourtant une assez caricaturale manifestation, il a donc choisi de mettre en avant dans son long plaidoyer eurofédéraste le thème de la protection, de « l’Europe qui protège » (reprise d’un slogan martelé par Nicolas Sarkozy en 2008). Mais qui nous protège de quoi ? Mais de tout mon bon monsieur !: du dérèglement climatique, de l’immigration, de l’agressivité économique des géants américain et chinois… et bien évidemment des méchants russes.
Dans ce registre, il promet la création d’une « Agence européenne de protection des démocraties » (on se pince!), pour protéger les élections « contre les cyberattaques et les manipulations» et « (l’interdiction du) financement des partis politiques européens par des puissances étrangères. » Russie qui décidément obnubile nos « élites » des réseaux mondialistes, atlantistes et /ou de la French American Foundation qui condamnent sans rire de sournoises influences étrangères qui menaceraient l’intégrité notre vie politico-médiatique. A ce sujet, Le Parisien notait que « Les audiences de la branche française de la chaîne russe d’information internationale Russia Today(…) inquiète autant qu’elle horripile au sommet de l’Etat où l’on ne cesse de formuler des doutes sur les objectifs de ce média, qualifié d’organe de propagande pro-russe par le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. » Accusation de propagande assez sotte à bien y regarder, puisque cette chaîne se contente plus simplement de donner aussi la parole à des personnalités moins formatées, d’apporter d’autres pistes de réflexions, d’autres éclairages, souvent moins manichéens que ses concurrentes, sur l’actualité nationale et internationale . A suivre M. Griveaux dans ses attaques jugées diffamatoires par le direction de RT, que devrait-on dire des autres chaines d’infos qui ont, elles, massivement, grossièrement, fait campagne ne faveur du candidat Macron en 2017 ?
Propagande qui n’est jamais loin quand l’Union européenne se pique de distribuer des prix, notamment les années d’élections européennes. Le parlement européen et la Fondation du prix international Charlemagne viennent ainsi de décerner le prix de la « Jeune Européenne de l’année 2019 » à Yasmine Ouirhrane. Celui-ci récompense des jeunes de 16 à 30 ans participant à de projets « qui contribuent à une compréhension mutuelle entre les peuples de différents pays européens. ». Cette jeune étudiante à Science-po Bordeaux, italienne coiffée d’un foulard islamique et de père marocain, a été aussi repérée par des instances onusiennes progressistes, du fait de son combat en faveur des sociétés ouvertes, du multiculturalisme et de la poursuite de l’immigration. La question qui se pose, est bien de savoir si cette jeune femme est représentative de la jeunesse européenne, de ses aspirations ou de la feuille de route des élites mondialistes ? Chacun à la réponse.
Dans le domaine culturel, constate Bruno Gollnisch, nous retrouvons la même obsession, le même tropisme anti européen avec le prix Lux du Parlement européen qui, nous est-il expliqué, «aide à promouvoir le cinéma européen, rendre les films accessibles à un public plus large et encourager le débat sur les valeurs et les questions sociales à travers l’Europe. (…) Les dix films, sélectionnés par le jury du Prix Lux, regroupent aussi bien des films qui ont déjà attiré beaucoup d’attention dans les grands festivals de cinéma que des petites sorties nationales. Ils sont très divers mais ont une chose en commun : ils reflètent les problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées telles que les migrations, les populismes, les nationalismes, la mondialisation, la guerre, la religion et la justice. »
Lors de sa dernière édition (en novembre dernier) , ce prix Lux a été décerné a Woman at War film de l’islandais Benedikt Erlingsson. Il narre le combat d’une femme seule, Halla, une «terroriste écologique » qui orne son salon de portraits de Nelson Mandela et de Gandhi qui se bat contre l’industrie de l’aluminium qui pollue et défigure une partie de l’Islande et dont la vie sera bouleversée par l’arrivée imprévue dans sa vie d’une jeune orpheline. Un film qui n’est pas sans qualité plastique et d’interprétation. Mais l’empreinte écologique de l’Islande est elle un problème majeure pour l’UE et notre planète ? Et quitte à parler de pollution, quid des conséquences environnementales d’un tourisme en pleine croissance sur cette île -plus de deux millions de visiteurs par an pour un pays de moins de 340 000 habitants. Quant à l’aluminium (l’Islande est le 11ème producteur mondial), ce pays peut-il se passer actuellement de cette autre manne économique ? Mais le propos du réalisateur vient comme de juste à l’appui du discours officiel tendant à accréditer la thèse (contestée et contestable ) selon laquelle le réchauffement est la conséquence de l’activité humaine. « Ce film nous rappelle les conséquences concrètes du changement climatique », a ainsi déclaré le président du Parlement européen, Antonio Tajani.
Quant aux deux autres films qui restaient en lice pour ce prix Lux, ils restent dans cette tonalité bien-pensante. Il s’agissait de « The other side of everything » de Mila Turajlić. Accrochez-vous à votre fauteuil : « Depuis la fenêtre de l’appartement de sa mère, rapporte cineuropa, la réalisatrice a passé dix ans à filmer les évènements se déroulant à l’extérieur du bâtiment situé au cœur de Belgrade (…). Elle capture les conséquences de l’une des nombreuses manifestations dont la ville était le témoin: la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les protestants déambulant dans les rues pour des raisons obscures – pour l’indépendance du Kosovo ou peut-être contre la gay pride… »… ça donne envie…
L’autre film était « Styx » de l’allemand Wolfgang Fischer. « Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène ». Au prise avec une violente tempête, elle croisera sur sa route au cours de ce voyage initiatique et symbolique le drame d’un immigration clandestine qui souhaite gagner l’Europe. Kolossale finesse de la métaphore…et grande tristesse de voir que c’est ce cinéma européen qui a les faveurs, mais est-ce bien étonnant des bruxellois. Un cinéma aux mains (à d’heureuses et notables exceptions près) des nains, des frileux, des petites âmes, qui devrait être le réceptacle et l’expression de la richesse d’une civilisation à nulle autre pareille, d’une histoire glorieuse, mais qui refuse ou s’avère incapable de célébrer et/ou de réactualiser nos mythes fondateurs et une vision du monde débarrassée de sa mauvaise quincaillerie progressiste.
-
APRÈS LA PUBLICATION DU LIVRE SUR L'HISTOIRE DE TV LIBERTÉS : UN ENTRETIEN AVEC PHILIPPE RANDA

Entretien avec Philippe Randa, auteur avec Marie-Simone Poublon du livre Le défi (Éditions Dualpha), publié sur le site Breizh infos).
« J’ai été sollicité pour écrire avec Marie-Simone Poublon ce livre sur le groupe Libertés car je présentais l’avantage d’avoir été associé à cette aventure très tôt ; de ce fait, je connais (pratiquement) tout le monde. Je fais un peu “partie des meubles”… »
Le défi est un livre qui relate la grande aventure de TV Libertés et qui a été présenté à l’occasion du 5eanniversaire de TV Libertés. En cinq ans, TV Libertés a réalisé plus de cinq mille émissions, totalisant plus de trois mille cinq cents heures de production et plus de trente concepts d’émission. Le succès de la chaîne se mesure également au nombre grandissant de téléspectateurs. En mai 2015, la chaîne comptait un peu moins de cinq cent mille vues sur les plateformes de diffusion. Trois ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par cinq pour atteindre deux millions cinq cent mille vues. Marie-Simone Poublon et Philippe Randa racontent ce pari fou auquel bien peu croyaient… Et pourtant !
Pourquoi avoir décidé d’écrire ce livre, 5 ans après la création de TVL ?
Justement à cause de cet anniversaire : 5 ans ! Savez-vous que c’est un « palier » important pour une société ? Les comptables ont l’habitude d’assurer que lorsqu’une société a réussi à « tenir » cinq ans, c’est qu’elle est viable… Certes, le groupe Libertés est une association, mais de ce point de vue, c’est la même chose. L’idée du livre est de Marie-Simone Poublon qui l’a proposée au président du groupe Libertés Philippe Milliau ; ils m’ont ensuite sollicité pour l’écrire avec Marie-Simone car je présentais l’avantage d’avoir été associé à cette aventure très tôt (par ma participation à l’émission Bistrot Libertés, animée par Martial Bild ; par la direction du site EuroLibertés ; puis par l’animation avec Roland Hélie de l’émission « Synthèse » sur Radio Libertés) : de ce fait, je connais (pratiquement) tout le monde – je fais un peu « partie des meubles »… Également, je pouvais en assurer l’édition, ce qui « gagnait du temps », car, bien sûr – est-il besoin de le préciser ? – ce beau projet ayant été décidé au dernier moment, le temps était compté (euphémisme !) pour qu’il soit disponible début février à l’occasion de la soirée anniversaire du Groupe.
Quelles sont les raisons particulières qui, selon vous, ont permis le succès de la chaîne ?
La première de toutes, c’est la détermination de Philippe Milliau et de Trystan Mordrel : rien ne les a arrêtés, ni le manque cruel de moyens financiers, ni le scepticisme sur le succès du projet qu’ils n’ont pas manqué de rencontrer parmi leurs amis. Mais si la foi soulève des montagnes, l’amitié aussi, puisque sans les premiers soutiens, sans les premiers donateurs, rien n’aurait pu démarrer… Si l’absence d’argent est un handicap (ô combien !), cela peut aussi être un formidable atout pour ne pas croire trop vite, trop tôt – en fait, jamais ! – que « c’est gagné »…
Ce que d’« autres » ont pu croire…
Dans Le Défi, Marie-Simone et moi n’avons pas voulu faire de comparaison entre TVLibertés et Le Média, la chaîne web née à l’instigation de Jean-Luc Mélenchon et de ses « amis » : je mets amis entre guillemets, car malgré leurs moyens financiers sans commune mesure avec ceux du groupe Libertés, malgré une publicité aussi tapageuse qu’indécente lors de leur lancement par toute la presse « mainstream », ce ne sont pas les télespectateurs qui ont été au rendez-vous, mais rapidement les dispute et les procès sur la place publique entre journalistes, directions et associés… À défaut du Grand Soir des Damnés de la Terre, on a assisté à la Grande Déconfiture des stipendiés de la Bien-Pensance : car tous les dirigeants, officiels ou officieux du Média n’ont jamais été les oubliés des prébendes de l’État ou des confortables niches professionnelles dans les médias appartenant à de grands financiers… Tout au contraire, parmi les collaborateurs du Groupe Libertés, malgré parfois certaines approches spirituelles ou politiques différentes, des parcours passés qui ont même pu s’opposer ponctuellement, la bienveillance règne depuis le début au sein des équipes de la TV, de la Radio ou des médias partenaires (presse imprimée ou sites internet de réinformation)… Ça, Marie-Simone Poublon et moi l’avons particulièrement constatés.
Que racontez-vous dans ce livre ?
Tout… ou presque ! sur la création, le développement et le fonctionnement du groupe Libertés… Il y a les portraits des dirigeants, des collaborateurs, mais aussi des témoignages de donateurs et de personnalités extérieures qui ont été invités dans certaines émissions ou qui suivent les programmes avec attention. Parfois des reproches qui sont faits (nous ne les avons pas occultés), mais bien évidemment surtout la satisfaction de l’immense majorité pour un espace de liberté d’expression à nul autre pareil… Nous avons également beaucoup insisté, Marie-Simone et moi, sur ce que les télespectateurs, les auditeurs ou les lecteurs ne voient pas… qu’ils devinent parfois… L’envers du décor, notamment les techniciens de TVLibertés sans qui, comme c’est le cas des fidèles donateurs, rien ne serait possible.
Vous qui fréquentez « ce Milieu politiquement incorrect » depuis plusieurs décennies, diriez-vous que TVL, et plus globalement la presse alternative, est-une des plus belles réussites métapolitiques jamais développée par le courant identitaire/patriote ?
Pour tous ceux qui, dès les années 60 ou 70 (ou 80 en ce qui me concerne), ont considérés que le combat métapolitique était primordial, qu’aucune victoire politique significative ne pouvait faire l’impasse dessus, c’est évidemment une grande satisfaction d’assister aux progrès continuels de l’audience du Groupe Libertés : surtout après la scandaleuse censure par le réseau Youtubede toutes les émissions de la chaîne pour un motif dérisoire (et faux, qui plus est !). Malgré cette péripétie qui en aurait tué ou découragé plus d’un, le Groupe Libertés a très vite repris sa marche en avant… Toutefois, il reste du chemin à tracer, cela n’échappe à personne.
Le défi, Marie-simone Poublon & Philippe Randa, Éditions Dualpha, collection « Patrimoine des Héritages », 152 pages, 10 euros (+ 5 euros de frais de port). CLIQUEZ ICI
-
La conquête romaine: l'exemple gaulois avec J. L. Brunaux
-
Débat Alain Minc - Alain de Benoist
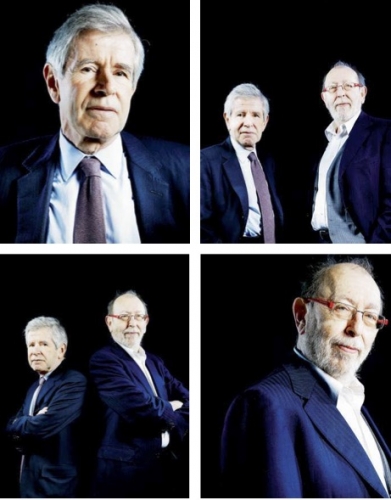
Pour télécharger, cliquez ICI
-
Tardieu, entre Clemenceau, Poincaré et... De Gaulle
-
JEUDI 7 MARS, SUR RADIO LIBERTÉS : ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR LA LÉGION ÉTRANGÈRE AVEC PHILIPPE DE PARSEVAL
LES PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS CLIQUEZ ICI
-
Paris 12 mars Hervé Juvin aux Mardis de Politique magazine, une conférence à ne pas manquer, !

 Rendez-vous à partir de 19 h 00
Rendez-vous à partir de 19 h 00Conférence à 19 h 30 précises
PAF : 10 € - Etudiants et chômeurs : 5 €
Salle Messiaen, 3 rue de la Trinité Paris 9°
Métro La Trinité, Saint-Lazare

Politique magazine, 1 rue de Courcelles Paris 8°
T. 01 42 57 43 22
-
Samedi 6 avril 20 h : 3e DINER ANNUEL DE SYNTHÈSE NATIONALE AVEC COMME INVITÉ MARTIAL BILD, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TV LIBERTÉS
LA VÉRITÉ N’EST PAS NÉGOCIABLE...
Pour la troisième année consécutive, les Amis franciliens de Synthèse nationale, présidés par Hugues Bouchu, organisent leur dîner annuel en ce début de printemps. Après Massimo Magliaro, pour les 70 ans du MSI en 2017, et Jean-Marie Le Pen l’an dernier à l’occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires, nous aurons le plaisir de recevoir le samedi 6 avril prochain Martial Bild, Directeur général de TV Libertés.
En effet, cinq ans après le lancement de cette magnifique arme de combat qu’est TVL, il nous a semblé intéressant de donner la parole à son directeur. Ce media était inimaginable il y a encore peu de temps. Il incarne désormais, sur le plan télévisuel, la résistance quotidienne aux tenants de la pensée dominante. Preuve en est : depuis le début du soulèvement populaire des « Gilets jaunes », TV Libertés donne une toute autre interprétation que celle de la presse stipendiée aux ordres du Système. Pour TVL, comme pour nous, au moment où Macron veut nous imposer encore plus de lois liberticides, la vérité n’est pas négociable...
D’ailleurs, dans cet esprit, depuis deux ans, un partenariat entre Synthèse nationale et TV Libertés a donné naissance à l’émission politique et culturelle hebdomadaire « Synthèse » sur Radio Libertés (la web-radio liée à TVL). La 100e émission vient d’être diffusée fin février.
Les dîners annuels des Amis franciliens de Synthèse nationale sont devenus le pendant printanier de nos Journées nationales et identitaires du mois d’octobre. Elles sont l’occasion pour nos lecteurs et amis de se retrouver, de s’informer et de soutenir la cause qui leur est chère.
Pour nous, elles sont aussi un véritable encouragement à continuer et intensifier notre combat. Voilà pourquoi nous vous donnons rendez-vous nombreux, le samedi 6 avril à 20 heures, à ce troisième dîner annuel des Amis franciliens de Synthèse nationale*.
Roland Hélie,
Directeur de Synthèse nationale
* ce dîner est ouvert aux Amis franciliens et d’ailleurs bien entendu...
RETENEZ DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE CLIQUEZ ICI
-
[vidéo] Interdit d’interdire – De qui (et de quoi) peut-on encore rire ?

Dans cette nouvelle émission, Frédéric Taddeï reçoit Ganesh2 (vidéaste), Sony Chan (humoriste), Océan (humoriste), Patrick Charaudeau (linguiste) et Gaëtan Matis (humoriste).