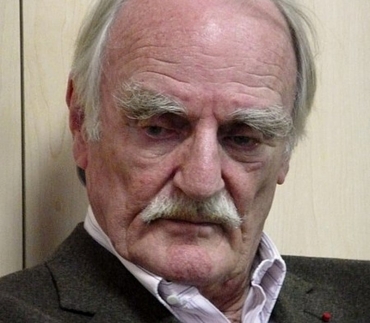Anne Brassié reçoit Jacques Boncompain pour la présentation de son “Dictionnaire de l’épuration des gens de lettres 1939-1949”. Philippe Bornet vous emmène ensuite dans les églises de la Capitale à la découverte des trésors mariales avec son ouvrage “Marie à Paris”.
culture et histoire - Page 844
-
Perles de Culture n°175 : L’épuration du monde des lettres après la libération
-
Politique magazine numéro d'été : « Merkel chancelle ... L'Europe aussi »
 Au sommaire de ce nouveau numéro :
Au sommaire de ce nouveau numéro :UN DOSSIER : Loi Anti Fake News
STRATÉGIE : Retour au réel national
GÉOPOLITIQUE : La dérive des continents
Et aussi dans ce numéro… 54 pages d’actualité et de culture !
S’abonner à Politique magazine
Retrouvez dans Lafautearousseau les derniers articles traitant de l'Allemagne et de l'Europe ...
« Le peuple souverain s’avance »
L’Union européenne va-t-elle tenir le choc ?
Le vent a tourné. Il souffle dans la direction des peuples qui ne veulent pas mourir
-
JOUISSEZ-VOUS DU « PRIVILÈGE BLANC » ?
-
Ce qui caractérise le discours gauchiste en France depuis 1974, c’est la compulsion de répétition, signe de son impuissance
Malgré la critique répétée que Kaczynski adresse aux gauchistes, ceux-ci se sont reconnus dans son texte, ou plutôt ils ont perçu à la fois ses affinités avec leur perspective radicale et ce qui manquait aux extrémistes français. C’est comme si, dans sa solitude et sa folie, Unabomber avait retrouvé un secret qui était perdu depuis longtemps. En d’autres termes, il me semble que ce qui a fasciné dans le cas de Theodore Kaczynski, c’est qu’il soit passé à l’acte. Il a embrassé la « propagande par le fait » qui fut si chère aux anarchistes de la fin du XIXe siècle. Kaczynski, on le sait aujourd’hui, s’est inspiré dans son action de quelques œuvres littéraires qui l’avaient marqué, en particulier un roman de Joseph Conrad datant de 1907, L’Agent secret, qu’il possédait dans sa cabane du Montana. Si par ailleurs il existe un modèle historique sur lequel il a voulu modeler son comportement, c’est celui des anarchistes de la fin du XIXe siècle, que ce soit ceux de Chicago ou ceux de Paris. Theodore Kaczynski paraît plus proche de la démarche d’Emile Henry que de celle de Jean-Marc Rouillan. Or, ce qui caractérise le discours gauchiste en France depuis 1974, c’est la compulsion de répétition, signe de son impuissance. Il est devenu davantage une posture intellectuelle que l’expression d’une action véritable. Pour pouvoir être entendus, les gauchistes parlent plus haut qu’ils n’agissent ; le verbe a dans ces milieux perdu toute sa force. C’est la raison pour laquelle ils ne cessent de faire de la surenchère verbale plutôt que d’analyser lucidement les conditions présentes du développement économique et social, et de considérer ce qu’il est humainement possible de faire pour améliorer la situation. Ainsi, en refusant de regarder le réel en face, leurs propos ne débouchent que sur du vide ou des actions dérisoires.Leur mal vient de plus loin. Il a sa source dans l’influence délétère d’un virus qui a d’abord contaminé en France les intellectuels médiatiques. Les symptômes de cette maladie sont avant tout une perte de puissance des mots, avec l’impossibilité de communiquer vraiment qui en est la conséquence. Le virus s’est manifesté pour la première fois à la fin des années 1960, au moment du mariage entre la télévision et l’intelligentsia française. Une telle union s’est faite au détriment de cette dernière : pour se faire voir dans les étranges lucarnes, les intellectuels médiatiques ont renoncé depuis plus de trente ans à dire quoi que ce soit de véridique, de mesuré ou d’original, afin de reproduire le discours sans saveur et sans aspérité des médias. Peu à peu, le mal à gagné toute la classe intellectuelle, à droite comme à gauche, ainsi que le milieu universitaire. La notoriété des auteurs n’y fait rien, au contraire. On dirait que les écrivains qui jouissent du succès le plus grand sont aussi ceux dont l’œuvre possède le moins d’impact sur le réel. Dès qu’ils présentent leurs livres à la télévision, leurs propos sont frappés d’impuissance ; ils se réduisent au statut d’un divertissement ; ils ne comportent plus aucun enjeu véritable. Par la suite, c’est l’ensemble du travail intellectuel qui a perdu sa force et sa légitimité. Entre la génération des baby-boomers et celle qui a suivi, la transmission intellectuelle a été interrompue, laissant la nouvelle génération sans repères pour guider son action.Theodore Kaczynski, L’avenir de la société industriellehttp://www.oragesdacier.info/2018/07/ce-qui-caracterise-le-discours.html -
Sois radical, aie des principes, sois absolu
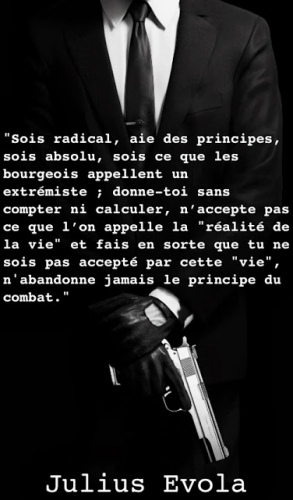
-
Passé Présent n°203 – Madeleine Charnaux : l’artiste et l’aviatrice
Philippe Conrad évoque les compagnies de Jéhu. Anne Sicard dresse ensuite le portrait de l’artiste et aviatrice Madeleine Charnaux. Enfin, Marc Fourny présente son ouvrage “Versailles confidentiel : Amours et intrigues à la cour du roi de France”.
-
Quand la ministre des Affaires étrangères autrichienne félicite Jean Raspail
Source Breizh info cliquez ici
Jean Raspail, qui fêtait le 4 juillet dernier son anniversaire – 93 ans au compteur – a eu la surprise de recevoir un appel téléphonique de Karin Kneissl, la ministre des Affaires étrangères d’Autriche.
La nouvelle est donnée par Le Figaro (09/07/18). Madame Kneissl a tenu à féliciter Jean Raspail pour son roman Le Camp des saints, paru en 1973, qui annonce l’invasion soudaine de l’Europe par une masse de migrants. La ministre a également souligné l’intérêt de la préface à la réédition de ce roman, dans laquelle Jean Raspail a créé le concept de « Big Other », cet Autre dominateur.
Karin Kneissl a été nommée ministre des Affaires étrangères en décembre 2017 dans le gouvernement présidé par Sebastian Kurz, en qualité de personnalité indépendante proposée par le FPÖ. Après de brillantes études, cette diplomate a travaillé au ministère des Affaires étrangères avant d’entamer une carrière de journaliste indépendante. Karin Kneissl s’est fait notamment remarquer par ses prises de positions sur l’immigration.
« Qu’aujourd’hui la ministre des Affaires étrangères d’Autriche félicite Jean Raspail pour « Le Camp des saints » est révélateur d’un état d’esprit. Les choses bougent en Europe – l’Autriche est à la tête de l’UE jusqu’à la fin de l’année – et ce n’est semble-t-il pas fini… », remarque un observateur avisé de la politique internationale.
« Et si Raspail, avec Le Camp des Saints, n’était ni un prophète ni un romancier visionnaire, mais simplement un implacable historien de notre futur ? » s’interrogeait déjà Jean Cau lors de la sortie du roman.
-
Zoom – Alain Sanders : Le hussard fonce dans le tas
Journaliste, grand reporter et écrivain, Alain Sanders est une des figures les plus connues et les plus appréciées de la droite nationale. Quittant quelques instants sa mission au sein du quotidien Présent, il publie un succulent roman policier. On nage dans le Paris d’Audiard et de Nimier, on pense à Holeindre ou aux grands auteurs de romans policiers : A.D.G, Peter Randa ou Guy des Cars. Bref, c’est le roman de vos vacances…
https://www.tvlibertes.com/2018/07/10/24162/alain-sanders-hussard-fonce-tas
Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -
La petite histoire : Pizarro et la conquête de l’empire inca
Dans un précédent épisode, nous avons parlé de la conquête de l’empire aztèque par Hernan Cortès. Cette fois, il va être question de la conquête d’un autre immense empire sud-américain, l’empire inca. Une conquête plus brutale menée par un aventurier qui l’est tout autant, Francisco Pizarro, qui n’hésitera pas à user de ruses et de violence pour s’approprier les fabuleuses richesses des Andes.
https://www.tvlibertes.com/2018/07/10/24142/pizarro-conquete-de-lempire-inca
-
Placer l’enfant au centre de nos discours est une nécessité pour combattre la gauche morale – Cyril Raul (Les Identitaires)

On se souvient des terribles photographies du corps d’Aylan étendu sur une plage. On se rappelle des réactions scandalisées aux positions de Marine Le Pen sur l’école gratuite pour les enfants de clandestins. On a vu, il y a quelques jours, la campagne médiatique dirigée contre Donald Trump accusé de séparer les enfants d’immigrés illégaux de leurs parents à la frontière avec le Mexique. Campagne durant laquelle les médias mainstream américains ont procédé à des manipulations grossières notamment en couverture du prestigieux Times.
Tous ces faits ont été savamment relayés par une gauche pro-migrants dont la mort idéologique ne fait plus de doute. Une gauche zombie à qui il ne reste plus que le pathos comme arme politique. Et quoi de mieux que le sujet des enfants pour émouvoir l’opinion et tenter de la faire basculer ? Une posture efficace puisqu’elle fait appel aux sentiments : le recours au pathos a la force de transformer une idée bancale et mortifère en argument quasi-infaillible dans une époque où l’image et l’émotion guident bien souvent les opinions.
Naturellement, il ne s’agit ici que d’une posture. Cette gauche qui se pose en défenseur des enfants ne défend en vérité froidement que ceux susceptibles de servir sa cause et lui permettre d’alimenter son idéologie sans-frontiériste, pourtant massivement rejetée par les peuples européens.
Car cette même gauche médiatique néglige complètement d’autres enfants : les nôtres. Elle nie l’existence du racisme anti-blanc ou, a minima, le relativise ou le minimise. Elle défend la discrimination positive. Elle méprise la France périphérique blanche qu’elle laisse volontiers dépérir. Elle encourage la submersion migratoire en cours qui ne peut mener que vers le chaos.
Toutes ces positions ne ciblent pas que les « mâles blancs de plus de 50 ans ». Elles visent d’abord les gamins « de souche », qui seront les premiers concernés par cette France de demain que le gouvernement Macron leur prépare : celui de la discrimination sur le marché de l’emploi, celui de la violence anti-française justifiée et (donc) excusée à leur encontre, celui de la relégation des territoires de la France périphérique (qui perd ses écoles, ses médecins, ses hôpitaux) au profit des zones REP+. Désavantagés sur le marché de l’emploi, attaqués pour leur couleur de peau, vivotant dans des territoires abandonnés… Ce sont d’abord les gamins français d’aujourd’hui qui paieront le prix politique de la repentance, de la haine de soi et de la négation du racisme-blancs.
Sur le temps long, avec la submersion migratoire en cours, l’islamisation, le développement massif de « cités » en France (plus une seule ville moyenne sans son « quartier sensible » immigré), c’est potentiellement le chaos, le terrorisme et l’insécurité qui attendent cette génération d’enfants.
Face à ce constat révoltant et de plus en plus partagé, le pathos sur les enfants de migrants est la dernière arme de la gauche, la seule qui lui reste mais une arme aujourd’hui implacable. C’est l’ultime coup d’un boxeur acculé dans les cordes, un coup en dessous de la ceinture, mais un coup encore gagnant.
Un jour ou l’autre, il faudra pourtant bien dépasser et surmonter cette arme ultime de l’adversaire.
Cela suppose d’abord de mettre parallèlement en avant l’avenir de nos propres enfants, de les défendre coûte que coûte, viscéralement, face au sort qui les attend et à cette « France d’après » qui les guette.
Cela nécessite ensuite, face à l’hystérie entretenue par les médias et les politiques sur les enfants de migrants, d’adopter une attitude dépassionnée et apaisée en mettant en lumière la submersion migratoire en cours, qui passe d’abord par les naissances, et donc les enfants. Aujourd’hui, 40 % des Africains ont moins de 15 ans. Et selon le journaliste américain Stephen Smith, « d’ici à 2100, trois personnes sur quatre qui viendront au monde naîtront au sud du Sahara. » Des chiffres inquiétants à l’heure où nous ne sommes qu’au début d’une crise migratoire qui sera l’affaire du siècle. Mais la situation est aujourd’hui déjà critique. Selon un rapport officiel, les Blancs ne représentent par exemple plus que 40 % des enfants de Birmingham (personnes mineures), la deuxième plus grande ville du Royaume-Uni.
Il faut enfin replacer l’enfant au cœur du discours politique, que cet enfant soit d’ici ou d’ailleurs, afin de le défendre réellement en combattant toute forme de manipulation de son sort à des fins idéologiques.
À l’instar des questions bio-éthiques, où la gauche prétend qu’un enfant n’a pas besoin de père pour grandir, l’idéologie pro-migrants met, elle aussi, en danger les droits de l’enfant. Qui peut affirmer qu’un enfant peut décemment s’épanouir et grandir dans le chaos migratoire, au milieu des rancoeurs et des conflits latents ? Face au déracinement, chaque enfant doit se voir reconnaître, indépendamment des considérations des adultes, un droit à l’enracinement, c’est-à-dire le droit de vivre et grandir dans un cadre solide et apaisé, auprès de sa famille et sur la terre de ses ancêtres.Cyril Raul
Texte repris du site de : Les Identitaires