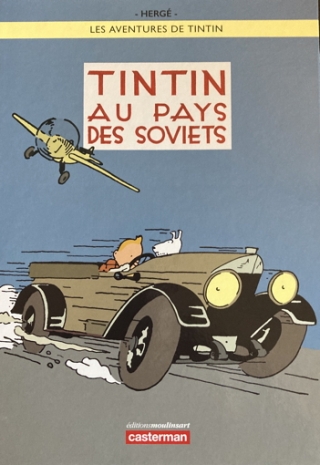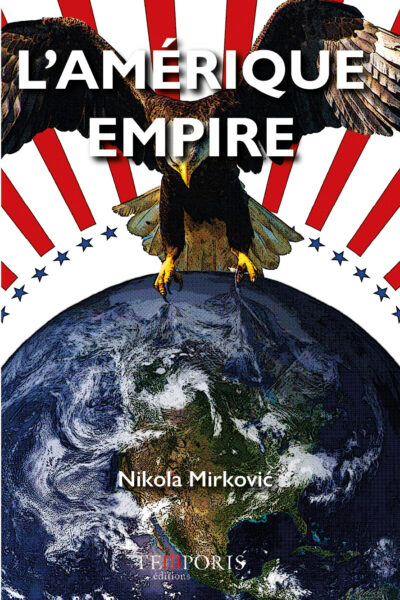Membre Honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte
Président du Cercle Nation et République
Président de l’Académie du Gaullisme
On peut le croire car de nombreux faits concourent à ce jugement émis par certains experts.
Les relations occidentales avec la Russie sont aujourd’hui sous tensions et Vladimir Poutine a même été décrit comme un « killer », un tueur, par le Président Joe Biden à la suite de la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny, opposant russe.
Citons également l’assassinat de l’ex-membre des services secrets russes, Sergueï Skripal, perpétré à Londres par des agents du GRU – les services de renseignement militaires russes- ; l’assassinat d’opposants tchéchènes à Berlin, deux diplomates russes ont été expulsés par l’Allemagne.