culture et histoire - Page 1088
-
(2.1) Sur nos traces - L'agriculteur
-
Il est sorti : LE 3e CD DES BRIGANDES
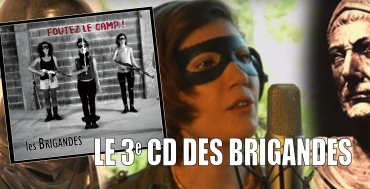
Le commander en ligne cliquez ici
Les précommandes sont expédiées aujourd'hui
-
L’identité chrétienne de la France : on y tient, par l’abbé Guillaume de Tanoüarn
Sur l’identité chrétienne de la France, deux livres paraissent le même 12 janvier, ce ne peut être un hasard dans le Landernau parisien : il va s’en parler.
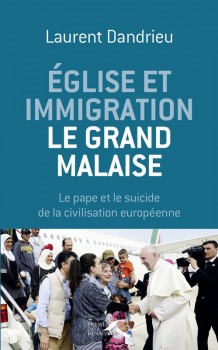 L’un est signé par le rédacteur en chef Culture de Valeurs actuelles, Laurent Dandrieu. L’autre est le fait d’un blogueur bien connu, Koz, de son vrai nom Erwan Le Morhedec. J’ai eu quelques bonnes feuilles du second et le livre du premier, livre intitulé tout simplement Église et immigration : le grand malaise et sous-titré Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Le travail de Dandrieu est à son image, précis, charpenté, bien écrit. Et sur un tel sujet, on voit l’âme affleurer ici ou là ce qui ne gâte rien. Je ne peux pas me prononcer définitivement sur le travail de Koz, puisque, pour l’instant, je n’en ai eu que les bonnes feuilles, publiées dans La Vie. Le titre est tout un programme : Identitaire, le mauvais génie du christianisme.
L’un est signé par le rédacteur en chef Culture de Valeurs actuelles, Laurent Dandrieu. L’autre est le fait d’un blogueur bien connu, Koz, de son vrai nom Erwan Le Morhedec. J’ai eu quelques bonnes feuilles du second et le livre du premier, livre intitulé tout simplement Église et immigration : le grand malaise et sous-titré Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Le travail de Dandrieu est à son image, précis, charpenté, bien écrit. Et sur un tel sujet, on voit l’âme affleurer ici ou là ce qui ne gâte rien. Je ne peux pas me prononcer définitivement sur le travail de Koz, puisque, pour l’instant, je n’en ai eu que les bonnes feuilles, publiées dans La Vie. Le titre est tout un programme : Identitaire, le mauvais génie du christianisme.Dans les textes que nous tenons en main, rien n’est fait pour définir l’adjectif « identitaire ». On a l’impression simplement qu’« identitaire » signifie « d’extrême droite » (pouah !), raciste (beurk) ou racialiste. Comme si l’identité était une question de couleur de peau ou d’engagement politique. Autant appeler les racistes… des racistes, et les « fascistes »… des diables !
Mais un livre ou une pensée qui parle d’identité, qui essaie de la définir, c’est tout simplement un livre qui s’enquiert du fond de notre cœur, un livre qui parle de tout ce qui était en nous avant nous. Faudra-t-il dire que cette démarche « identitaire » participe au « mauvais génie du christianisme » ? Koz ne distingue pas diverses formes d’attachement identitaire. Pour lui, au-delà du racisme ou du racialisme, l’expression « France chrétienne » semble ne plus avoir de sens. Je cite : « Est-il donc vraiment manifeste, dans ses débats, ses positions, sa culture contemporaine, que la France soit chrétienne ? » Et je réponds à la mise en question de Koz : mais oui, dans ses débats, aujourd’hui, la France est chrétienne. Elle est sans doute chrétienne sans le vouloir. Son christianisme est dévoyé. Elle mélange la justice sociale et la miséricorde spirituelle. Elle dit aux homosexuels qui se marient : « Qui suis-je pour juger ? » Je ne sais pas ce que sera la France dans un siècle, musulmane peut-être. Mais aujourd’hui, la politique de la France est faite des « vertus chrétiennes devenues folles ».
Le Morhedec continue : « À la vérité, cette affirmation ne tient que par référence à une France fictive, théorique, entité séparée des Français, susceptible de rester chrétienne, quelles que soient l’évolution effective du pays et la politique menée ». Et là encore, il se trompe : cette France fictive qu’il veut dézinguer, cette France idéologique, elle n’existe plus depuis longtemps. Ce qui existe, avant nous et en nous que nous le voulions ou non, c’est une France qui nous a donné des réflexes chrétiens. Allons, citons un nom que l’on trouve dans la topographie de beaucoup de villes françaises : Jean Jaurès. Le socialisme de Jaurès, c’est du christianisme laïcisé, comme celui de Mélenchon !
N’allons pas plus vite que la musique, pour ne pas en oublier nos responsabilités présentes : la France aujourd’hui demeure chrétienne, elle ne l’est pas forcément comme nous voudrions peut-être qu’elle le soit, de façon confessionnelle. Mais la vague identitaire qui retrouve, au cœur des Français, ces fondamentaux, peut en mener beaucoup (et plus qu’on ne l’imagine) devant l’autel, j’en suis, en tant que prêtre, le témoin.
C’est au fond de ce point de vue, foncièrement raisonnable et simplement réaliste, que se place Laurent Dandrieu. C’est en tant que chrétien, qu’il s’élève contre les vertus chrétiennes devenues folles. Pour lui, comme pour Pascal, comme pour Descartes, comme pour Montaigne, si l’on veut bien se souvenir des grands esprits français, il y a deux ordres différents : l’ordre de la gestion et du calcul, qui est intrinsèquement raisonnable et au nom duquel on mène une politique, et l’ordre de la charité, qui procède de la foi.
Dans un très beau prologue, il pose, au nom de l’immigration sans frein, la question de la survie d’une civilisation européenne qui pourrait se détruire à force d’ouverture à l’autre : « Cet universalisme-là, qui pousse l’amour de l’autre jusqu’au mépris des siens, n’est pas plus conforme au véritable esprit catholique qu’il ne l’est à la nature humaine. Comme les êtres humains, les civilisations ont un légitime instinct de survie ; s’il leur arrive de prendre conscience qu’elles aussi sont mortelles, elles savent également qu’elles représentent un apport unique et irremplaçable au trésor de l’humanité, et qu’il est de leur devoir de le faire vivre aussi longtemps qu’il est en leur pouvoir. L’Europe, qui inventa l’idée même de civilisation et qui est la société particulière dans laquelle s’est incarné le judéo-christianisme, par laquelle il a accédé concrètement à l’universalité en se répandant dans le monde entier, le sait plus que toute autre civilisation ».
Abbé Guillaume de Tanoüarn
Laurent Dandrieu, Église et Immigration : le grand malaise, Le pape et le suicide de la civilisation européenne, Presses de la Renaissance 288 p., 17,90 €.
Erwan Le Morhedec, Identitaire, le mauvais génie du christianisme, éd. du Cerf 167 p., 14 €.
Texte repris du blog du magazine Monde & Vie
-
(2.4) Sur nos traces - L'homme de pouvoir
-
Salut à Boutang !
Georges Feltin-Tracol
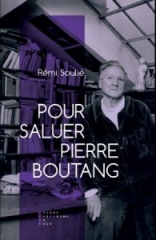 Disciple zélé et talentueux de Charles Maurras, le royaliste orléaniste intransigeant Pierre Boutang fut à la fois philosophe, romancier, journaliste, critique littéraire et redoutable pamphlétaire. Révoqué de l’Université pour avoir rallié le général Giraud en 1942, Boutang fonda un journal, La Nation française, dans lequel s’exprimaient l’« historien du dimanche » Philippe Ariès et le critique de cinéma Philippe d’Hugues, soutint la cause de l’Algérie française avant d’approuver l’action néo-capétienne de Charles De Gaulle en qui il espéra un moment une éventuelle restauration monarchique en faveur du comte de Paris. Ayant appris à lire dans les colonnes de L’Action française, Boutang partage l’antisémitisme d’État de son maître à penser, puis se fait le vibrant défenseur du sionisme et de l’État d’Israël peut-être parce qu’il « voit dans Israël un modèle théocratique moderne, la théocratie étant le contenu latent de son rêve (p. 58) ».
Disciple zélé et talentueux de Charles Maurras, le royaliste orléaniste intransigeant Pierre Boutang fut à la fois philosophe, romancier, journaliste, critique littéraire et redoutable pamphlétaire. Révoqué de l’Université pour avoir rallié le général Giraud en 1942, Boutang fonda un journal, La Nation française, dans lequel s’exprimaient l’« historien du dimanche » Philippe Ariès et le critique de cinéma Philippe d’Hugues, soutint la cause de l’Algérie française avant d’approuver l’action néo-capétienne de Charles De Gaulle en qui il espéra un moment une éventuelle restauration monarchique en faveur du comte de Paris. Ayant appris à lire dans les colonnes de L’Action française, Boutang partage l’antisémitisme d’État de son maître à penser, puis se fait le vibrant défenseur du sionisme et de l’État d’Israël peut-être parce qu’il « voit dans Israël un modèle théocratique moderne, la théocratie étant le contenu latent de son rêve (p. 58) ».Rémi Soulié ne développe pas le parcours intellectuel de son ami parfois sujet à de vives colères ainsi que d’« engueulade en hurlements majeurs (p. 100) ». « Quel caractère de cocon ! (p. 101) », poursuit-il plus loin, ajoutant que « Boutang, c’est Ivan le Terrible, Attila, Tamerlan et Gengis Khan en un seul homme (p. 109) ». Bref, « faute d’avoir trouvé un sage équilibre intérieur entre la paix et l’épée, Boutang ne (se) maîtrisait pas (p. 14) ». Ce tempérament difficile n’empêche pas que « Boutang s’enflamme comme un enfant. Il a des accès d’enthousiasme politique comme j’ai des quintes de toux. Comment fait-il pour rester aussi naïf après tant d’années de combats et de revers, alors qu’il est plus que prévenu contre la démocratie dite libérale et représentative ? (p. 99) ». Cette remarque surprend. En effet, « Maistre et Boutang partagent une même idée de la politique. […] Pour eux comme pour Donoso Cortés, Blanc de Saint-Bonnet et toute l’école de la pensée catholique traditionnelle, les principes de la politique ne se peuvent penser qu’à partir de l’Incarnation, du Dieu un et trine, bref, de la théologie (p. 17) ». Rémi Soulié assène même qu’« au fond, Boutang reste trop biblique (p. 99) ». « Coléreux et généreux, tendre et tyrannique, cet ogre fut un homme de passion [… qui] a construit une œuvre philosophique et polémique parfois hermétique mais qui porte à incandescence les facultés de l’esprit (p. 14). »
Un temps proche des royalistes de gauche de la NAF (Nouvelle Action française) qui deviendra plus tard la NAR (Nouvelle Action royaliste) animée par Bertrand Renouvin et Gérard Leclerc, Pierre Boutang connaît à la perfection les mécanismes démocratiques. « Il travaillait sur la notion platonicienne de “ théâtrocratie ”. Il y voyait le concept idoine à l’intelligence des temps spectaculaires (p. 138). » Parfois suspicieux envers certains titres de Jünger – tels La Paix -, il reconnaît néanmoins volontiers que « l’anarque est celui qui échappe à toute arché. Sont bonnes toutes les archies (monarchies, anarchie…), et détestables toutes les craties (démocratie, ploutocratie…) (p. 101) ».
Il n’est pas anodin si l’ouvrage s’ouvre sur une étude fouillée consacrée à « Pierre Boutang et Joseph de Maistre » au croisement de l’histoire des idées politiques, de la philosophie et de la métapolitique, terme déjà employé par l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg. Cela peut surprendre chez quelqu’un qui se référait habituellement au philosophe italien Vico. Rémi Soulié insiste aussi sur « l’axe biographique, politique, métaphysique et théologique fondamental pour Boutang : la paternité et la filiation (p. 45) ». Sa pensée s’articule donc autour de ces deux notions qui fondent la nation dans son acception étymologique.
Pour saluer Pierre Boutang est un essai lumineux sur une vie, une personnalité et une œuvre complexe qui devraient probablement faire l’objet d’une étude exhaustive. Les écrits de Boutang peuvent encore avoir aujourd’hui une résonance particulière. Le supposé « populisme chrétien » décrit par Patrick Buisson dans La cause du peuple y puiserait des idées susceptibles de le rendre effectif, cohérent et combatif. George Steiner le considérait d’ailleurs comme « la voix philosophique de l’aile autoritaire de la droite contemporaine en France (p. 16) ». Les jeunes catholiques non-conformistes du début du XXIe siècle auraient par conséquent tout intérêt à redécouvrir ce philosophe engagé après avoir médité le beau livre de Rémi Soulié.
Source Europe maxima cliquez là
• Rémi Soulié, Pour saluer Pierre Boutang, Éditions Pierre-Guillaume de Roux, 2016, 141 p., 21 €.
-
Le Yak-130, un « petit cauchemar » pour l’Otan

Le fameux Yak-130, chasseur d’entraînement avancé russe, est qualifié de « petit cauchemar » par des spécialistes américains, selon la revue bimensuelle américaine Le National Interest.
Le Yak-130 comporte plusieurs caractéristiques qui alertent l’Otan. Premièrement, grâce à ses systèmes d’accroche spéciaux, le chasseur est capable d’emporter trois tonnes d’armements modernes, comme des missiles air-air ou air-sol, des bombes guidées ou non-guidées et des roquettes.
Deuxièmement, un canon de 23 millimètres peut être fixé sous le fuselage du Yak-130, tandis que des roquettes air-air peuvent être accrochées aux bouts ses ailes.
De surcroit, un Yak-130 totalement équipé et rempli ne pèse que 10.300 kilogrammes ce qui fait un peu plus de la moitié du poids d’un chasseur multi-rôle, F-16 qui est le principal avion utilisé par les Etats-Unis et par leurs alliés.
Actuellement, les Yak-130 sont en service dans l’armée de l’Algérie. Le Bangladesh et la Biélorussie ont également signé des contrats visant à la fourniture de ces chasseurs russes.Le Yak-130 a été construit dans le bureau d’études russe Yakovlev. Il a été choisi comme principal avion pour l’entrainement des pilotes des Forces aériennes de la Russie. Les Yak-130 permettent d’instruire les pilotes pour les avions russes et étrangers de génération 4+ et 5.
http://www.voxnr.com/7598/le-yak-130-un-petit-cauchemar-pour-lotan
-
(2.6) Sur nos traces - Le citadin
-
La parole captive
Le philosophe stoïcien romain Sénèque écrivait dans De la constance du sage à propos d'une injure qu'il était d'une âme plus grande de l'ignorer que de la pardonner à l'instar de ce que fît Caton.
Pourtant un mal sourd ronge nos contemporains : la sensibilité à l'insulte et l'incapacité à dialoguer. Ces termes recouvrant une palette large de propos et de situations. Nos sociétés sont devenues incapables de supporter le moindre mot trop haut, la moindre formule maladroite. Les « clash » et autres « punchlines » sont devenues la figure de l'affrontement de tous contre tous. Un « bon mot » n'est plus pris pour ce qu'il est, un trait d'esprit, mais comme la première étape d'une bataille de coq dans l'arène. Cette tendance s'accompagne d'un affaissement de la maîtrise de la langue, qui conduit souvent à des interprétations, à des incompréhensions et en définitive à des chamailleries de cour d'école. Tout doit être expliqué, ou rien ne doit être dit.
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Epictète, Manuel
La presse s'est faite un relais particulièrement efficace de tous les prétendus dérapages des hommes politiques et les propos de Trump sont considérés comme plus importants que toutes les malversations et tous les cadavres dans les placards d'Hillary Clinton par exemple. La volonté de « faire le buzz » passe systématiquement par la recherche du propos qui condamnera celui qu'on déteste. Ce qui compte ce n'est pas qui a dit quoi, mais la case dans laquelle on range l'émetteur du message. Une blague de Trump est donc « odieuse » parce qu'elle vient de Trump. Ce procédé s'est donc bien évidemment amplifié avec internet où n'importe qui peut filmer quelqu'un en train de dire n'importe quoi et le publier sur une plateforme audio ou video et le diffuser ainsi à des millions d'internautes. On se souvient comment John Galliano avait frôlé la mort sociale sur des propos visiblement alcoolisés alors que tout cela n'aurait au mieux fait qu'un encart dans Paris-match dans les années 80...
Que des activistes s'engageant dans la défense des « minorités » prétendument opprimées puissent recourir à la diffusion d'informations personnelles sans autre forme de procès pour de simple propos est un trait de la barbarie. Le mépris du droit qui fait la spécificité de notre civilisation et permet à chacun de s'expliquer, au profit de vengeances privées se basant sur la morale de l'époque est pour le coup un véritable recul de la civilisation.
« L'insulte est une injustice mineure qui peut être sujet de plainte plutôt que de poursuite : aussi les lois n'estiment pas qu'elle mérite vengeance. » Sénèque, De la constance du sageMalheureusement, la tendance actuelle consiste à adapter l'arsenal législatif à ce phénomène. Le droit n'est plus là pour encadrer, limiter, garantir les libertés, mais pour excommunier et anathémiser. Le moindre propos peut vous envoyer devant le tribunal et vous risquez des sanctions de plus en plus lourdes. La liberté d'expression se voit réduite, comme d'ailleurs dans les pays anglo-saxons qui sont frappés par cette dérive, car tout est potentiellement offensant (offensive en anglais). Qui n'a pas déjà discuté avec ces amis de la liberté de ton de Desproges ou des Inconnus si on la compare à ce que peuvent faire aujourd'hui les humoristes ? A part faire une demi-tonne d'allusions sexuelles ou s'attaquer à des cibles faciles, l'humour des amuseurs public est complètement verrouillé. L'impertinence à laissé place à l'indécence.
« La feuille morte voltige d'un lieu à l'autre, mais tous les lieux se valent pour elle, car son unique patrie est dans le vent qui l'emporte. » Gustave Thibon, L'équilibre et l'harmonie
Il est de plus en plus compliqué d'être à contre courant et bien des esprits brillants sont brimés à notre époque. Michel Déon était à l'Académie Française tout en ayant un passé maurrassien. Cela serait-il possible aujourd'hui ? La police de la pensée veille. N'importe qui devient d'ailleurs un censeur, un juge, alors que ce rôle ne lui est pas dévolu. Sur une maîtrise approximative du droit et surtout en vertu du politiquement correct, on peut décréter dans votre famille ou votre boulot que vous êtes infréquentable à cause de vos blagues « douteuses ».
Pourtant nous affirmons le droit à l'ironie, à la moquerie, au calembour, à l'impertinence, au trait d'esprit. Nous nous devons d'éviter l'aridité du propos sans pour autant nous défaire d'une certaine décence. Bloy serait-il Bloy sans une forme pamphlétaire ? N'est-ce pas la parole qui fait de nous des êtres humains ? Les écrits ne sont ils pas une autre forme de la parole humaine ?« Ce qui caractérise ce langage parlé de l'homme, c'est précisément ce qui déborde, excède, déstructure aussi tout ce qui peut être transmis dans le langage tactile ou visuel, ce sont les marges du sens et les ambivalences, et la fluctuation des interprétations. » Jacques Ellul, La parole humiliée
Ce que cache cette nouvelle réalité, c'est un renforcement de la moraline en parallèle d'un renforcement du tribalisme. Pour faire clair, plus nos sociétés se communautarisent, plus elles se fragmentent, en sommes plus nous avons de difficulté à « faire société », plus la morale du politiquement correct devient une arme pour obliger (par la force de pseudo-lois qui ne sont pas issues de la souveraineté populaire mais de l'arbitraire d'une oligarchie idéologique) les individus à « vivre-ensemble », comme si ce délitement était provoqué par le bas alors qu'il a été généré par le haut, par des associations grassement subventionnées, par des politiques incompétents et par le libre-marché de la mondialisation adossé au post-modernisme anglo-saxon. Tout cela conduisant au tribalisme généralisé.
A rebours des stoïciens, un propos peut vous valoir aujourd'hui dans certains quartiers un tabassage en règle. Comme un simple regard jugé « de travers ». Cela se fait au nom de l'honneur ou « du respect », mais il s'agit en réalité d'orgueil et non d'honneur. Les gens passent un temps incalculable à discuter à propos d'untel qui « a dit ceci ou cela » et n'importe quel « jeune des quartiers populaires » peut dégoupiller pour un propos tenu par un prof, un flic ou n'importe qui d'autre. Incapable d'ignorer comme un stoïcien ou a minima de pardonner comme un chrétien, tout le monde participe avec le système politico-médiatique à l'enfoncement progressif de l'Occident dans la barbarie. Chacun porte en lui le virus.
La justesse ou la mesure des aristotéliciens, la recherche de l'ataraxie (absence de troubles) des Stoïciens, tout cela semble très, très loin. Aujourd'hui c'est tout le contraire. Nous pourrions nous en arrêtez là si ce phénomène n'était pas aussi massivement présent dans ceux qui sont censé incarner la continuité de notre civilisation : les militants patriotes et identitaires. Il est assez déroutant de constater que chaque fois que quelqu'un émet un avis, y compris sur une officine proche, il s'en suit des interminables palabres, quand certains n'en viennent pas carrément aux menaces. D'autres brandissent l'argument ultime « c'est faire le jeu de la division du camp national » dont on se demande bien quel est le bilan, mais passons sur ce point.
« Si une fois il s'était abaissé à s'émouvoir d'une injustice ou d'une insulte, il ne pourrait plus jamais retrouver son calme : or le calme est le bien distinctif du sage. Celui-ci ne s'exposera pas en se vengeant d'une insulte à faire honneur à son insulteur ; car l'homme qui voit qu'on est fâché d'être méprisé par lui se réjouit nécessairement de l'estime qu'on fait de lui. » Sénèque, De la constance du sage
Ce que nous devons nous efforcer de faire émerger, c'est un type d'homme. Ce que nous devons préserver c'est un être-au-monde bien plus qu'une race ou un pays. Que serait une race, si elle n'était composée que d'adolescents éternels et d'enfants capricieux incapables de s'exprimer en adultes ? Que serait un pays, s'il n'était composé que de consommateurs narcissiques incapables d'accepter la contradiction ? Que serait l'Europe sans la philosophie, la rhétorique et la dialectique ? Sans l'art des lettres et des mots ? Sans la germination de la pensée et la création artistique ?
L'outrance d'un propos suffit bien souvent à discréditer son auteur sans qu'il ne soit besoin de lui répondre. Mais l'outrance sera toujours meilleure que le silence, car là où vit l'outrance, vit la liberté, là où se niche le silence, prospère la censure. La parole libère, les mots sont des armes au service de cette liberté.
Jean/C.N.C.
http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/
-
L'Affaire archéologique de Glozel - Mystères du Monde
-
La dette de la France vis-à-vis des colonies ? Parlons-en !
Il me semble nécessaire de rafraîchir certaines mémoires.
François Hollande s’est engagé, ce 19 décembre 2016, à faciliter l’accession à la nationalité française aux soldats sénégalais ayant participé aux combats pour la libération de la France.
Il me semble nécessaire de rafraîchir certaines mémoires et, tout en rendant hommage aux régiments coloniaux qui participèrent à cette libération de la France, de rappeler qu’en 1943, ils étaient composés de 410.000 mobilisés (57 % de Maghrébins et 43 % de pieds-noirs, soit 16 % de la population française d’Algérie, la communauté la plus engagée dans ce conflit mondial).
Il est donc faux de prétendre, par exemple, que l’armée du général de Lattre de Tassigny était composée de 60 % de Maghrébins car dans ce pourcentage sont incorporés les pieds-noirs, assimilés donc aux Arabes.
L’armée de De Lattre se composait, en réalité, de 50 % de Maghrébins, 32 % de Français d’Algérie, 10 % d’Africains et 8 % de métropolitains. En revanche, il est intéressant de rappeler que des milliers de Maghrébins combattirent aux côtés des nazis, contre la France et ses alliés, et que des milliers poursuivirent leurs exactions, après-guerre, en Algérie.
Notamment la Brigade nord-africaine, créée par Henri Lafont et la star du foot de l’époque, Alexandre Villaplane, et financée et armée par l’homme d’affaires israélien Joseph Joanovici. Combattants recrutés parmi les immigrés maghrébins de la région parisienne, composée principalement d’Algériens et dirigée par le capitaine Mohamed El Maadi.
Cette brigade se distingua surtout par les pillages, les viols et les exactions commis dans les régions de Tulle, Bergerac et Montélimar.
Elle fut surnommée « SS Mohamed » et se composait de membres du PPA (Parti populaire algérien) et de transfuges du Parti communiste français, qui fournirent le gros de l’encadrement.Citons, également, le cas de Saïd Mohammedi, dit Si Nacer, aspirant de l’armée française, qui s’engagea volontairement dans les Waffen-SS et devint lieutenant d’une Panzerdivision sur le front de l’Est. Il fut décoré de la croix de fer directement par Hitler.
Si Nacer fut envoyé en mission de sabotage en Algérie, dès l’été 1944, dans la région de Tébessa. Condamné aux travaux forcés à perpétuité, il rejoint le FLN en 1952 et, en 1957, assume le massacre du village de Melouza (315 habitants exterminés par le FLN parce qu’ils refusaient de collaborer).
Nommé colonel et chef d’état-major de l’ALN, puis chef de la Wilaya 3 et, par la suite, député et ministre. Il sera disgracié par le président Boumédiène et, après avoir rejoint les rangs islamistes du FIS, en 1989 en Algérie, il mourra à Paris le 5 décembre 1994.
Et puisqu’il est question des « indigènes », citons le cas du bataillon Deutsche-Arabische 845, créé en 1943 et composé de Nord-Africains, notamment 10.000 Tunisiens. Il combattra en Grèce, Croatie et fut totalement écrasé en s’opposant aux Anglais, en Tunisie.
N’est-il pas un peu tard, 70 ans après, de se souvenir de la « dette de la France » vis-à-vis des « colonies » ?
http://www.bvoltaire.fr/manuelgomez/la-dette-de-la-france-vis-a-vis-des-colonies-parlons-en,304534