Ce mardi 25 octobre, Arte a présenté, en début de soirée, une émission sur les Brigades internationales. En soi, en tant que documentaire, une telle émission est forcément extrêmement intéressante. Mais, comme l'annonçaient les magazines de programmes télé, le parti-pris « pro-Brigades » était évident. Pour résumer : à ma gauche, les tout gentils, les tout bons, on n'ose pas dire les saints mais c'est l'idée : j'ai nommé, les Brigades internationales ; à ma gauche, le grand méchant loup, la bête immonde, l'horreur absolue : comprenez, Franco.
Que les marxistes - ou ce qu'il en reste - pensent cela, au fond, ce n'est pas surprenant. Mais qu'une grande chaîne de télévision, avec le recul que donnent les quatre-vingts ans qui nous séparent de la Guerre d'Espagne, reprenne ce schéma faux, tout simplement « historiquement faux », voilà qui dépasse l'entendement. On veut bien que, pour vulgariser - au bon sens du terme - les chaînes fassent des choses simples et accessibles au grand public ; c'est le but de la manœuvre. Mais, là, on passe directement du simple au simplisme, et carrément au simplet.
Qu'on nous permette donc, en deux mots, de remettre les choses à l'endroit...
En 1936, le féroce Staline règne sans partage sur l'Union soviétique ; et, avec lui, sa dictature sans pitié, la pire horreur qu'ait connu le monde depuis les origines de l'humanité. Et il a son plan, dont il ne fait pas mystère : étendre le Paradis soviétique à l'Europe entière, d'abord, puis au monde entier, ensuite. Il arrivera, en 45, par la faiblesse et la nullité politique de Roosevelt, à s'emparer de la moitié de l'Europe, et on sait ce qu'ont souffert les peuples d'Europe de l'Est - en plus du peuple russe qui, lui, la subissait déjà depuis 30 ans - de la part de cette monstruosité sans nom qu'était le marxisme-léninisme.
Mais, en 36, Staline ne martyrise « que » la Russie, devenue Union soviétique. Et il voit dans la guerre civile espagnole l'occasion rêvée de prendre l'Europe de l'Ouest à revers, par l'Espagne. Le Komintern triomphant de l'époque jette toutes ses forces - par la propagande et par les armes - dans cette bataille pour s'emparer de l'Espagne et, forcément, du Portugal : la possession de la péninsule ibérique, c'est le début de la conquête de l'Europe, du monde...
Mais - car il y a un « mais » - Staline va tomber sur un obstacle majeur : Franco. Franco va être le premier, et le seul, à vaincre militairement, sur le champ de bataille, les armées de la sinistre révolution. « En campo abierto y buena lid », comme on dit en castillan ; c'est-à-dire, "à la loyale", sur le champ de bataille, et « Cara al sol », face au soleil...
Cela, bien sûr, ne sera jamais pardonné à Franco. En dépit du simple bon sens, de la simple observation des faits, la propagande effrénée du Komintern va déverser une telle quantité de mensonges que sa grossière propagande va devenir une vérité, « la » vérité officielle. Et le reste, même quatre-vingts ans après, du moins pour ceux qui ont des oreilles pour entendre mais ne veulent pas entendre ; et des yeux pour voir, mais en veulent pas voir : Arte, en reprenant à son compte tous les clichés les plus faux sur le sujet, a dignement représenté le camp du mensonge révolutionnaire soviétique, ce mardi soir, et elle n'a vraiment pas de quoi en être fière...
Franco a écrasé la révolution marxiste-léniniste, car c'est de cela qu'il s'agit lorsqu'on parle de cette horreur que fut la République espagnole. Et il a bien fait.
Il a rendu service à son pays, d'abord, à qui il a évité les Stasi, les Ceaucescu, les désastres écologiques, les goulags et autres abominations qui furent le lot de ce que l'on a osé appeler les « démocraties populaires » !
Il a rendu service à la France, ensuite, lorsque, Hitler ayant écrasé les troupes d'une république qui n'avait su ni préparer ni éviter la guerre, il refusa à ce même Hitler, lors de son entrevue avec lui, à Hendaye, le passage des troupes nazies par l'Espagne : elles auraient alors fondu sur nos forces libres d'Afrique du Nord, et l'on imagine aisément la suite...
Il a rendu service à l'Europe et au monde, enfin, en hâtant la fin de la guerre,refusant à Hitler toutes ses demandes, n'entrant pas en guerre à ses côtés, ce qui équivalait à agir dans le sens des intérêts de la paix - en refusant une extension encore plus grande du conflit - des intérêts de l'Europe et de la Civilisation.
Constatant son échec complet, et conscient de s'être fait berner, Hitler devait d'ailleurs déclarer, en substance, qu'il préférerait se faire arracher trois ou quatre dents plutôt que de recommencer une négociation avec un homme pareil...
En face de Franco, et contre lui, les Brigades internationales : ces hommes, jeunes pour la plupart, qui ont mis leur fougue, leur courage, leur héroïsme au service de l'Empire du Mal ; qui l'ont d'ailleurs amèrement regretté (au moins, cela, on le montre bien dans l'émission...) mais qui ont droit à tous les éloges sur Arte.
Chacun choisira son camp !...
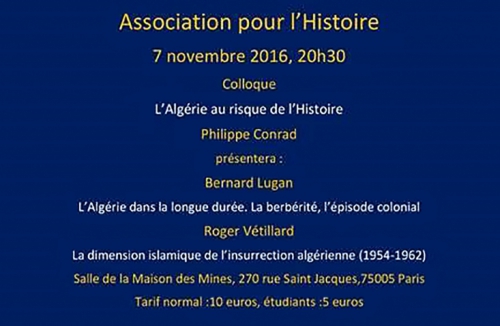

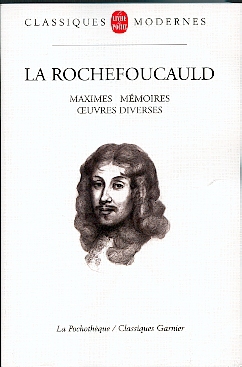 Rien n’incline davantage à la passion que les questions morales. Ce glissement du principe vers la passion n’est pas sans dangers : tous les fanatismes naissent de cette conviction ardente en la justesse universelle de nos principes. Il semblerait que nous devenions dévastateurs et cruels à mesure que nous nous persuadons de l’excellence de nos bons sentiments et du bon droit que des bons sentiments nous confèrent à juger du Bien et du Mal. Le mal que nous infligeons à autrui est d’autant plus terrible qu’il s’inflige au nom du Bien. Il y a dans la morale des moralisateurs, dans la « moraline », pour reprendre le mot de Nietzsche, un élan à la fois vil et prédateur que la volonté de puissance la plus soutenue n’atteint que rarement.
Rien n’incline davantage à la passion que les questions morales. Ce glissement du principe vers la passion n’est pas sans dangers : tous les fanatismes naissent de cette conviction ardente en la justesse universelle de nos principes. Il semblerait que nous devenions dévastateurs et cruels à mesure que nous nous persuadons de l’excellence de nos bons sentiments et du bon droit que des bons sentiments nous confèrent à juger du Bien et du Mal. Le mal que nous infligeons à autrui est d’autant plus terrible qu’il s’inflige au nom du Bien. Il y a dans la morale des moralisateurs, dans la « moraline », pour reprendre le mot de Nietzsche, un élan à la fois vil et prédateur que la volonté de puissance la plus soutenue n’atteint que rarement.
