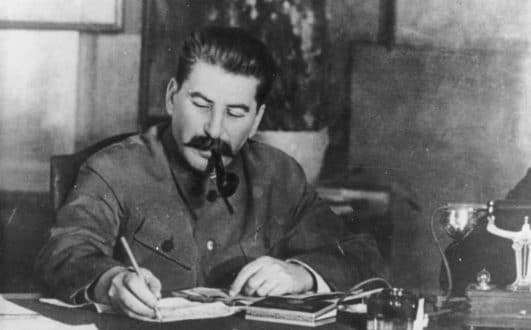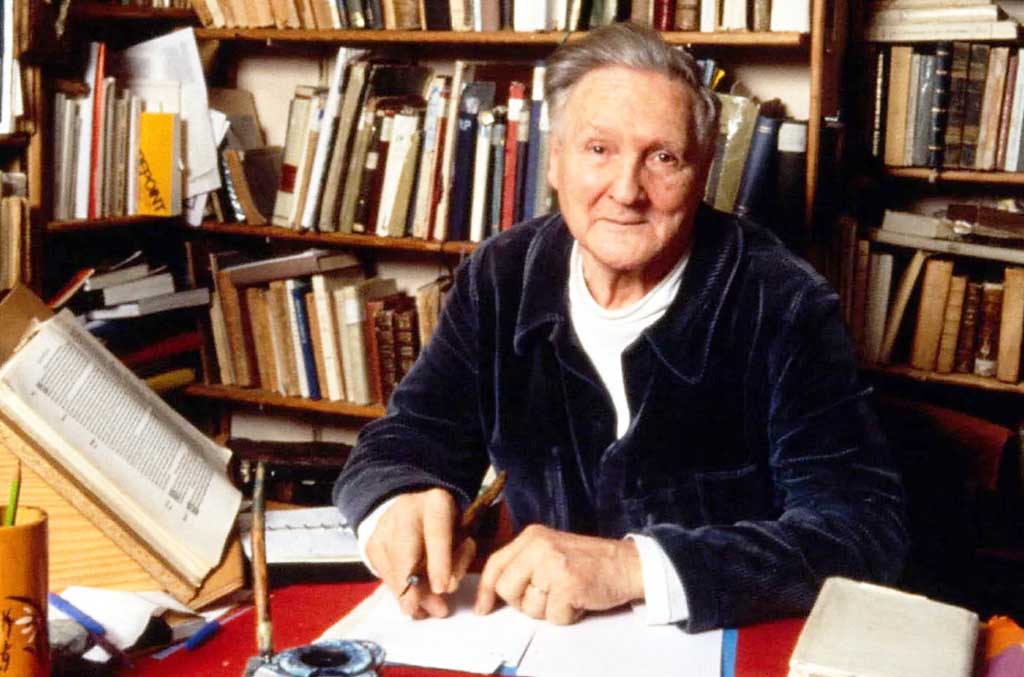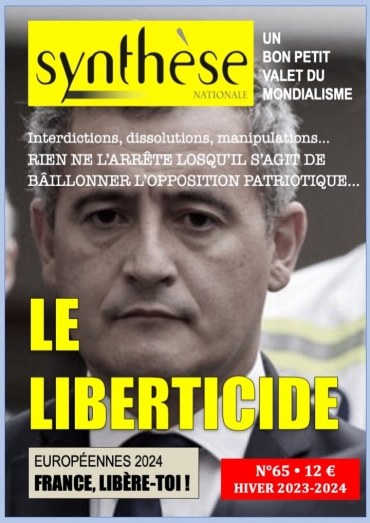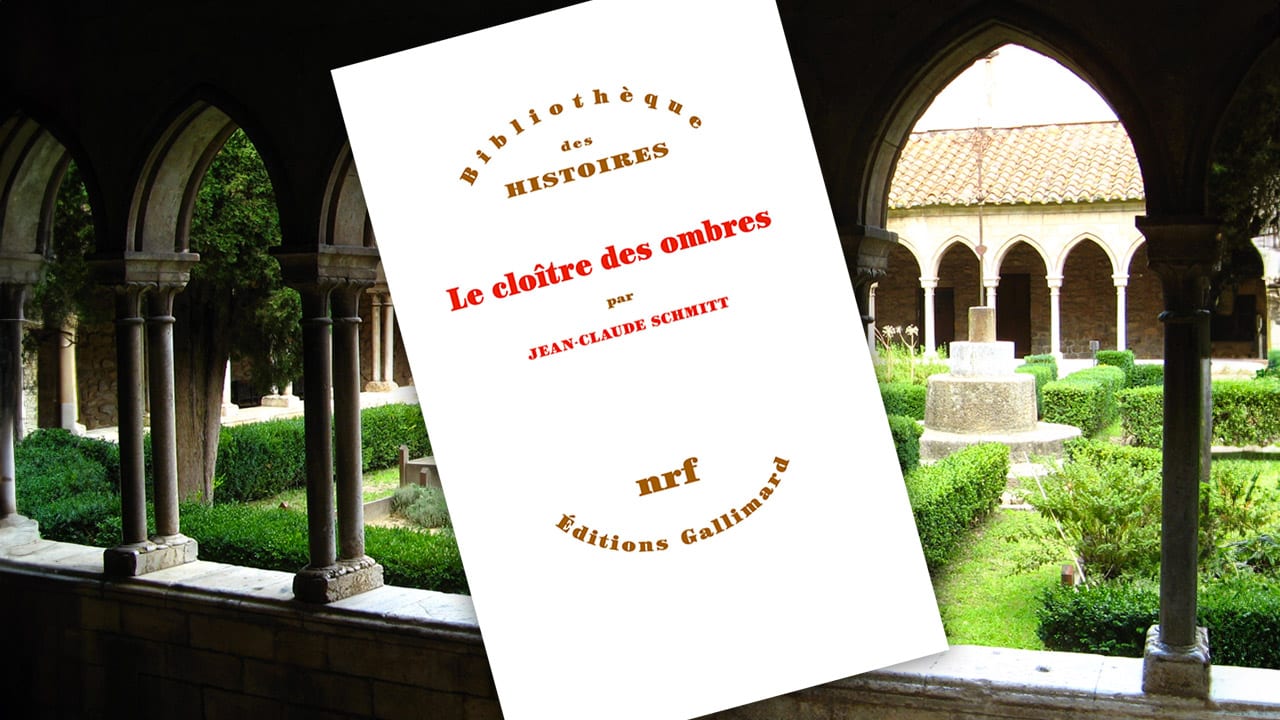Dans les années 1930 en Allemagne, Hitler et le nazisme gagnaient en puissance. A mesure que s’imposait l’évidence du caractère maléfique de leurs intentions réelles, les dirigeants européens, enfin presque tous, ne cessaient de nier cette évidence.
Cet article montre l'aveuglement, puis la lâcheté de la classe dirigeante et des médias au nom d'un éventuel accord avec Hitler visant à protéger la Paix. Vous y verrez que les mêmes mécanismes sont en oeuvre de la part de ceux qui espère que l'Islam d'Europe sera un islam des "Lumières" !