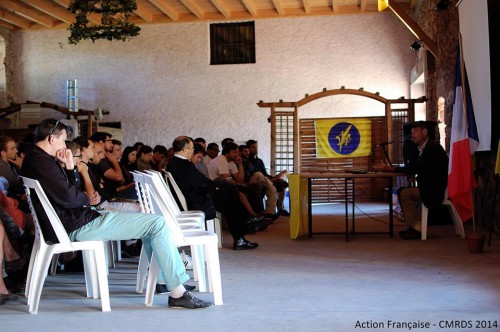La troisième partie de notre chronique sur le totalitarisme intégral portera sur un aspect de l’argumentaire de masse – comprenez celui qui est servi tout prêt à la populace –, l’un des traits fondateurs de la pensée unique. C’est une négligence intellectuelle aiguë érigée en principe rhétorique. La reductio ad erratum, nous l’appellerons ainsi, n’est rien de moins que l’anathème jeté sur celui qui remet en cause un fait généralement admis, émanant le plus souvent des organes officiels de l’État. C’est la solution tout terrain pour les suiveurs qui entendent rester embourbés dans un affligeant confort intellectuel.
Voilà l’outil argumentaire le plus novateur des dernières décennies, qui trouverait aisément sa place dans « l’art d’avoir toujours raison », s’il n’était apparu quelques 140 ans après la rédaction de l’ouvrage, car il est le moyen de balayer d’un revers de main tous les doutes et tous ses adversaires en bafouillant cette simple assertion : vous êtes complotiste.
Pour comprendre les raisons d’un tel procédé, nous devons remarquer deux éléments importants : d’une part, les gens croient que l’État leur veut du bien, de telle façon qu’ils ne le remettent jamais en cause dans ses fondements. Ils sont comme viscéralement formatés, réduits à un état d’enfance perpétuelle, jusqu’à une mise sous tutelle complète, à l’image de l’enfant qui ne doute jamais de son père. À ce propos, nous ne saurions que trop redire, que les jeunesses républicaines n’apparaissent pas moins dangereuses que les jeunesses hitlériennes ou communistes, notamment parce que la république les surplombe toutes ; D’autre part, ce moyen rhétorique est également la négation des différences jusqu’à un niveau factuel, on s’imagine que l’individu qui remet en cause la version officielle des attentats du 11 septembre 2001 est le même que celui qui rejette la version officielle du Tribunal de Nuremberg, comme il est parfaitement correspondant à celui qui ne croit pas à la théorie de l’évolution, ou à celui qui estime que le mondialisme guide la mondialisation comme idéologie.
La reductio ad erratum est donc l’amalgame intellectuel par excellence, la réduction de tous les doutes à un comportement psychologique maladif ; quelques-uns ayant été jusqu’à théoriser et catégoriser celui qui doute de faits historiques ou scientifiques. On s’autorise par là, à prévenir tous les futurs sceptiques en limitant leurs raisonnements à un comportement naturel et prévisible sans aucun autre fondement que la peur, la paranoïa, le manque, le déséquilibre, le besoin de réenchantement, mais surtout, la haine. Il y a un côté aberrant à comparer des faits qui ne sont pas forcément comparables, la nature même de la vérité étant unique, qu’on nous dise en quoi les événements de la Seconde Guerre mondiale sont comparables à l’hypothèse d’un complot extraterrestre. Ni les arguments, ni les dossiers à étudier, ni les protagonistes ne sont les mêmes ; pourtant, celui qui use de la reductio ad erratum prétend que c’est la même chose. De fait, on se rend vite compte que l’absurde est du côté des impertinents.
Si le vrai est uniquement issu des officines gouvernementales, en faire un démenti revient pour ces personnes à de la folie pure, chez les plus endoctrinés on ne prend même plus la peine de lire ceux qui rejettent les différentes versions historiques officielles, car ils considèrent que ceux qui doutent y sont prédisposés, tant psychologiquement, que socialement ou intellectuellement ; ainsi, matérialisant le doute de leurs contradicteurs à l’aide de prérequis physiologiques, vont-ils jusqu’à condamner pour déviance, bannir sans procès et ridiculiser ceux qui osent s’opposer. Or cet interdit se présente comme la pierre angulaire du totalitarisme intégral. On remarque que les ouvrages qui émettent des arguments contraires à ceux des gouvernements sont souvent autorisés, et ceci nous inquiète plus que s’ils étaient interdits, car cela prouve que la mentalité générale est soumise et crétinisée, par un État républicain et un Empire sûr de lui-même, ne doutant plus de ses sujets, il les sait fidèles et imperméables à toute idée dissidente, du moins pour une écrasante majorité. Il est certain qu’une part importante de la population, en intériorisant l’erreur moderne, a atteint une autosuffisance anti-culturelle voir anti-civilisationnelle, tout en broyant les quelques comportements indisciplinés.
Qu’on remarque bien en outre que les mots utilisés dans cette étude sont courants en sociologie. L’intériorisation est aussi l’un des mécanismes grâce auquel s’effectue la socialisation, qui est l’un des instruments de conservation de la République, car pour subsister elle doit se substituer à toutes les autres cultures, socialiser, mais surtout convertir, révélant par cela son caractère hautement évangélisateur.
evolutionRappelons cependant que, dans nos états totalitaires, certaines situations sont très avancées en terme de privation de libertés ; en France comme dans d’autres pays Européens, on peut ne pas croire en Dieu, mais l’on ne peut pas, ne pas croire en la Shoah, une folie qu’un grand nombre d’historiens juifs n’ont pas manqué de dénoncer, arguant que ce n’était aucunement un moyen de lutter contre le révisionnisme historique. On peut dire au contraire que cela démontre que le système a des fondements intouchables, et qu’il dévoile sans complexe ses cartes, avouant son absolutisme, conforté par un hébétement généralisé.
La loi se prononce ainsi sur les avis de chacun au motif qu’ils choqueraient certaines personnes, ou qu’ils nuiraient à d’autres, car elle doit invoquer de bonnes raisons pour s’attaquer à la liberté des individus. En règle générale, l’idéologie dominante s’appuie sur l’aspect le plus imprégné dans la société moderne : le sentimentalisme, ce pathos, étant certainement le sentiment le plus méprisable qu’il fût donné de ressentir à l’espèce humaine, voilant une des clefs de la déviation moderne.
Par ailleurs, le totalitarisme ne se fonde pas uniquement sur l’aspect législatif, il effectue une marginalisation de celui qui doute, par le contrôle social, bien plus efficace. Après 30 ans de propagande éducative, vous pourriez faire intégrer n’importe quoi à n’importe qui, et pour de nombreuses générations. Pensez aux milliers d’associations gauchiardes qui grenouillent d’école en école avec vos impôts pour aller prêcher leur monde nouveau, pensez aux heures durant lesquelles vos enfants sont exposés à l’ignominie de l’éducation républicaine ; de fait, la pression sociale que subissent les individus présentés comme déviants est extrême. Nous ne doutons pas au surplus, que nos lecteurs en aient fait le douloureux apprentissage, et qu’ils soient condamnés à le faire tout au long de leurs vies. Plusieurs expériences qu’on analysera dans nos prochains billets montrent à ce sujet, l’importance du suivisme dans nos sociétés contemporaines ; Solomon Asch sut très bien mettre en évidence ce phénomène, en montrant que 33 % des individus étaient capables de se conformer à l’opinion du groupe malgré le caractère ostensible de l’erreur de ce dernier ; intervient dans ce processus un certain nombre de mécanismes parmi ceux que l’on étudie présentement.
Rappelons enfin, puisque l’on aborde la propagande éducative – terme pléonastique s’il en est –, que l’éducation de masse est avant tout le contrôle des masses. Lorsque l’on éduque son chien, son bien-être est secondaire, c’est le nôtre qui prime et l’usage que l’on entend de l’animal ; dès lors, celui qui penserait que le peuple revêt pour l’oligarchie quelques différences d’avec une meute de chiens dociles serait en proie à une grande méprise. Dans ce domaine, la meilleure façon d’éduquer les masses est sans conteste la télévision, car elle porte en elle de nombreuses qualités : elle est rentable, elle docilise, abêtit, et détourne l’attention, allant même jusqu’à organiser une forme d’hypnose collective. De notre point de vue, une société ayant mis en place des normes et des valeurs, et les défendant au moyen d’arguments totalement aberrants, est une société basée sur des fantasmes. Celle-ci, outrepassant toute logique, apparaît alors fondamentalement nécrosée.
Nous n’entendons pas cependant nous laisser aller à la défense de toutes formes de révisionnisme, car il faut bien admettre qu’il peut être difficile à contenir, en ce que sur n’importe quel sujet nous pouvons toujours argumenter, comme nous le montre l’exemple hypercritique du récentisme qui va jusqu’à arguer que le Moyen Âge est une invention des historiens anciens. Nous ne pouvons à ce sujet, que conseiller la lecture de l’article de monsieur Mallet, « Pour en finir avec le récentisme », qui démonte en partie cette gangreneuse dérive de la dissidence. Notons à ce sujet que l’hyper-critiscisme est un phénomène spécifiquement moderne, c’est une branche du rationalisme participant à la confusion des esprits et à l’égarement. Tout ceci s’avère d’ailleurs d’une grande utilité pour le système puisqu’il perd les individus dans un dédale interminable, ralliant les contestataires à un solipsisme continuel et auto-entretenu par une réinformation mortifère.
Comme nous parlions précédemment des apprentis sorciers qui étudient les comportements « complotistes » (sic), Pierre-André Taguieff nous a gratifié à ce titre, de l’identification de quatre grands principes de base des croyances conspirationnistes, à savoir que « rien n’arrive par accident ; tout ce qui arrive est le résultat d’intentions ou de volontés cachées ; rien n’est tel qu’il paraît être ; tout est lié, mais de façon occulte. » Sans trop relever l’idée sous-jacente de ces assertions, incitant le lecteur à voir chez lesdits « conspirationnistes » une paranoïa aiguë, on peut simplement relever le ridicule de ce genre d’analyse en inversant ces allégations. Que diriez-vous alors, si l’on vous racontait naïvement que « tout arrive par accident ; rien de ce qui arrive n’est le résultat d’intentions ou de volontés cachées ; tout est tel qu’il paraît l’être ; rien n’est lié… » nous ajouterions bien un petit « dormez tranquilles », qui viendrait compléter le tout, si l’on n’avait pas compris, dès le premier mot, que ce genre de catégorisation est inepte.
Tel que nous le disions, le simple fait de généraliser un comportement à de multiples études n’ayant souvent que peu de rapport entre elles est un sophisme. Des phénomènes se produisent, c’est factuel, des intérêts sont servis c’est évident, beaucoup agissent mal, mais de bonne foi, cependant, l’idée de savoir si ces personnes en sont conscientes est sans importance, certains le sont, la plupart ne le sont pas. « Il n’y a pas de complot, il y a une discrétion de la part des gens qui nous mènent », dixit Pierre Hillard. Faut-il être politologue pour le conclure ? Il est navrant qu’on fasse intervenir des psychologues dans des affaires qui relèvent des compétences scientifiques, historiques, ou sociologiques.
Afin de conclure sur cet aspect du Totalitarisme intégral, nous rendrons compte d’un extrait de l’œuvre de Pierre Bayle, un précurseur des « lumières » avec lequel nous ne partageons presque rien sur pratiquement tous les sujets, si ce n’est celui qui va suivre. S’il nous est permis d’ailleurs d’éclairer le lecteur sur notre choix de partager ce texte, c’est parce que monsieur Bayle est comme le maître à penser de la déviation occidentale. Il est d’ailleurs étonnant qu’il ait échappé à la plume affûtée de René Guénon, ou bien celle encore de Julius Evola et d’autres référents contemporains de la philosophia perennis, parce qu’en réalité son logiciel est bien plus pervers encore que celui de Descartes, et son influence a été d’une importance capitale sur les « lumières », bien qu’en réalité l’impact de ces derniers n’était que fortuit. À dire vrai, l’œuvre en question ne doit son prestige qu’à la médiocrité de ses contradicteurs, elle tricote ainsi un tissu de mensonge et d’incohérence gigantesque, d’ignorance souvent mêlée de vues personnelles qu’il serait bon un jour de découdre en totalité. Un tel exercice ne serait pas alors inutile, car il énonce dans ses Pensées diverses sur la comète bien plus que de simples balbutiements de la pensée moderne– elle y est même plutôt développée. Pour autant, si les modernes pouvaient voir que même leurs pairs avaient, en leurs temps, fustigé les méthodes qu’ils appliquent aujourd’hui, non sans une certaine verve du reste, ils pourraient entrevoir l’inanité de leurs orientations ou plutôt, si nous voulons être exacts, de leurs désorientations.
Ce texte de Bayle fut plus tard repris par Schoppenhauer dans son Art d’avoir toujours raison. Ce dernier traduisit le passage avec quelques libertés, sans en détourner le sens originel, mais en l’arrangeant pour lui donner une portée universelle. Cependant Bayle, en bon moderne, s’essuyait plus les pieds sur la méthode traditionnelle – qui se passe de remise en question, de débats et autres fioritures pseudo-intellectuelles – qu’il n’en dénonça l’inertie occidentale actuelle. Le titre de ce passage, intitulé « De l’Autorité de la tradition », dans lequel est dénoncée la transmission traditionnelle du savoir, nous éclaire sur les vues de Bayle. Tandis qu’on utilisera ce texte, pour dénoncer l’argument d’autorité cher aux universitaires, mais propre à la société dans son ensemble qui tendent à se démarquer par l’inexistence de toute forme de remise en question de leurs aînés, en une sorte de filiation nommée « écoles de pensées ». Nous ne parlerons pas de Tradition avec un grand T, car elle est toute autre chose que le simple fait de transmettre, c’est la connaissance divine « L’alpha et l’oméga » de notre monde.
Ainsi, répondant de la fausseté que les comètes seraient annonciatrices de malheur, en s’attaquant aux arguments d’autorités – éléments à l’appui duquel s’effectue la réductio ad erratum – Bayle, et plus encore Schoppenhauer, car c’est à lui qu’on doit cette version, dénoue comme il se doit le nœud bien grossier des patriarches du mensonge présent.
« Ce que l’on appelle l’opinion commune est, à y bien regarder, l’opinion de deux ou trois personnes ; et nous pourrions nous en convaincre si seulement nous observions comment naît une telle opinion. Nous verrions alors que ce sont d’abord deux ou trois personnes qui l’ont admise ou avancée et affirmée, et qu’on a eu la bienveillance de croire qu’elles l’avaient examinée à fond ; préjugeant de la compétence suffisante de celles-ci, quelques autres se sont mises également à adopter cette opinion ; à leur tour, un grand nombre de personnes se sont fiées à ces dernières, leur paresse les incitant à croire d’emblée les choses plutôt que de se donner le mal de les examiner. Ainsi s’est accru, de jour en jour, le nombre de ces adeptes paresseux et crédules ; car une fois que l’opinion eut pour elle un bon nombre de voix, les suivants ont pensé qu’elle n’avait pu les obtenir que grâce à la justesse de ses fondements. Les autres furent alors contraints de reconnaître ce qui était communément admis pour ne pas être considéré comme des esprits inquiets s’insurgeant contre des opinions universellement admises, et comme des impertinents se croyant plus malins que tout le monde. Adhérer devint alors un devoir. Désormais, le petit nombre de ceux qui sont capables de juger est obligé de se taire ; et ceux qui ont le droit de parler sont ceux qui sont absolument incapables de se forger une opinion et un jugement à eux, et qui ne sont donc que l’écho des opinions d’autrui. Ils en sont cependant des défenseurs d’autant plus ardents et plus intolérants. Car ce qu’ils détestent chez celui qui pense autrement, ce n’est pas tant l’opinion différente qu’il prône que l’outrecuidance qu’il a à vouloir juger par soi-même – ce qu’ils ne font bien sûr jamais eux-mêmes, et dont ils ont conscience dans leur for intérieur.
Bref, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir des opinions ; que leur reste-t-il d’autre que de les adopter telles que les autres les leur proposent au lieu de se les forger eux-mêmes ?
Puisqu’il en est ainsi, que vaut l’opinion de cent millions d’hommes ?
Autant que, par exemple, un fait historique attesté par cent historiens quand on prouve ensuite qu’ils ont tous copié les uns sur les autres et qu’il apparaît ainsi que tout repose sur les dires d’une seule personne. »
(Extrait de Pensées diverses sur la comète, Pierre Bayle, vol., p. 10 , 1683)
Jérôme Carbriand
http://www.lebreviairedespatriotes.fr/20/08/2014/politique/le-totalitarisme-integral-iii-la-theorie-du-complot-ou-la-reductio-ad-erratum/