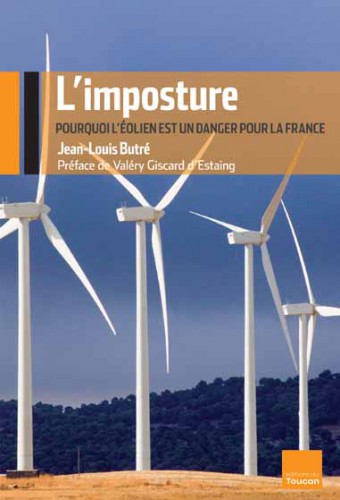« Les médias ne diffusent pas des « informations », comme ils le prétendent, mais une idéologie conforme aux intérêts de ceux qui les possèdent ».
La novlangue ne correspond pas seulement à un tic ridicule, signe de reconnaissance de l’oligarchie et de la classe médiatique. Elle s’attaque à la pensée, comme l’avait bien vu également G. Orwell. En n’employant plus certains mots elle tente de nous priver de la capacité de conceptualiser, de réfléchir par nous-mêmes. Le débat lancé en 2012 visant à retirer le mot « race » de la constitution n’était pas innocent sur ce plan.
NOVOpress : Le Nouveau Dictionnaire de novlangue vient d’être réédité. Pouvez-vous revenir sur la genèse de cet ouvrage ? Pourquoi ce livre ?
Michel Geoffroy : L’idée du Dictionnaire de la novlangue est venue de l’analyse critique de la désinformation médiatique effectuée par la Fondation Polémia dans le cadre de son action de réinformation. Les médias ne diffusent pas des « informations », en effet, comme ils le prétendent, mais une idéologie – c’est-à-dire une vue du monde – conforme aux intérêts de ceux qui les possèdent et les dirigent : les grandes banques et les grandes entreprises transnationales.
Pour ce faire les médias sélectionnent les faits qui leur paraissent conformes à ces intérêts, les présentent sous un certain jour et censurent ou diabolisent les autres. Pour ce faire également, ils adoptent une façon politiquement correcte de présenter ce qu’ils ne peuvent taire : en utilisant la novlangue justement.
Le Dictionnaire de la novlangue vise à traduire et donc à dénoncer cette langue médiatique étrange qui a pour fonction de nous tromper. La novlangue est un bobard permanent qui exprime l’emprise du politiquement correct sur notre société. Dépister la novlangue constitue donc une œuvre de salubrité et contribue à rétablir une liberté essentielle : la liberté de penser.
Ce que vous appelez « novlangue » n’est-il pas simplement la manifestation d’un appauvrissement intellectuel de nos sociétés ?
La novlangue n’est pas exactement un appauvrissement du langage. Elle repose plutôt sur une modification – et souvent une inversion – du sens des mots qui traduit plus profondément un processus de renversement volontaire des valeurs. Parce que l’oligarchie cherche justement à faire violence à la société. Comme le disait G. Orwell en novlangue « la liberté c’est l’esclavage » : on s’efforce de désigner des choses différentes par le même mot. Comme, par exemple, lorsqu’on désigne sous le terme de « racisme » la volonté de préserver l’identité française.
Pour la langue française, qui reposait au contraire sur la précision et le sens des nuances – raison pour laquelle elle a joué longtemps le rôle de langue des diplomates –, la novlangue représente effectivement une régression culturelle majeure.
Quels sont les critères pour déterminer qu’un mot fait partie de la « novlangue » ?
Comme le montre le Dictionnaire, la novlangue correspond d’abord aux mots et expressions les plus couramment employés dans le vocabulaire très pauvre des médias, écrits ou audiovisuels, en particulier pour désigner une réalité problématique, donc que le système veut masquer. Pour trouver de la novlangue il suffit par exemple de lire des articles de presse traitant de la délinquance ou de l’immigration !
La classe politique, soumise aux médias, parle aussi novlangue et constitue un autre gisement. Nous avons enfin ajouté dans la seconde édition du Dictionnaire certains termes utilisés par les publicitaires car la publicité relève aussi de la désinformation.
Pour mériter d’entrer dans le Dictionnaire il faut qu’un mot ou une expression traduise un décalage manifeste, réducteur ou ridicule avec la réalité qu’il prétend désigner ; ou que l’expression soit particulièrement alambiquée, trahissant la volonté de cacher quelque chose. Les oxymores – genre assez prisé par la classe politique – relèvent aussi de la novlangue puisqu’ils servent à « communiquer » pour ne rien dire. Bref, le ventre du politiquement correct est particulièrement fécond en novlangue, comme l’illustre cette nouvelle édition du Dictionnaire, très enrichie, si l’on peut dire, par rapport à la précédente.
Le terme « novlangue » fait explicitement référence au livre 1984 de George Orwell. Au-delà des modes qui influencent le langage, pensez-vous que l’usage de certains mots se fait de manière délibérée, dans le cadre de campagnes de publicité par exemple ?
Bien sûr. La novlangue part de l’idée – initiée par les structuralistes français – que les mots véhiculent des valeurs et qu’en changeant le sens des mots on réussira à changer la réalité des choses : démarche en réalité de nature magique qui repose sur une logique incantatoire, propre aux utopistes. La novlangue a donc pour fonction d’empêcher de penser les choses telles qu’elles sont. Il s’agit d’une désinformation qui a pour finalité de jouer sur les perceptions du sujet qui utilise ces mots. Il est manifeste, par exemple, que la novlangue a été utilisée pour minimiser les réalités dramatiques de l’immigration de peuplement en s’efforçant de nous faire croire qu’il ne s’agissait que de problèmes « sociaux ». Mais cela ne trompe plus personne en réalité car « les faits sont têtus », comme le savait Lénine à ses dépens. Un aveugle ne voit pas mieux au motif qu’on l’appelle un « non-voyant » !
Journalistes, publicitaires, politiques : leur usage commun de la « novlangue » ne trahit-il pas finalement leur appartenance à un même cercle de pouvoir ?
Vous avez raison. La novlangue est devenue la langue et donc le signe de reconnaissance de l’oligarchie, comme le latin dans le passé européen, ou le marxisme pour la nomenklatura à la fin de l’Union soviétique.
Toute l’oligarchie parle novlangue couramment et c’est une des raisons pour lesquelles la coupure avec le pays réel ne cesse de s’approfondir. L’oligarchie et la population ne peuvent pas se comprendre puisqu’ils ne parlent plus la même langue : les uns évoquent la « mondialisation heureuse », « l’immigration-chance pour la France » ou « le mariage pour tous », alors que le reste de la population parle chômage, précarité, impôts, insécurité ou crise de la famille.
La novlangue exprime la façon dont l’oligarchie voudrait que l’on voie le monde : un monde évidemment conforme à ses intérêts. Mais ce monde n’existe pas aux yeux de la majorité de la population. L’illusion de la novlangue se déchire donc rapidement. Et les Européens se découvrent de plus en plus nombreux à appeler les choses par leur nom.
Propos recueillis par Yves Lejeune pour Novopress 7/11/2013
Nouveau Dictionnaire de novlangue/ Plus de 500 mots pour vous manipuler. Ed. Polémia (octobre 2013).
Cinq cents mots parmi les plus employés par l’oligarchie dirigeante et les médias pour tromper l’opinion : mots tabous, trompeurs, marqueurs, sidérants ou subliminaux passés au décryptage de Polémia.
Acheter en ligne sur la boutique de Polémia.
http://www.polemia.com/entretien-avec-lauteur-du-nouveau-dictionnaire-de-novlangue/