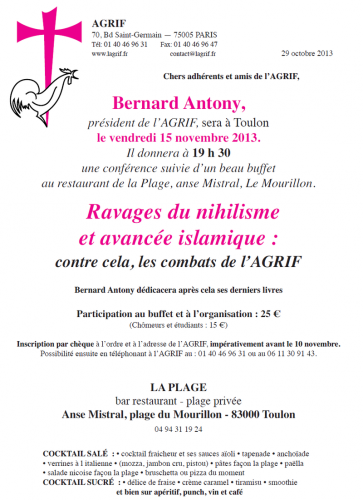L’écrivain Gabriel Matzneff a été encore récemment honoré il y a quelques jours, d’un prix Renaudot, pour son dernier essai.
L’homme est parfois apprécié et cité dans certains milieux « nationaux », pour la finesse de sa plume ou certaines remarques ou fréquentations « réacs ». Il collabore d’ailleurs à la pernicieuse revue-phare de la « Nouvelle-Droite », Éléments.
Or ce pervers ne cache pas son goût pour les jeunes de « moins de 16 ans », « enfants » et « jeunes gens ».
Il y revient dans plusieurs de ses ouvrages, avec des passages autobiographiques écœurants. C’est un véritable prosélyte.
Ci-dessous la lettre indignée de la présidente d’une association de défense des enfants.
« Une insulte à tous les enfants victimes !
Sous le couvert d’argumentaires littéraires, il sera relayé par les médias, invité sur les plateaux de télévision, et soutenu dans le milieu littéraire.
Dans son essai, » Les Moins de seize ans », Gabriel Matzneff expose son goût pour les mineurs des deux sexes.
Il use du terme « enfant » pour désigner indifféremment les enfants et les jeunes adolescents, sans évoquer la notion de puberté. Il écrit : « Ce qui me captive, c’est moins un sexe déterminé que l’extrême jeunesse, celle qui s’étend de la dixième à la seizième année et qui me semble être — bien plus que ce que l’on entend d’ordinaire par cette formule — le véritable troisième sexe. En revanche, je ne m’imagine pas ayant une relation sensuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de sa dix-septième année. (…) À mes yeux l’extrême jeunesse forme à soi seule un sexe particulier, unique. ».
Gabriel Matzneff revendique pour lui-même la qualification de « pédéraste », soit un « amant des enfants ».
Il dénonce par ailleurs le fait que le « charme érotique du jeune garçon » soit nié par la société occidentale moderne « qui rejette le pédéraste dans le non-être, royaume des ombres ». « Un enfant dit-il, appartient à ses parents et à ses maîtres. Ce sont eux qui en ont l’usage exclusif. Pourtant, c’est nous que ces nauséabonds personnages accusent de détournement de mineur ». Sommes nous donc de nauséabonds personnages, pour vouloir protéger nos enfants des gens que moi, je qualifie de prédateurs sexuel et d’abuseurs de nos jeunes enfants, naïfs de ce que représente une telle perversion?
Saviez-vous que Matzneff estime qu’« il n’y a pas un homme normalement constitué qui lise le croustillant récit des amours de Tonton Lucien (histoire d’un quinquagénaire qui avait, au cours de « ballets roses », abusé de fillettes âgées de onze à quinze ans), sans bander et songer qu’il aurait bien aimé être à sa place ». Quand on lit ce genre d’affirmations, je me demande comment réagissent les hommes à la lecture de telles accusations et comment Matzneff, n’a pas encore eu de procès en bonne et dû forme de la part de la gente masculine. Ne peut-on pas le qualifier de consommateur du sexe quand il affirme « En outre, si violence il y a, la violence du billet de banque qu’on glisse dans la poche d’un jean ou d’une culotte (courte) est malgré tout une douce violence. Il ne faut pas charrier. On a vu pire ».
Présidente de l’association La Mouette, association de défense et de protection de l’enfant, j’ai été scandalisée et je reste scandalisée par ses propos fallacieux qui ramènent l’enfant à un « prostitué potentiel », une honte diffamatoire sur la moralité et les désirs propres d’un enfant.
Le psychiatre Bernard Cordier estimait en 1995 qu’« un écrivain comme Gabriel Matzneff n’hésite pas à faire du prosélytisme. Il est pédophile et s’en vante dans des récits qui ressemblent à des modes d’emploi.
Or cet écrivain bénéficie d’une immunité qui constitue un fait nouveau dans notre société. Souvenez-vous, lorsque la Canadienne Denise Bombardier l’a interpellé publiquement chez Pivot, rappelant le « Droit à la personne ». C’est elle qui, dès le lendemain, essuya l’indignation des intellectuels.
Lui passa pour une victime : un comble ! (…) On ne prétend pas que ce type d’écrits sème la pédophilie, mais il peut la cautionner et faciliter le passage du fantasme à l’acte chez des pédophiles latents. Ces écrits rassurent et encouragent ceux qui souffrent de leur préférence sexuelle, en leur suggérant qu’ils ne sont pas les seuls de leur espèce et leur donnent un statut de victimes. D’ailleurs, les pédophiles sont très attentifs aux réactions de la société française à l’égard du cas Matzneff. Les intellectuels complaisants leur fournissent un alibi et des arguments : si des gens éclairés défendent cet écrivain, n’est-ce pas la preuve que les adversaires des pédophiles sont des coincés, menant des combats d’arrière-garde ?
Pour l’universitaire américain Julian Bourg, la distinction opérée ainsi par Matzneff relève d’un désir de défendre « les pédophiles bien intentionnés comme lui », ainsi tout est dit.
C’est une insulte à tous les enfants victimes et cela me choque .
Annie GOURGUE
présidente de l’association la Mouette »
http://www.contre-info.com/gabriel-matzneff-un-gros-degenere-toujours-honore#more-30067