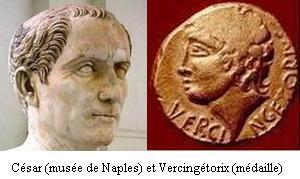Avocat, spécialiste de droit public des affaires, ancien universitaire, Michel Guénaire est un libéral de l'ancien temps qui s'efforce de renouer avec les grands classiques de sa famille de pensée, loin des clichés néo-libéraux, tout en dénonçant la vacuité identitaire d'une Europe amnésique, confrontée à un monde multipolaire de plus en plus conscient de ses spécificités.
Le Choc du mois : Comment l'avocat des affaires plutôt libéral que vous êtes en est-il venu à écrire des livres qui remettaient assez profondément en cause l'orthodoxie du néo-libéralisme ?
Michel Guénaire : Mon point de départ est, en effet, un engagement libéral. À vingt ans, je lisais Benjamin Constant, quand mes condisciples vivaient encore dans la vénération du marxisme. Après avoir embrassé un temps la carrière universitaire, j'ai rejoint le barreau d'affaires en 1990, un an après la chute du mur de Berlin. J'ai alors assisté à l’éclosion d'un nouveau modèle économique mondial, qui prenait progressivement ses distances avec l'héritage du libéralisme classique. Je m'y suis intéressé. Mes essais ont ainsi recueilli les observations et les leçons que je tirais de la mondialisation. Ma formation de base étant celle d'un publiciste (c'est-à-dire un spécialiste de droit constitutionnel, de droit international public et de régulation des marchés), je me suis d'abord penché sur une notion de plus en plus discréditée dans la doxa de l'économie néo-libérale : le pouvoir. Quid du pouvoir et de ses enjeux dans une société exclusivement organisée autour de la seule loi du marché ? C'est nouveau. Car, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, les libéraux de notre temps ont largement déformé la pensée et le combat de leurs devanciers, qui, au XIXe siècle, ne songeaient nullement à remettre en cause la légitimité du rôle de la puissance publique. Voyez l'inventaire qu'ont fait Charles Gide et Charles Rist des passages de La Richesse des Nations où Adam Smith évoque le rôle positif de l’État. D'autres que Smith, pareillement libéraux, n'ont pas manqué de souligner la part prépondérante que tient l’État dans l'organisation de la société. Si en réalité dans l'univers mental des néo-libéraux, on a pu à ce point associer libéralisme et anti-étatisme, c'est qu'on s'est focalisé sur le souvenir de la première lutte des libéraux contre la Monarchie, à l'exclusion des autres traditions libérales.
La thèse très forte de votre livre, c'est que le libéralisme est d'abord le produit d'une culture historique particulière et bien précise, celle de l'Angleterre, pas une philosophie universelle. Qu'en déduisez-vous exactement ?
C'est une thèse, ou une opinion, confortée par une observation attentive des cycles historiques : le libéralisme a été forgé au cours des siècles passés, principalement au long des trois grandes révolutions, anglaise, américaine et française, par des hommes qui avaient une préparation et une formation spécifiques. On les voit d'abord apparaître au sein de la société anglaise dans leur opposition à la monarchie absolue (songez à tous ces gentilshommes anglais des XVIIe et XVIIIe siècles, contemporains de John Locke). On retrouve les mêmes hommes en France à la même époque. Fénelon n’écrit-il pas, dans sa Lettre à Louis XIV, des pages que n'auraient pas reniées les libéraux anglais ? Montesquieu et Voltaire seront aussi des libéraux qui vont compter. À la différence du marxisme, le libéralisme n'est pas né de la pensée d'un seul homme, c'est une œuvre collective, tissée de génération en génération. Ce fil continu part, ou partait, de la notion de responsabilité individuelle. S'il posait en principe que tout individu peut commercer par-delà les frontières de sa nation, ce dernier devait néanmoins conserver une éthique civile et une responsabilité morale, à charge pour lui de partager en retour avec la collectivité le fruit de son travail. Or, le plus frappant aujourd'hui, c'est que le libéralisme s'est écarté de cet héritage historique. Il ne correspond plus qu'à des standards techniques, pas à une culture politique spécifique. Ces standards sont connus. C'est un schéma institutionnel théorique : la démocratie libérale, que l'on croit pouvoir faire advenir au travers d'élections libres, et le capitalisme libéral, synonyme de marché déréglementé. Ce libéralisme ne correspond à aucun cadre culturel dans la plupart des pays où il est appliqué. Ainsi, les États les plus durs sur le plan de la compétition économique, appliquant à la lettre les règles du libéralisme, sont précisément ceux qui, paradoxalement, sont, culturellement et historiquement, les plus étrangers à la formation de la pensée libérale. Citez-moi un Chinois qui ait écrit un livre ou une page d'inspiration libérale ayant contribué à la formation de cette famille de pensée ?
À quoi est due selon vous la crise financière et économique qui touche de plein fouet ce modèle de l'économie néo-libérale ?
Le modèle économique mondial actuel ne repose plus que sur la finance de marché. Une économie virtuelle a doublé l'économie réelle. Entre 1989, date de la chute du Mur de Berlin, et cette date très symbolique du 15 septembre 2008 - jour de la faillite de la banque d'affaires américaine Lehmann Brothers -, la finance fut le levier unique de l'investissement des entreprises, de la création des richesses des nations et du pouvoir d'achat. Ce levier était illusoire et dangereux. Il reposait sur un crédit facile et une ingénierie financière très complexe, née de l'outil de la titrisation, qui a créé un éloignement suicidaire entre le créancier et le débiteur. L'éclatement, à intervalles réguliers, des bulles boursières avait pourtant sonné autant d'avertissements, mais les grandes institutions financières, avec la complicité d’États qui les avaient considérablement aidées en œuvrant de leur propre chef à la déréglementation, n'ont jamais voulu renoncer à cette illusion de richesse. Ils y ont d'autant moins renoncé que personne ne les a proprement dissuadés de le faire. C'est un point très important à souligner, que de nombreux économistes ont gommé dans leur analyse de la crise : le modèle mondial néo-libéral n'a pas rencontré de contradiction, ni frein, ni limite d'aucune sorte, il s'est imposé sans résistance après la chute du Mur de Berlin.
Quelle leçon les libéraux doivent-ils tirer de la crise ?
La leçon à tirer, c'est qu'il leur faut au plus vite revenir aux origines de la pensée libérale, à savoir : sur le plan politique, retrouver les fondements de l'organisation de la cité ; et sur le plan économique, placer les acteurs devant les responsabilités qui sont les leurs. Mais par-dessus tout, dans des sociétés où tout va très vite et où apparaît une nouvelle donne géopolitique, les libéraux doivent repenser leur rapport avec le reste du monde.
Qu'entendez-vous par là ?
La crise financière a fait ressortir une certaine fatuité du modèle de développement économique né en Occident. Ce modèle a des racines anciennes. On peut les faire remonter à la première mondialisation, contemporaine de la révolution industrielle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pour ma part, je crois qu'elles sont antérieures. Le modèle occidental est né en réalité avec les grandes expéditions et découvertes de la Renaissance. Soit cinq siècles, qui correspondent à un cycle historique assez homogène : les expéditions ont permis à l'Occident d'asseoir sa domination sur le commerce mondial et de diffuser partout son modèle politico-économique. Mais aujourd'hui, les ressources morales de l'Occident, en tout cas de l'Europe, sont singulièrement asséchées. Le monde qui vient sera un monde multipolaire, découpé en grandes régions. L'urgence est donc, pour un libéral européen, de renouer avec les fondamentaux culturels qui sont les siens. Bref, de se réapproprier sa propre culture, ni plus ni moins que les autres régions du monde. Voyez les États-Unis et la Chine. Ces deux grandes régions du monde s'appuient, l'une et l'autre, sur des élites et une population fortement ancrées dans leur terreau culturel. Car, quoi qu'on dise, la vitalité américaine reste intacte - ce qui m'a toujours opposé à Emmanuel Todd et à nombre d'intellectuels français, très pessimistes à l'égard des États-Unis, peut-être parce qu'ils n'ont jamais voulu mesurer combien, outre-Atlantique, on avait le dynamisme économique dans le sang. Les Chinois, quant à eux, n'oublient jamais les leçons qu'ils peuvent tirer de leur propre histoire. Depuis le fameux discours de Deng Xiao Ping en 1978, qui a ouvert la Chine à la liberté des échanges commerciaux, ils sont dans le registre, non d'une conquête brutale du monde, mais d'une volonté de restauration de leur puissance. Face à ces deux modèles adossés à une identité culturelle clairement assumée, l'Europe fait figure de parent pauvre. On surprend chez elle le vertige d'une construction désincarnée. Amnésiques, les Européens nient leurs racines culturelles, croyant encore en un monde pacifié, sans adversité, où l'OMC et le FMI régleraient tous les différends, sans jamais tenir compte des spécificités - identités, cultures, projet de civilisation - de chacun.
Quel regard portez-vous sur ce que l'on nous vend comme étant une « sortie de crise » ?
Nous sommes toujours dans la crise, essentiellement parce qu'on n'a pas réglé tous les effets qui sont à l'origine de celle-ci, à commencer par la financiarisation de l'économie. La plupart des banques et des institutions financières d'Occident restent très exposées sur les subprimes et quantité d'autres produits dérivés sophistiqués. Nombreuses sont les banques vivant toujours dans l'illusion quelles seront finalement payées de leurs créances. Ajoutez à cela la dette des États et le transfert des réserves monétaires de l'Ouest vers l'Est, la Chine, la Russie et les États du Golfe détenant aujourd'hui beaucoup plus d'argent que l'Europe, les États-Unis et l'Australie. La sortie de la crise pâtit donc du rendez-vous perpétuellement ajourné d'un check-up définitif des risques financiers des institutions financières. Pour le dire autrement, il n'y a que deux voies possibles pour sortir de la crise. Celle, aujourd'hui privilégiée par l'Europe, d'une régulation plus forte des échanges entre les pays, les entreprises et les banques, telle qu'elle s'esquisse dans les sommets et autres réunions du multilatéralisme. C'est le monde comme il ne va pas depuis vingt ans, avec un peu plus de règles et un supplément de bonne conscience. L'autre voie considère que ce qui, dorénavant, va fixer la règle du jeu, ce sera davantage un équilibre entre des contraires qu'un ordre normatif exclusif et unique s'imposant uniformément à des nations différentes. Dans le monde qui vient, c'est l'équilibre qui devra donc être recherché, plutôt que l'ordre du monde.
Votre critique du libéralisme moderne vise aussi le culte idolâtre de la norme juridique. N'est-ce pas singulier pour un juriste ?
Il y a deux traditions juridiques : celle du Code et celle de la Common Law. J'appartiens à celle du Code, et considère que le droit doit être le tuteur des comportements individuels et des personnes morales dans une société. La culture de la Common Law, c'est celle de la règle de droit diffuse, et donc dispendieuse, puisqu'il faut nécessairement, pour l'interpréter, recourir à des hommes de droit. Outre cela, elle est conflictuelle. Le Code, lui, s'il est bien écrit, est pédagogiquement compréhensible par tous : ce sont des articles de morale au sens fort du terme, car ils permettent au plus grand nombre de se comporter de la même manière dans une société déterminée. L'Europe actuelle ne s'inscrit malheureusement pas dans la filiation disciplinaire du Code, mais dans celle de la Common Law. Elle est entièrement acquise à une culture juridique de la règle de droit explosée, difficile à interpréter et qui fait vite apparaître des rapports de force.
L'une des originalités de votre livre, c'est la réhabilitation que vous y faites d'une œuvre très discréditée de Thomas Mann, les Considérations d'un apolitique. Pourquoi cette référence est-elle si importante à vos yeux ?
Si j'ai souhaité mettre en avant cette œuvre de Thomas Mann, c'est quelle me paraissait exprimer avec le plus de clarté et de prescience, dans cette période incertaine, agitée et transitoire, que fut la fin du XIXe et le début du XXe siècle, l'une des interrogations les plus profondes qui pouvait alors se poser à un intellectuel européen : la quête d'identité. À l'approche de la Première Guerre mondiale, Thomas Mann, qui chérissait la liberté, s'est heurté à ce qu'on appellerait aujourd'hui une « pensée unique », aussi arrogante et aveugle que la nôtre, issue de la Révolution française et confortée par les certitudes propres à la bourgeoisie européenne, indifféremment anglaise ou française (il ne faisait d'ailleurs aucune distinction entre les Français et les Anglais). Une telle pensée unique se trouvait être au seul service de la civilisation libérale. Or, Thomas Mann considérait à raison que son pays, l'Allemagne, avait fait un autre choix culturel, fondé sur ses propres racines. À la civilisation franco-anglaise qui privilégiait l'écrit, la culture allemande avait choisi la musique ; et pendant que la première défendait une vision formelle et abstraite de la liberté, la seconde recherchait son identité réelle. Ce débat entre culture et civilisation, souvent caricaturé dans le paysage intellectuel français, est absolument fondamental. On devrait s'en souvenir pour appréhender d'au plus près les enjeux de la multipolarité. L'Allemagne qui, à la fin du XIXe siècle, défendait sa culture face à la civilisation libérale, ne peut-elle pas être comparée à la Chine qui, en ce début de XXI siècle, défend elle aussi sa spécificité culturelle face à la civilisation mondiale ? Thomas Mann s'est reproché par la suite ce livre parce que son combat pour la culture allemande allait être récupéré de la plus vilaine des façons, le livre disparaissant même de certaines de ses bibliographies, à l'inverse curieusement de La Montagne magique qui n'est pourtant rien moins que la traduction romanesque des Considérations d'un apolitique et a d'ailleurs valu à son auteur le prix Nobel de littérature.
Thomas Mann aurait-il pressenti en 1918 le mal qui détruit l'Europe aujourd'hui ?
Déracinée culturellement, l'Europe s'expose à un risque de déconstruction et de dépossession d'elle-même si elle s'obstine à ne pas renouer avec sa personnalité culturelle. À cet égard, le texte de Thomas Mann peut nous montrer la voie. Voyez la polémique autour des racines chrétiennes de l'Europe. Les rédacteurs de la Constitution européenne ont refusé que le préambule de la Constitution y fît référence explicitement, estimant que l'Union européenne ne devait pas offrir le flanc à des critiques. C'était une erreur. Plus un État se ment sur ses origines religieuses, plus il s'expose à des déchirements identitaires. Si l'Europe, et singulièrement un pays comme le nôtre, réaffirmait avec ambition ses racines et son identité chrétiennes, les autres religions y auraient tout à y gagner. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une identité qui ne rencontre face à elle aucune autre identité pour s'éprouver.
Propos recueillis par François-Laurent Baissa et Pierre-Paul Bartoli Le Choc du Mois mai 2011
Michel Guénaire, les deux libéralismes, Perrin, 484 p., 25 €.
Michel Guénaire, Il faut terminer la révolution libérale, Flammarion,
200 p., 16 €.