culture et histoire - Page 896
-
Les heures sombres ou la réécriture historique à la gloire de l'Angleterre!
-
Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray [XXV]

Travailleur immigré au travail chez Renault Cléon
Nous poursuivons la publication d'une série qui devrait faire date ; qui forme un ensemble à lire en entier : une étude de Pierre Debray parue en novembre 1985 dans le mensuel Je Suis Français, sous le titre Une politique pour l'an 2000. Nous sommes ici dans la 2ème partie de cette étude. La lecture de ces textes expliquera aux lecteurs qui ne l'ont pas connu le rôle intellectuel important de Pierre Debray à l'Action Française dans les années 1950-2000. Cette analyse politique, économique, sociologique et historique, menée méthodiquement, à la maurrassienne, comporte de multiples enseignements, utiles aujourd'hui à notre école de pensée. Comme un stimulant de notre réflexion sur la situation présente de la France et sur l'action que nous avons à y mener. Même si le lecteur devra tenir compte des événements et des faits intervenus au cours des trois dernières décennies. LFAR
2ème partie : Une révolution copernicienne
LA DÉMOCRATIE OU LA VIE
Il conviendra d'analyser les causes de cet effondrement. Les attribuer purement et simplement aux « réformes » qui furent mises en œuvre à cette époque (développement de la contraception, libéralisation de l'avortement, divorce par consentement mutuel) serait aller trop vite en besogne. Elles remplirent leur rôle. Cependant tous les pays occidentaux, quelle que fût la politique suivie, subirent la même évolution. La crise morale qui commence à affecter, vers 1964, un Occident, en proie au doute, a certainement joué. La « société de consommation »,qui corrode les valeurs familiales tout en provoquant un sentiment généralisé d'insatisfaction, engendre un mouvement de contestation qui commence sur les« campus » californiens et gagne l'Europe. Dans le même temps, la publicité fait du désir, moteur d'une société de consommation, l'unique ressort d'une existence humaine réduite à la satisfaction de l'instant.
Même entre 1946 et 1964, constate Sauvy, les enquêtes d'opinion montrent que les Français étaient demeurés malthusiens. Curieusement, ils faisaient des enfants, mais s'en effrayaient. La crainte que l'augmentation du taux de fécondité des couples n'engendre le chômage demeurait sous-jacente. Quand l'expansion commence à donner des signes d'essoufflement, le vieux réflexe se met à jouer. Avec la crise économique, en 1974, il retrouve toute sa vigueur d'autant que « le club de Rome » relayé par les grands médias agite les menaces d'une surpopulation mondiale. L'on est bien obligé de se demander s'il n'existe pas un vieillissement psychologique des peuples, qui se manifeste par une perte de confiance dans l'avenir. L'écologie, le pacifisme, constitueraient des signes pathologiques d'une angoisse collective. Ils relèveraient d'une idéologie sécuritaire que la gauche vertueuse condamne quand elle se manifeste par le désir d'un renforcement de la protection policière contre une délinquance qui était, incontestablement, plus grave au début du siècle. Les peuples vieillissants aspirent à une assurance tous risques.
Selon M. Sauvy, il existe une constante historique, dont il trouve des exemples dans la Grèce Antique, le Bas-Empire romain, la Venise décadente du XVIIIème siècle. La sénilité du corps social crée «un curieux phénomène non d'auto-défense, mais d'auto-analgésie ». L'opinion se bourre de tranquillisants. Tout lui est bon pour s'étourdir et éloigner du champ de la conscience un processus inéluctable qui débouche sur un suicide collectif. Les Français, comme jadis les Grecs, les Romains ou les Vénitiens, s'enivrent de l'illusion de la France éternelle, fille aînée de l'Eglise pour les uns, Patrie des droits de l'homme pour les autres. Il leur faut oublier que le mot de Pascal vaut aussi pour les peuples. « Le dernier acte est toujours sanglant ».
Sans sombrer, comme lui, dans le pessimisme, il faut bien reconnaître que la proportion des Français de plus de soixante-cinq ans est passée de 4,4 % à 14 % entre 1780 et 1979. Le progrès de la médecine n'y est pour rien. Si l'on prend la période où il se développa le plus rapidement — 1854 à 1964 — le nombre des Français de plus de soixante-cinq ans a augmenté de trois millions et celui des moins de quinze ans d'un demi-million. Pourtant la baisse de la mortalité infantile fut spectaculaire. Sans le déclin du taux de fécondité, l'allongement de la vie humaine demeurant ce qu'il fut, le pourcentage des Français de plus de soixante-cinq ans, bien loin d'augmenter, aurait dû tomber de 4,4 % à 3,8 %. La France serait plus jeune aujourd'hui qu'elle l'était à la veille de la Révolution. Il y aurait autant de vieillards et beaucoup plus d'enfants. Une telle évolution, prolongée pendant deux siècles, en dépit d'une rémission d'une vingtaine d'années ne peut que scléroser, à la longue, le corps social, l'atteindre dans son élan vital.
Il est certain que l'opinion se nourrit de fables. On lui raconte, sans que personne n'ose démentir, que l'immigration est nécessaire au progrès économique. Ce sophisme repose sur une apparence de vérité. Les Français ont toujours répugné à certaines tâches, pénibles et mal payées. Ils les ont volontiers abandonnées à des immigrés. Ces tâches se révélaient indispensables, il y a encore quelques décennies. Des manœuvres et des manutentionnaires étaient nécessaires. On les a fait venir de l'étranger. Il se trouve que le pays le plus avancé industriellement, le Japon, est celui qui compte le moins d'immigrés, des Coréens traditionnellement voués à des tâches jugées indignes d'un véritable Japonais. Là où nous avons utilisé des Africains ou des Maghrébins, attirés par des promesses fallacieuses et parfois, amenés de force par des négriers, le patronat nippon a robotisé, automatisé, rationalisé. L'immigration fut certainement une source de profits pour quelques capitalistes français. Elle fut une cause de sous-développement industriel, non de progrès économique. Elle le sera de plus en plus, puisqu'elle contribue, pour des raisons que l'on peut comprendre, à ralentir les nécessaires restructurations. Quel avenir proposer à des dizaines de milliers de travailleurs africains ou maghrébins, qui n'ont plus de place sur le marché du travail ? Il convient d'avoir le courage de reconnaître que le recours séculaire à l'immigration nous a conduits à adopter la solution de facilité, comme c'en fut une autre que de ne pas transférer progressivement nos chantiers navals à Casablanca, à Dakar ou à Abidjan, en procédant chez nous aux indispensables reconversions qu'aujourd'hui nous devons improviser. • A suivre (A venir : La démocratie ou la vie 2 et fin).
Lire les articles précédents ...
Une politique pour l'an 2000 de Pierre Debray
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
-
Au cœur de l'Histoire : Le Paris de la Révolution (Récit intégral)
-
Georges Valois contre l’argent: rencontre avec Olivier Dard
par Frédéric Saenen
Ex: http://salonlitteraire.linternaute.com
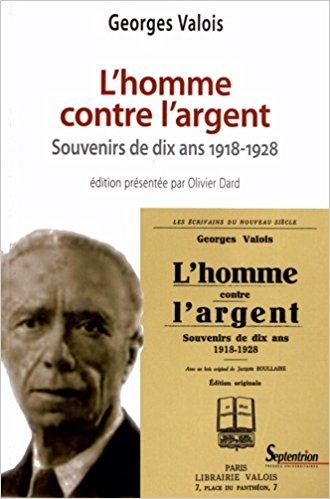 Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».
Lorsqu’il s’agit d’aborder le cas Georges Valois (1878-1945), c’est peut-être le terme de « rupture » qui s’impose en premier lieu à l’esprit. En effet, ce singulier personnage aura successivement adhéré aux idéologies marquantes de l’âge des extrêmes, de l’anarchisme à l’Action française (dont il sera un des premiers dissidents), d’un fascisme à la française clairement revendiqué au syndicalisme, jusqu’à enfin une doctrine économique trop peu étudiée encore, « l’abondancisme ».De tels louvoiements passeront aux yeux de beaucoup pour une suspecte inconstance – et Valois se verra d’ailleurs taxé d’être en matière de politique un véritable caméléon. Mais il serait hâtif de résumer l’homme à cette tendance, tout autant que de l’enfermer dans son identité de fondateur du Faisceau. Ce mouvement, créé le 11 novembre 1925, mêlait en somme, et de façon quelque peu utopique, idéologie technocratique, planisme strict, exaltation de la figure du travailleur et valorisation des corporations. Le Faisceau implosera, après deux ans d’existence, sous la pression des divergences idéologiques qui le tiraillaient.
La réflexion et l’engagement de Valois ne s’arrêtèrent cependant pas là : son nom sera aussi cité parmi ceux des non-conformistes des années 30 et il mourra, suite à son arrestation par la Gestapo, au camp de Bergen-Belsen. Étrange fin pour un homme que les esprits simplistes seraient tentés de réduire à un Mussolini à la française !
Olivier Dard, dont on connaît les excellents travaux sur les droites radicales et nationales en France (de Maurras à l’OAS) mais aussi l’intérêt pour les relations entre politique et économie, ne pouvait rester indifférent à un homme tel que Valois. Après avoir dirigé le volume Georges Valois, itinéraire et réceptions paru chez Peter Lang en 2011, voici qu’il préface la réédition de L’homme contre l’argent. Un volume de souvenirs couvrant la décennie qui mène exactement de la fin de la Première Guerre mondiale à la faillite du Faisceau.
Le livre, « virulent et écrit à chaud » selon les termes mêmes d’Olivier Dard, constitue un témoignage de première main sur une période de l’histoire souvent négligée au bénéfice des années 30, identifiées comme celles de tous les périls, de toutes les crises, de toutes les passions. Pourtant, quel bouillonnement déjà dans cette France qui sort à peine des tranchées, de la boue et du sang. L’heure est à la reconstruction et à la recherche de nouveaux modèles de société. Les uns ne jurent que par le monde anglo-saxon, les autres penchent plutôt du côté des Soviets. Valois revendique quant à lui l’ouverture d’une troisième voie dès l’incipit : « Ni Londres, ni Moscou. »
Ce texte n’est donc pas uniquement une autobiographie, bien que la mémoire de Valois et ses jugements en soient l’axe central. Il ne se cantonne pas non plus à la recension des faits objectifs et à leur scrupuleuse chronique. Mais s’il n’a pas le caractère offensant du pamphlet, il mérite bel et bien l’étiquette bernanosienne d’« écrit de combat ». Olivier Dard insiste sur le fait que « c’est bien comme une charge contre la “ploutocratie” qu’il faut lire L’homme contre l’argent » et poursuit sur ce constat : « Le capitalisme, dans sa dimension industrielle comme financière, sa compréhension et la lutte à entreprendre contre lui sont des préoccupations constantes chez Valois ».
Est-ce à dire qu’il y aurait encore une actualité possible pour un penseur qui paraît aujourd’hui tellement oublié et daté ? Nous avons demandé à l’historien de nous éclairer sur quelques aspects de cette publication, riche en anecdotes et en portraits, mais aussi sur la personnalité complexe de Valois et la place qu’il lui revient d’occuper parmi les figures de la pensée française du XXe siècle. Mieux vaut tard…
Frédéric Saenen

Entretien avec Olivier Dard,
professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lorraine (plateforme de Metz), spécialiste d'histoire politique du vingtième siècle, en particulier des droites radicales et des relations entre politique et économie.
— Georges Valois ne fut pas strictement un économiste ni un homme politique. Alors comment le qualifieriez-vous ? « Penseur » ? « Intellectuel » ? « Homme engagé » ?
Olivier Dard : Homme engagé certainement. Les termes de « penseur » ou d’ « intellectuel » ne sont peut-être pas les mieux adaptés pour Valois même s’il aspire à être considéré comme un doctrinaire et multiplie les prises de position à fois sur des questions générales et sur les sujets qui lui tiennent le plus à cœur et qui sont d’ordre économique et social. Il faut s’attacher aux titres des ouvrages de Valois où deux mots ressortent particulièrement, « L’homme » et « nouveau/nouvelle » : L’homme qui vient, L’homme contre l’argent, Economie nouvelle, Un nouvel âge de l’humanité… Autant de mots forts qui ne sont pas seulement les titres accrocheurs d’un éditeur chevronné et d’un professionnel du livre qu’est Valois. Ils renvoient à ses questionnements les plus profonds et les plus constants.
— Parmi les engagements successifs de Valois (anarchisme, maurrassisme, syndicalisme, fascisme, non-conformisme, abondancisme, résistance, etc.), lequel vous semble-t-il avoir mené avec le plus, non pas d’intégrité, mais de cohérence intellectuelle ? Et y a-t-il, chez cet homme de toutes les ruptures, des idées ou des valeurs permanentes, intangibles, qu’il maintiendra tout au long de son existence ?
Je pense que la lutte contre l’argent est sans doute un marqueur essentiel du parcours de Valois. L’anticapitalisme est une constante de Valois mais son contenu a évolué avec le temps. A l’époque de l’AF, il faut le comprendre non comme un refus du principe de la propriété privée et une défense de la collectivisation des moyens de production comme le prône le socialisme, mais comme un rejet de la finance, la promotion pendant d’une « économie nouvelle » arrimée au corporatisme. Lorsque Valois passe à « gauche », l’accent est mis sur une République syndicale associée à « Etat technique » qui est le signe d’un nouvel âge. Le Valois de l’Economie nouvelle n’est pas aussi éloigné de celui du « nouvel âge » qu’il peut y paraître si on se polarise sur sa rupture avec l’AF. Dans le sillage du premier conflit mondial et de la promotion d’un « esprit des années vingt », Valois est pénétré de l’importance de la technique et de ses potentialités, tout comme du rôle nouveau à conférer à ceux qui sont alors dénommés les « techniciens » et qui annoncent les technocrates.
— Dans le chapitre Mon premier complot, Valois évoque son voyage dans l’Italie fasciste et dresse un portrait de Mussolini, qu’il rencontrera d’ailleurs en audience. Que pensez-vous du regard que Valois porte sur le Duce, dans ces pages comme à d’autres moments de son œuvre ?
La référence au Duce proposée dans L’Homme contre l’argent n’est pas isolée dans l’ensemble de l’œuvre de Georges Valois. Par la suite, il publie comme éditeur (librairie Valois) des antifascistes italiens et lui-même écrit sur l’Italie fasciste pour dénoncer son régime et son chef… comprenant rapidement la caractère infâmant du label fasciste dont il affuble Poincaré dans son essai Finances italiennes (1930). La présentation de Mussolini dans L’Homme contre l’argent est un texte fort intéressant. D’abord, parce qu’il peut se lire comme un témoignage important sur le dirigeant italien au milieu des années vingt et qui peut être comparé à d’autres, Français ou étrangers. Mussolini, comme l’a montré Didier Musiedlak dans son ouvrage sur Mussolini (Presses de Sciences Po, 2005 ) mettait un soin particulier à recevoir ses visiteurs et Valois, sans forcément le mesurer, se trouve intégré à un cérémonial d’audience bien rodé . Le récit de Valois est aussi instructif pour saisir par quels biais il a pu être reçu : Mussolini connaît ses écrits mais Valois a aussi été introduit dans le bureau par Malaparte (photo) qui se rattache alors aux « fascistes de gauche ». Un dernier point renvoie à la façon dont Valois appréhende Mussolini comme chef politique. Il est « conquis » par sa personnalité et rapproche à cet égard Mussolini de Lénine. Sur ce dernier point, l’empreinte de Georges Sorel est sans doute importante.
— Lorsqu’on lit le chapitre consacré à la rupture avec l’AF, on entrevoit qu’il s’agit moins d’une dissension à propos des idées que d’histoires de gros sous et de concurrence d’organes de presse (L’Action française contre le Nouveau Siècle) qui motivent le départ de Valois. Aux yeux de l’historien, ce récit est-il sincère et complet ?
Dans le récit qu’il propose de sa rupture avec l’AF, le propos de Valois est logiquement partiel et partial. La dimension économique de la rupture est cependant importante car le divorce de Valois avec l’AF met en jeu l’avenir de la Nouvelle Librairie nationale et, du point de vue des organes de presse mentionnés, l’attraction d’un lectorat qui est acheteur et donc contributeur au financement des deux périodiques. La rupture débouche sur une polémique âpre et un long procès opposant Valois et l’AF, et présenté par Valois dans un gros ouvrage intitulé Basile ou la politique de la calomnie. L’argent et la rancœur, s’ils sont les éléments les plus visibles de ce divorce, ne sont pas les seuls à devoir être pris en compte. Il faut aussi compter avec l’importance des clivages idéologiques qui distendent progressivement la relation de Valois à l’AF, notamment quant à l’adéquation du programme de cette dernière avec ses projets et ses initiatives au début des années vingt : le « nationalisme intégral » laisse la place chez Valois à la recherche d’un fascisme à la française. Valois est alors déçu et désabusé quant aux perspectives de l’AF au lendemain des résultats électoraux calamiteux de 1924. Il y a entre le fondateur du Faisceau et l’AF un divorce qui renvoie à la stratégie et aux modalités de l’action politique à entreprendre.
— Quelle anecdote, scène ou rencontre évoquée dans L’homme contre l’argentvous semble résumer le mieux le tempérament de Valois ?
La question est délicate mais le récit de sa rupture avec l’AF (chapitre V) est un passage tout à fait caractéristique d’un personnage dominé par son égocentrisme et dont la psychologie traduit une obsession des machinations et des complots. Sans revenir sur le fond de l’affaire ni commenter les épisodes racontés par Valois ou les portraits fielleux qu’il dresse de chacun des protagonistes (qui le lui rendent bien dans d’autres textes), on pourra rapprocher son comportement d’alors de celui qui s’observe une dizaine d’années plus tard à l’occasion des crises qui frappent le mouvement Nouvel Age. Au printemps 1938, l’affaire Anne Darbois (militante et collaboratrice du journal) est sur ce point instructive. Valois, comme à l’époque de sa rupture avec l’AF, insiste sur les renseignements qu’il aurait obtenus et les machinations qu’il aurait mises au jour, construit des discours de justification et attaque la personnalité de sa contradictrice… L’affaire s’achève par la publication de l’ensemble sous forme de dossiers, dans le journal et non en volume comme pour Basile ou la politique de la calomnie.
— En somme, pourquoi lire encore Valois aujourd’hui, et en particulier L’Homme contre l’argent ?
On peut lire Valois en fonction de différentes logiques. Le lecteur intéressé par l’histoire de la France des années vingt (et pas seulement par celle de l’AF et du Faisceau) découvrira à travers Valois une source importante pour appréhender cette période et son évolution. La lecture de Valois est aussi instructive dans une perspective très actuelle, où l’heure est aussi à la dénonciation de l’argent. Les analyses de Valois sur « la révolution planétaire » (qu’il n’appelle pas mondialisation), son organisation, ou ses développements sur les relations à établir entre les Etats et ce qu’il nomme les trusts ont une résonnance particulière avec les enjeux de cette seconde décennie du XXIe siècle.
Propos recueillis par Frédéric Saenen (octobre 2012)
Georges Valois, L’homme contre l’argent. Souvenirs de dix ans 1918-1928, édition présentée par Olivier Dard, Septentrion, septembre 2012, 375 pages, 30 €
-
Charles Maurras : tout le monde en parle, personne ne le lit. N’est-ce pas, Claude Askolovitch ?
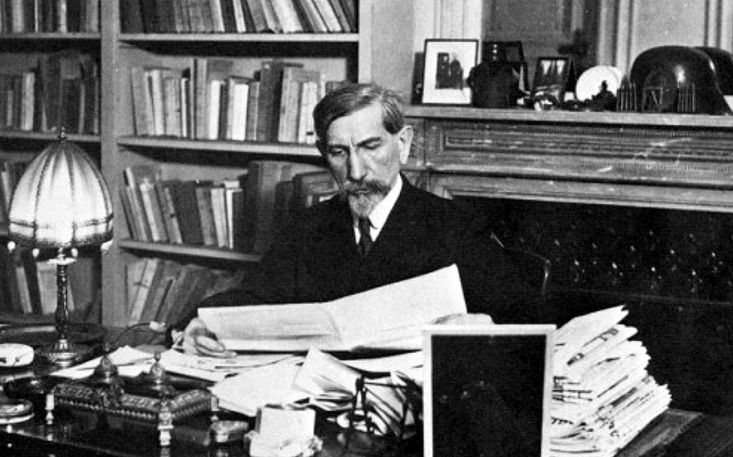
Par Stéphane Blanchonnet
 Une excellente tribune parue dans Boulevard Voltaire (15.03) LFAR
Une excellente tribune parue dans Boulevard Voltaire (15.03) LFARLes récents articles d’Askolovitch dans Le Nouveau Magazine littéraire et Le Point sont emblématiques de la réception de Maurras depuis une trentaine d’années : tout le monde en parle, personne ne le lit (en dehors d’un nombre tout de même important de jeunes militants politiques et, bien sûr, du public vraiment cultivé) et il est le plus souvent réduit à quelques polémiques ad hominem et à un antisémitisme pourtant tout à fait accessoire pour comprendre sa pensée. J’ai moi-même écrit un petit livre de synthèse sur son vocabulaire politique (Petit dictionnaire maurrassien, Éditions Nouvelle Marge, 2017) sans qu’il me paraisse nécessaire de consacrer plus d’une seule page sur 98 à cette question.
Le Président Macron a, quant à lui, fait tout récemment référence, regrettant le retrait de Maurras du Livre des commémorations 2018, à l’influence du maître de l’Action française sur certains de ses prédécesseurs. Prenons ce fait comme exemple d’une réception intelligente, à l’opposé de celle d’Askolovitch : incontestablement, la dimension monarchique donnée par le général de Gaulle à la Constitution de 1958 doit beaucoup à la critique maurrassienne, qu’il connaissait et partageait, des faiblesses de la IIIe République ; Georges Pompidou, quant à lui, n’avait pas hésité à donner Kiel et Tanger (du même Maurras) comme modèle d’analyse géopolitique aux étudiants de Sciences Po ; enfin, Mitterrand, qui expliquait à Pierre Péan, à la fin de sa vie, combien il avait été marqué par sa lecture de Maurras, s’est certainement souvenu de ce précurseur de l’idée de décentralisation en France au moment de mettre en œuvre ses propres réformes dans ce domaine.
L’essentiel de la pensée de Maurras ne se trouve pas dans les « quatre États confédérés », comme veut le faire croire par ignorance ou par haine Askolovitch, mais bien dans des formules comme « l’autorité en haut, les libertés en bas », « pays réel, pays légal » ou « Politique d’abord ! », ou encore dans sa réfutation magistrale du contractualisme de Rousseau. Les lecteurs et les chercheurs de bonne foi pourront le vérifier (enfin !) le mois prochain lors de la réédition d’une partie de ses œuvres dans la très populaire collection « Bouquins ».
-
Le Puy du Fou entre en résistance, par Caroline Parmentier

 Pour une fois que quelque chose marche en France, il est urgent de le couler. Surtout quand il s’agit d’un chef-d’œuvre du roman national qui déclare passionnément son amour à la Vendée et à la France.
Pour une fois que quelque chose marche en France, il est urgent de le couler. Surtout quand il s’agit d’un chef-d’œuvre du roman national qui déclare passionnément son amour à la Vendée et à la France.Un récent arrêté du ministère de la Culture de Françoise Nyssen limite et encadre strictement la participation des bénévoles dans le spectacle vivant. Pour Philippe de Villiers qui emploie 4 000 bénévoles, « c’est la mort programmée du Puy du Fou ».
C’est vrai qu’empêcher les bénévoles de faire ce qu’ils aiment était vraiment dans le top 5 des problèmes urgents à régler en France. Avec la limitation à 80 km/h. Ils sont des centaines de milliers d’amateurs passionnés qui font tourner toute l’année des chorales, des festivals, des pièces de théâtre et des spectacles historiques. Leur activité est directement menacée.
« Sous la pression de la CGT Spectacle », explique Philippe de Villiers, il faudra désormais que le spectacle rentre dans les clous d’une convention et commence par « détailler son identité et sa nature » : « Je crains le pire », précise-t-il. Parmi les nouvelles règles, il faudra des autorisations annuelles, un registre, un pointage central. « Pour le pointage des participants, le Puy du Fou c’est 4 000 membres actifs, nous ne pouvons pas appliquer cet arrêté. »
Concrètement, « certaines conditions sont aberrantes. Par exemple, le nombre d’heures consacrées au temps [de formation des amateurs] devra être supérieur, pour les 4 000 participants, au temps de répétitions », cite encore Villiers qui parle de « démarche liberticide ».De même, les amateurs ne pourront pas participer à plus de huit spectacles dans l’année alors que le Puy du Fou en organise 28.
« C’est le principe même de cette idéologie mortifère qu’il faut dénoncer », déclare-t-il à Boulevard Voltaire. « C’est le principe de la gratuité dans la société qui est menacé. Une société sans gratuité est une société qui meurt de froid. Ces gens-là sont des dinosaures du soviétisme ! » Est-ce qu’il met dans « ces gens-là » le fringant Macron du Puy du Fou, grimpé sur un char, déclarant qu’il n’était pas socialiste et sur lequel il n’avait pas tari d’éloges ?
Couvert de récompenses, le parc vendéen a été sacré deux fois « meilleur parc du monde », il a reçu également à deux reprises le titre de « meilleure création mondiale » pour ses spectacles « Les Amoureux de Verdun » et « Le Dernier Panache ». Philippe de Villiers est aussi le tout premier Français à avoir reçu en 2017 pour cette création, un « Hall of Fame Award ».
Le spectacle du Puy du Fou, qui vient de fêter ses 40 ans, triomphe dans le monde comme un modèle économique, marketing et sociologique sans équivalent de l’excellence française, avec deux millions de spectateurs par an, des projets pour les trente prochaines années, des parcs qui ouvrent en Angleterre, en Russie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Espagne et bientôt en Chine. Dans un esprit totalement à contre-courant des mensonges historiques et politiques officiels. Sans jamais s’être renié ni y avoir laissé son âme. Forcément, ça agace.
Caroline Parmentier
Article paru dans Présent daté du 16 mars 2018
https://fr.novopress.info/210003/le-puy-du-fou-entre-en-resistance-par-caroline-parmentier/
-
Flaubert et notre abrutissement climatique
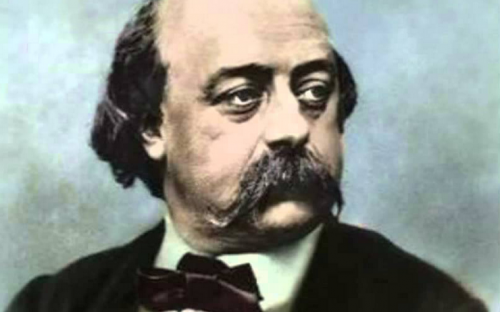
par Nicolas Bonnal
Je ne les ouvre jamais mais depuis deux semaines les journaux en Espagne parlent très intelligemment de trois choses : la tyrannie de Poutine, qui n’en finira jamais (pauvre occident, que va-t-il faire, heureusement la bombe, heureusement l’OTAN, etc.) ; le changement climatique (il y a du vent et de la pluie, on est en mars…) et la grève féministe, qui permet de combattre enfin le nazisme masculin – on demande des budgets au gouvernement néocon local en ce sens.
Dans toutes ces histoires il ne s’agit que de racket.
On a évoqué le féminisme avec Nietzsche. On le relit :
« Il y a aujourd’hui, presque partout en Europe, une sensibilité et une irritabilité maladives pour la douleur et aussi une intempérance fâcheuse à se plaindre, une efféminisation qui voudrait se parer de religion et de fatras philosophique, pour se donner plus d’éclat — il y a un véritable culte de la douleur. »
Cette irritabilité se reflète-t-elle dans notre obsession pour les conditions météo ?
Sur le changement climatique je me demandais depuis combien de temps on s’abrutit ainsi ; car aucun classique ne nous emmerdait avec. Tout apparaît semble-t-il au milieu du dix-neuvième siècle : la guerre de Crimée crée la science météorologique, et Baudelaire se plaint de son ciel bas et lourd qui baisse comme un couvercle…
On connaît mon goût pour la cuisinière (une femme géniale, qui ne connaît ni Louis-Philippe, ni république, ni Badinguet) et la correspondance de Flaubert. Je recommande le début des années 1850, qui est prodigieux (voyez ses lettres à Victor Hugo). Sur une petite tempête météo voici ce qu’il écrit notre analyse littéraire de la femme moderne :
12 juillet 1853 – Tu auras appris par les journaux, sans doute, la soignée grêle qui est tombée sur Rouen et alentours samedi dernier.
Désastre général, récoltes manquées, tous les carreaux des bourgeois cassés ; il y en a ici pour une centaine de francs au moins, et les vitriers de Rouen ont de suite profité de l’occasion (on se les arrache, les vitriers) pour hausser leur marchandise de 30 p 100. Ô humanité ! C’était très drôle comme ça tombait, et ce qu’il y a eu de lamentations et de gueulades était fort aussi. Ç’a été une symphonie de jérémiades, pendant deux jours, à rendre sec comme un caillou le cœur le plus sensible ! On a cru à Rouen à la fin du monde (textuel). Il y a eu des scènes d’un grotesque démesuré, et l’autorité mêlée là-dedans !
M le préfet, etc. »
Oui, l’administration française avec ses préfets et notre inféodation a certainement joué dans cette formation du caractère geignard et assisté – plus de lois et de taxes, et d’amendes et de menaces, pour le féminisme et la lutte contre le racisme et pour le socialisme, et tout le reste…
Flaubert poursuit, coquin, comme James Kunstler ou Dimitri Orlov aujourd’hui :
« Ce n’est pas sans un certain plaisir que j’ai contemplé mes espaliers détruits, toutes mes fleurs hachées en morceaux, le potager sens dessus dessous.
En contemplant tous ces petits arrangements factices de l’homme que cinq minutes de la nature ont suffi pour bousculer, j’admirais le vrai ordre se rétablissant dans le faux ordre. Ces choses tourmentées par nous, arbres taillés, fleurs qui poussent où elles ne veulent (pas), légumes d’autres pays, ont eu dans cette rebuffade atmosphérique une sorte de revanche… »
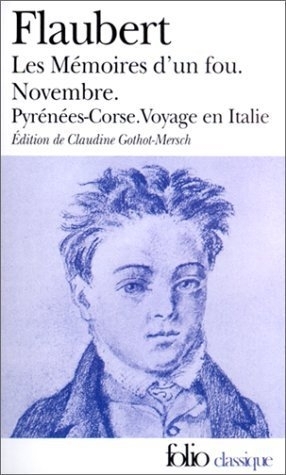 Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :
Et il est content (Philippe Muray était euphorique au moment de la tempête du siècle en l’an 2000) :« Ah ! ah ! cette nature sur le dos de laquelle on monte et qu’on exploite si impitoyablement, qu’on enlaidit avec tant d’aplomb, que l’on méprise par de si beaux discours, à quelles fantaisies peu utilitaires elle s’abandonne quand la tentation lui en prend ! Cela est bon. On croit un peu trop généralement que le soleil n’a d’autre but ici−bas que de faire pousser les choux.
Il faut replacer de temps à autres le bon Dieu sur son piédestal. Aussi se charge−t−il de nous le rappeler en nous envoyant par−ci par−là quelque peste, choléra, bouleversement inattendu et autres manifestations de la Règle, à savoir le Mal − contingent qui n’est peut−être pas le Bien − nécessaire, mais qui est l’être enfin : chose que les – hommes voués au néant comprennent peu. »
Et Flaubert un peu plus loin souligne ce qui accompagne cette jérémiade climatique, savoir le règne des machines et la montée de notre stupidité :
14 août 1853 – « La cloche du paquebot du Havre sonne avec tant d’acharnement que je m’interromps. Quel boucan l’industrie cause dans le monde ! Comme la machine est une chose tapageuse ! à propos de l’industrie, as-tu réfléchi quelquefois à la quantité de professions bêtes qu’elle engendre et à la masse de stupidité qui, à la longue, doit en provenir ? Ce serait une effrayante statistique à faire ! »
Flaubert est un génie et prévoit donc les effets du taylorisme soixante-dix avant Charlot (un autre génie) :
« Qu’attendre d’une population comme celle de Manchester, qui passe sa vie à faire des épingles ? Et la confection d’une épingle exige cinq à six spécialités différentes ! Le travail se subdivisant, il se fait donc, à côté des machines, quantité d’hommes−machines. Quelle fonction que celle de placeur à un chemin de fer ! de metteur en bande dans une imprimerie ! etc., etc. Oui, l’humanité tourne au bête. Leconte a raison ; il nous a formulé cela d’une façon que je n’oublierai jamais. Les rêveurs du moyen âge étaient d’autres hommes que les actifs des temps modernes. »
Ici ce serait du Guénon, du Chesterton, du Bernanos : « Les rêveurs du moyen âge étaient d’autres hommes que les actifs des temps modernes. »
On comprend que pour fuir cette connerie il se soit voué au culte de l’art, quand il était encore possible (car comment faire connaître un Flaubert aujourd’hui s’il en existait un ???) :
« L’humanité nous hait, nous ne la servons pas et nous la haïssons, car elle nous blesse. Aimons-nous donc en l’art, comme les mystiques s’aiment en Dieu, et que tout pâlisse devant cet amour ! »
Enfin Flaubert avait compris que notre fin de l’histoire, comme je le dis toujours, durerait des siècles :
Je comprends depuis un an cette vieille croyance en la fin du monde que l’on avait au moyen âge, lors des époques sombres. Où se tourner pour trouver quelque chose de propre ? De quelque côté qu’on pose les pieds on marche sur la merde. Nous allons encore descendre longtemps dans cette latrine. »
Car qui pensait qu’après Hollande détesté, la multitude élirait son ministre de l’économie ?
Tout cela donne raison à sa cuisinière décidément :
« J’ai eu aujourd’hui un grand enseignement donné par ma cuisinière. Cette fille, qui a vingt-cinq ans et est Française, ne savait pas que Louis-Philippe n’était plus roi de France, qu’il y avait eu une république, etc. Tout cela ne l’intéresse pas (textuel). Et je me regarde comme un homme intelligent ! Mais je ne suis qu’un triple imbécile. C’est comme cette femme qu’il faut être. »
Sauf qu’aujourd’hui la brave fille serait abrutie par son smartphone et sa télé…
Sources
Nicolas Bonnal – Chroniques sur la fin de l’histoire
Flaubert – Correspondance, 1850-1854 (ebookslib.com)
Nietzsche – Par-delà le bien et le mal
-
Les conversations : Jean-Marie Le Pen, le député para (Un destin français, 2ème partie)
-
Complot contre les Brigandes (Mars 2018)
-
La Superclasse mondiale contre les peuples
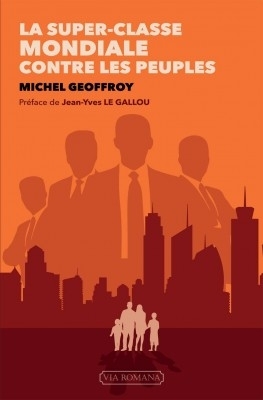 En Occident on ne vit plus en démocratie mais en post-démocratie : les gouvernements ne gouvernent plus mais obéissent aux marchés et aux banques, les puissances d’argent dirigent les médias et les peuples perdent leur souveraineté et leurs libertés.
En Occident on ne vit plus en démocratie mais en post-démocratie : les gouvernements ne gouvernent plus mais obéissent aux marchés et aux banques, les puissances d’argent dirigent les médias et les peuples perdent leur souveraineté et leurs libertés.Pourquoi ? Parce que depuis la chute de l’URSS le pouvoir économique et financier s’affranchit du cadre national et veut gouverner à la place des États. Parce que la fin du communisme nous a libérés de la Guerre froide, et lui a succédé la prétention obstinée du messianisme anglo-saxon à imposer partout sa conception du monde, y compris par la force.
Ce double mouvement s’incarne dans une nouvelle classe qui règne partout en Occident à la place des gouvernements : la super classe mondiale.
Une classe dont l’épicentre se trouve aux États-Unis mais qui se ramifie dans tous les pays occidentaux et notamment en Europe. Une classe qui défend les intérêts des super riches et des grandes firmes mondialisées, sous couvert de son idéologie : le libéralisme libertaire et cosmopolite. Une classe qui veut aussi imposer son projet : la mise en place d’un utopique gouvernement mondial, c’est-à-dire la mise en servitude de toute l’humanité et la marchandisation du monde. Une classe qui manipule les autres pour parvenir à ses fins, sans s’exposer elle-même directement.
Avec La Superclasse mondiale contre les peuples, Michel Geoffroy dresse un portrait détaillé, argumenté et sans concession de la superclasse mondiale autour de cinq questions : que recouvre l’expression superclasse mondiale ? Que veut-elle ? Comment agit-elle ? Va-t-elle échouer dans son projet de domination ? Quelle alternative lui opposer ?
Un ouvrage de référence pour comprendre les enjeux de notre temps.
La super-classe mondiale contre les peuples, Michel Geoffroy, préface de Jean-Yves Le Gallou, Via Romana, 2018, 470 pages, 24 €
Michel Geoffroy est énarque, essayiste, contributeur régulier à la Fondation Polémia ; il a publié en collaboration avec Jean-Yves Le Gallou différentes éditions du Dictionnaire de Novlangue, dont la dernière aux éditions Via Romana en 2015.
Le commander à l'éditeur cliquez ici