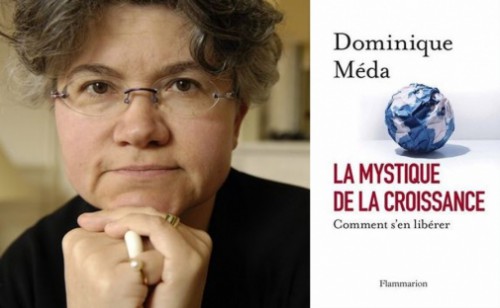A cause des contraintes européennes, les marges de manœuvre de François Hollande et du gouvernement étaient limitées. Mais les mesures engagées ne vont pas dans le bon sens.
Le gouvernement français a donc finalement renoncé à demander à Bruxelles un délai supplémentaire pour ramener le déficit public sous la barre des 3 %. Ce qui l’amène à prévoir pour l’an prochain des mesures douloureuses socialement et politiquement difficiles à défendre comme la poursuite du gel du point d’indice des fonctionnaires, le blocage des retraites et des prestations sociales ou encore le report de la revalorisation du RSA prévue dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté. Entre la pression exercée sur la compétitivité française par la course au moins-disant social engagée chez nos voisins et le carcan budgétaire imposé par le traité sur la stabilité, la coordiantion et la gouvernance (TSCG) dans la zone euro, la France se trouve prise dans un double piège : elle est obligée de rentrer dans une spirale déflationniste dont elle ne peut guère tirer de bénéfice.
Le piège de la course au moins-disant social
Depuis 2010, la France était un des pays de la zone euro qui avait le moins souffert de la crise parce que sa demande intérieure s’était maintenue. Fort heureusement, car cela a contribué de façon déterminante à éviter que la zone euro ne s’effondre. Il en était ainsi parce que le pays n’avait pas subi jusqu’ici de déflation salariale ni de baisse des dépenses publiques. Ce n’était pas le cas en revanche de la plupart de nos voisins en dehors de l’Allemagne, et notamment des pays les plus en crise : ils ont baissé rapidement leurs coûts salariaux et donc restreint fortement leur demande intérieure. Résultat : alors que l’Espagne par exemple était avant la crise un des pays vis-à-vis duquel la France dégageait le plus d’excédents extérieurs avec un surplus de 6,3 milliards d’euros en 2007, l’Hexagone a enregistré un déficit de 1,9 milliard de mars 2013 à février 2014. Ce mouvement a donc nettement dégradé les comptes extérieurs du pays car, contrairement à l’industrie allemande, l’industrie française exporte peu hors de l’Europe. De plus, la course au moins-disant social engagée chez nos voisins a exercé une forte pression à la baisse sur les prix industriels, d’où une diminution des marges des entreprises françaises. C’est ce double constat qui avait conduit aux 20 milliards d’euros de baisse du coût du travail décidés en 2012 avec le crédit d'impôt compétitivité-emploi (Cice), devenus 30 milliards avec le pacte de responsabilité.
L’impossible équation budgétaire
Mais parallèlement François Hollande s’était aussi engagé dans sa campagne présidentielle à ramener les déficits français sous la barre des 3 % dès 2013. Pour ce faire, il avait procédé l’an dernier à un tour de vis budgétaire sans précédent de 30 milliards d’euros (20 milliards d’euros de hausse d’impôts, 10 milliards de baisse des dépenses). Comme c’était prévisible, ce tour de vis a tellement cassé l’activité qu’il n’a finalement pas eu du tout les résultats escomptés en termes de réduction des déficits : ceux-ci ne sont revenus qu’à 4,3 % du PIB. Entre-temps la Commission européenne avait cependant accepté de repousser à 2015 l’échéance à laquelle la France devait ramener ses déficits à 3 %. Mais aujourd’hui, l’échec du tour de vis de 2013 combiné à la montée en puissance rapide du Cice et du pacte de responsabilité, rend de nouveau l’équation budgétaire pour 2015 très délicate. D’où la tentation de demander un nouveau délai. Mais, la France se trouve dans une position difficile : la parole de son président est dévaluée après l’échec de la réduction des déficits en 2013, les textes juridiques laissent peu de marges d’appréciation à la Commission européenne et surtout, au-delà même du gouvernement allemand toujours aussi à cheval sur ces questions, la France n’a aucun allié dans cette affaire. Les autres gouvernements qui ont quasiment tous pris des mesures très impopulaires ces dernières années, ne sont pas prêts en effet à appuyer une demande d’exception française. Même le gouvernement de Matteo Renzi en Italie, qui se trouve dans une situation similaire et aurait pu s’allier avec François Hollande, a indiqué qu’il respecterait les engagements de l’Italie. Il ne restait donc plus d’autre choix que de s’incliner ou de déclencher une crise européenne majeure tout en étant très isolé.
Une spirale déflationniste
Le problème c’est que la forte austérité budgétaire désormais programmée pour 2015, va de nouveau ralentir sensiblement l’activité. Cela d’autant plus que les mesures annoncées touchent cette fois principalement les couches populaires et moyennes, contrairement aux hausses d’impôts de 2013. Cela va également limiter les effets positifs attendus du pacte de responsabilité : en l’absence de demande, les entreprises n’ont guère de raison d’investir et d’embaucher même si leurs marges s’accroissent. Tandis que les frustrations engendrées par ces mesures, notamment au sein de la fonction publique, risquent fort de bloquer les indispensables réformes de structure qu’il faudrait mener à bien dans l’appareil d’Etat et l’action publique. Bref les marges de manœuvre étaient incontestablement limitées, mais les mesures engagées ont plus de chances de plonger le pays dans une spirale déflationniste qui l’entraîne vers le fond que de hâter son redressement…
Alternatives économiques :: lien
http://www.voxnr.com/cc/dep_interieur/EupEFZZAZyVWcRXXcu.shtml