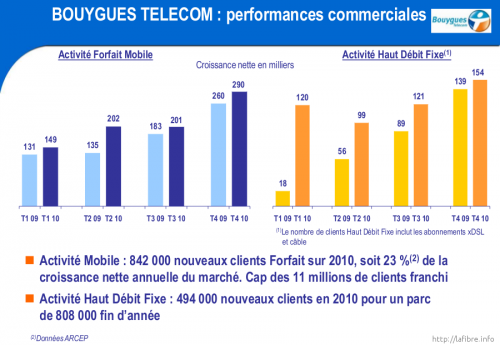Les gouvernements des vingt pays les plus riches l’avaient promis : le secteur financier sera réformé, les banques mises sous contrôle. Plus de finance folle, de sauvetage bancaire ruineux, de mise en péril de l’économie par la spéculation débridée. Cinq ans après les déclarations du G20, où en est-on ? L’Union européenne a voté une dizaine de directives, sous la houlette de Michel Barnier. Bonus des banquiers, organisation des plans de sauvetage, supervision et contrôle… Tour d’horizon de cette difficile reprise en main, avec Thierry Philipponnat, secrétaire général de l’ONG Finance Watch, rare contrepouvoir au puissant lobby bancaire européen.
L’union bancaire européenne a pour objectif d’éviter que de nouvelles faillites bancaires ne soient supportées par les contribuables. Son principe a été adopté par les eurodéputés le 15 avril. Est-ce une mesure satisfaisante ?
Thierry Philipponnat [1] : La réforme de l’Union bancaire a pour objectif que la prochaine crise bancaire ne coûte pas d’argent au contribuable – contrairement à la crise de 2008 qui coûté 450 milliards d’euros aux pays européens. Et de casser le lien incestueux et complètement absurde entre les banques et les États : les banques financent les États mais comptent sur eux pour les sauver quand elles ont un problème. Après un an et demi de négociations, nous avons avancé dans la bonne direction. L’Union bancaire permet une surveillance unique des 130 plus grandes banques par la Banque centrale européenne (BCE). Et la remise à plat du système de « résolution », c’est-à-dire l’intervention publique lorsqu’une banque a des problèmes, avant qu’elle ne fasse faillite.
Désormais, les pertes financières devront être absorbées par les actionnaires et les créanciers, avant que les déposants et contribuables ne soient mis à contribution. Cette nouvelle directive européenne [2] est un vrai progrès, elle met fin à « l’aléa moral », qui fait que les gagnants et les perdants n’étaient pas les mêmes : certains pouvaient gagner de l’argent mais pas en perdre !
Quelles sont les limites de cette directive européenne ?
Les pertes absorbées par les créanciers sont limitées à 8 % du bilan des banques. Ce chiffre est le fruit d’un compromis, très insatisfaisant : si une banque réalise une perte supérieure à 8 %, cela sera répercuté sur les contribuables. Ce pourcentage aurait suffit dans le passé, et suffira sans doute dans l’immense majorité des cas. Mais les actifs des banques en Europe représentent 45 000 milliards d’euros ! 8 % de 45 000 milliards, ce n’est pas rien (c’est l’équivalent du PIB de l’Allemagne, ndlr)… C’est donc un gros défaut de cette directive.
Second défaut, cette directive introduit une flexibilité : l’instance en charge de la résolution pourra autoriser des exceptions concernant ces 8 %, s’il y a mise en péril de la stabilité financière. Il faut bien sûr pouvoir être souple en cas de crise ou de sauvetage bancaire.
Mais si on commence par dire que dans certains cas particuliers, il est possible de ne pas appliquer la règle, dans le monde réel il y a de fortes chances pour qu’on ne l’applique pas du tout ! Un texte avec des conditions très strictes et incontournables aurait envoyé un signal clair à tous les acteurs, qui auraient adapté leur activité en conséquence. Tant qu’il y aura la possibilité que les États, donc les contribuables, soient appelés à la rescousse des banques, nous continuerons à alimenter ce système.
En cas de faillite d’une banque, qui est chargé de faire appliquer ces règles ?
Sheila Bair, qui a dirigé l’Autorité de résolution bancaire aux États-Unis pendant la crise, nous a fait cette recommandation : surtout ne laissez pas le système de résolution aux mains des politiques ! Les responsables politiques sont exposées à toutes les pressions, et vont quasi systématiquement vouloir sauver « leurs » banques nationales, même si cela coûte aux contribuables. Il faut à un moment que le processus soit technique, froid, implacable, avec des pilotes qui sauront s’adapter si besoin.
La loi qui vient d’être votée, même si elle a été améliorée ces derniers mois, ouvre pourtant la porte à une possible intervention des États, par le biais du Conseil européen, dans les cas extrêmes.
On comprend qu’il soit compliqué d’attendre que 28 États membres se mettent d’accord pour intervenir en cas de menace de faillite d’une banque, alors qu’il faut souvent réagir très vite. Mais l’intervention de responsables politiques n’est-elle pas une garantie « démocratique » ?
L’objectif est de casser le lien entre les banques et les États. Si vous dites aux banques que ce sont les États qui auront le dernier mot sur leur sauvetage ou leur non-sauvetage, vous renforcez ce lien. C’est par exemple une incitation pour les grandes banques à acheter la dette émise par leur propre pays, afin d’entretenir cette dépendance, ce cercle vertueux pour elles mais vicieux pour la société. Ce mécanisme, qu’on observe depuis quelques mois, est en train de croître. Avec pour conséquence, l’augmentation de la fragmentation des marchés : les banques espagnoles financent l’État espagnol, les banques italiennes financent l’État italien, etc. 1750 milliards d’euros de dettes des États sont détenus par les banques en Europe, et par chaque banque dans son propre pays. C’est le contraire d’une « union bancaire » européenne. Si le mécanisme de résolution était beaucoup plus mécanique, dans la main de gens qui n’entrent pas dans des considérations nationales, on casserait ce lien.
Le Parlement européen a également adopté l’an dernier le plafonnement des bonus, qui s’appliquera dès le 1er janvier 2015. La rémunération variable des banquiers ne pourra plus excéder le montant de leur rémunération fixe. C’est plutôt une bonne nouvelle ?
C’est un sujet très important, ne serait-ce que symboliquement. Mais nous n’avons pas été au cœur du problème : la question centrale n’est pas que les banquiers et traders gagnent beaucoup d’argent, mais que cela vienne d’une situation « d’aléa moral ». On pourrait la résumer ainsi : « Face, je gagne, pile, tu perds »… Les banquiers gagnent de l’argent à cause d’un système asymétrique, où les pertes sont socialisées (reposent sur tous), mais les profits sont privatisés (bénéficient seulement à quelques uns). C’est le problème essentiel. Et les banques sont déjà en train d’inventer des mécanismes pour contourner cette nouvelle règlementation sur les bonus. L’imagination des juristes spécialisés sur ces questions n’a pas de limites !
De nouvelles règles entrées en vigueur en 2013 imposent aussi aux banques de détenir un pourcentage minimum de fonds propres par rapport aux prêts qu’elles accordent et aux risques qu’elles prennent. Ces nouveaux « ratios de solvabilité », issus des accords internationaux de Bâle, sont-ils une garantie pour éviter de nouvelles faillites ?
Ces accords [3] prévoient le renforcement des fonds propres des banques. Chaque banque doit désormais détenir 7 % de fonds propres « durs », facilement mobilisables, dans son bilan (par exemple, pour pouvoir prêter 100 millions d’euros, une banque doit disposer de 7 millions d’euros en fonds propres, ndlr). Ce ratio de fonds propres est calculé sur la base d’une pondération du risque : plus un prêt est risqué, plus il impacte le ratio et donc « pèse » sur les banques. Sauf que ce calcul de pondération est tout sauf une science exacte ! Les petites banques ont une méthode de calcul standardisée, et les grandes banques ont le droit de définir leurs propres méthodes de calcul ! Les autorités bancaires européennes ont sorti un rapport disant en substance aux banques : « Il faudrait peut-être arrêter de se moquer de nous »… Dans les accords internationaux de Bâle, une autre méthode de calcul était proposée. Cette méthode beaucoup moins facile à contourner s’appelle « l’effet de levier » : elle consiste à rapporter les fonds propres d’une banque à la totalité de ses actifs, sans pondération. C’est un calcul facile et rapide à faire.
Mais suite à un lobbying effréné des banques qui ont expliqué que ce serait une catastrophe, les responsables européens ont choisi l’autre système de calcul…
Quelles en sont les conséquences ?
Cette question était traitée au Parlement en même temps que celle des bonus. Au moment où les députés européens ont approuvé le plafonnement des bonus des banquiers, ils lâchaient complètement sur l’effet levier, un sujet essentiel mais moins compréhensible pour le grand public. Nous avons raté l’occasion d’imposer un effet de levier strict, qui est la meilleure façon de discipliner les banques, et par répercussion de limiter les profits qui n’ont pas lieu d’être, et donc les rémunérations démesurées des banquiers. On a traité la conséquence, le bout de la chaîne, avec les bonus, mais pas la cause.
Cette question de « ratio de fonds propres » et de pondération, qui semble très technique, a pourtant des conséquences importantes sur l’économie réelle…
C’est une question centrale : si une entreprise obtient une meilleure note (par les agences de notation), cela impactera moins le taux de fonds propres de la banque qui lui prête de l’argent, grâce à ce fameux taux de pondération. Donc les banques ont tendance à prêter aux entreprises les mieux notées. Ce système nourrit les agences de notation. Et entretient ce phénomène pervers qui consiste à prêter de l’argent aux très grandes entreprises, qui ont une très bonne notation parce qu’elles sont solides, et de ne pas faire de crédits aux PME, peut-être moins bien notées mais qui sont essentielles pour l’emploi et ont tout autant besoin d’accès aux prêts bancaires.
Le commissaire européen Michel Barnier a également présenté en janvier 2014 un projet de réforme du secteur bancaire, qui vise à limiter la taille des banques. L’objectif est d’opérer une séparation au sein des banques entre activités de dépôt (gestion de l’épargne des particuliers ou des entreprises, octroi de prêts) et activités de banque d’affaires (intervention sur les marchés financiers). Cette proposition de loi a-t-elle des chances d’aboutir ?
La proposition de Michel Barnier a un immense mérite : elle reconnaît l’existence d’un problème, avec des banques « mixtes » (qui cumulent activités de dépôt et d’affaires) trop grandes et trop interdépendantes. Le Commissaire propose de donner pouvoir au superviseur – la Banque centrale européenne – de décider au cas par cas si les banques européennes sont trop grosses, trop complexes ou trop interconnectées, et donc représentent une menace pour l’économie. Le superviseur aurait alors le pouvoir d’intervenir pour « séparer » les activités des banques mixtes (cantonner les activités à risque dans une filiale séparée, ndlr [4]). Mais beaucoup de points techniques sont encore à discuter, et cette proposition est fragile. Surtout quand on voit la réaction assez violente de la France et de l’Allemagne, qui ont voté leurs propres « lois de séparation bancaire » en 2013, relativement vides… Certains États considèrent qu’il est impossible de toucher à « leurs » banques. Ils ne veulent absolument pas traiter les problèmes, ni les regarder en face.
L’ex-ministre français des Finances, Pierre Moscovici, a jugé que cette proposition européenne était trop radicale. Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France et donc régulateur de la finance française, a jugé les propositions « irresponsables et contraires aux intérêts de l’économie européenne »… Quelle a été la réaction du lobby bancaire ?
Le lobby bancaire européen s’est déchaîné sur ce sujet, il a sorti le grand jeu. Avec tous les arguments habituels. Notamment que la séparation des banques mettrait en péril l’économie, car les banques n’auraient plus les moyens de faire des prêts aux entreprises. Un argument du lobby bancaire repris par Christian Noyer, sans aucune nuance. C’est pourtant l’inverse qui est vrai. Aujourd’hui, seuls 10 % des actifs des banques en moyenne sont consacrés à des prêts aux entreprises, en Europe, et 15% à des prêts aux ménages (les 75% restants étant surtout consacrés aux placements sur les marchés financiers, ndlr). La Banque centrale européenne accorde des prêts aux banques à des taux extrêmement avantageux [5]. Une banque mixte recyclera instantanément cet argent dans les marchés financiers [6]. Une banque dont le seul métier est le prêt aux entreprises va prêter cet argent aux entreprises. Et fera bien mieux son travail de financement de l’économie réelle !
Les banques « séparées » n’auraient plus les moyens d’intervenir sur les marchés financiers, ni d’acheter la dette de l’État, ce qui entrainerait des attaques spéculatives sur les dettes publiques, affirme aussi le lobby bancaire…
Les plus grandes banques d’affaires du monde sont américaines. Elles se sont développés dans le régime de stricte séparation des activités bancaires commerciales et des activités d’affaires, instauré par le Glass Steagall Act (adopté en 1933, et abrogé par Bill Clinton en 1999). Pourquoi un régime de stricte séparation tuerait-il le métier de banque d’affaires, alors qu’il a permis aux banques américaines de prospérer ?
Quant à l’argument concernant la dette de l’État, il a pour but de faire peur aux responsables politiques, mais il n’a aucune valeur technique. Quelque soit la taille des banques, petites boutiques ou grandes banques mixtes, elles peuvent finance la dette des États.
Ce que les banques ne disent pas, c’est que la séparation des activités remettrait en cause une garantie implicite de l’État, dont bénéficient les banques « mixtes », comme le Crédit Agricole, BNP Paribas ou la Société générale, en France. Une garantie qui rapporte 200 à 300 milliards d’euros par an aux banques européennes !
C’est la vraie question, effectivement. Cette garantie implicite leur permet d’emprunter des fonds à un meilleur taux sur les marchés financiers (comme ces banques collectent l’épargne des ménages et entreprises, les investisseurs anticipent le fait que l’État sera toujours là en cas de faillite, et cette garantie permet aux banques mixtes de bénéficier sur les marchés financiers de taux d’intérêts plus avantageux, ndlr). Les chiffres de cette garantie, évaluée notamment par une étude récente du FMI, sont absolument astronomiques (lire notre article).
C’est une rente économique pour les plus grandes banques. On comprend qu’elles se battent pour la garder. Cet avantage nourrit l’expansion des banques précisément dans des secteurs d’activité qui sont les moins utiles à l’économie.
Entre 2001 et 2011, le bilan des banques européennes a augmenté de 80 %. Dans le même temps, l’économie européenne a connu une croissance entre 25 et 30 %, soit 2,5 fois moins ! La croissance des banques est toujours plus déconnectée de l’économie réelle : 7 % des transactions sur les produits financiers dérivés sont réalisées entre des banques et des entreprises. Le reste, 93% des transactions, est un jeu entre financiers, nourri par cette garantie implicite des États aux grandes banques mixtes.
On voit dans toutes ces réformes l’impact du très puissant lobby de l’industrie bancaire. Les responsables politiques sont-ils encore capables de lui résister ?
Au niveau des institutions européennes, le lobbying du secteur bancaire est un énorme rouleau compresseur. C’est ce que montre le rapport de l’ONG Corporate Europe Observatory, qui a comptabilisé 1700 lobbyistes dans le secteur financier européen. En décembre 2013, Michel Barnier a interdit à ses équipes de recevoir les lobbyistes des banques, pour mettre fin aux pressions quotidiennes. Il a fermé la porte, mais les banques sont rentrées par les fenêtres, via les États.
Malgré ce rouleau compresseur, la Commission européenne propose des textes qui ont plutôt de la tenue et un vrai objectif. Même si nous sommes les premiers, à Finance Watch, à en pointer les insuffisances. Le Parlement s’empare vraiment des dossiers, les travaille, réussit à faire avancer des questions, malgré les pressions. Mais le Conseil européen, composé des États membres, subit un phénomène relativement pervers : chaque État souffre d’une forme de capture par son industrie financière nationale, et s’érige en défenseur de ses champions nationaux, « ses » banques.
Et chaque État va, à tour de rôle, bloquer l’avancée des dossiers au niveau du Conseil européen, ou les édulcorer de façon considérable. Les gens qui ont le pouvoir en Europe aujourd’hui ne représentent pas l’intérêt européen, mais les intérêts nationaux. Le phénomène de capture des responsables politiques par les lobbys bancaires est exacerbé par la gouvernance européenne déficiente.
Comment le lobby bancaire fait-il pression sur les États ?
Ce qui se passe dans les États est de nature un peu différente, ce qui rend le jeu encore plus complexe et biaisé. Il y a une grosse disproportion de moyens sur le terrain à Bruxelles, on ne joue pas à armes égales. Mais dans les États membres, ce sont des réunions entre PDG de banques et ministres, l’impact est beaucoup plus considérable. Et moins visible. En Allemagne, il y a une culture de proximité phénoménale entre les politiques et le système bancaire : 50 % des élus allemands, y compris des élus au Bundestag, sont administrateurs des caisses d’épargne de leur circonscription. En Grande-Bretagne, la capture est d’ordre intellectuel : la City (place financière de Londres) est une espèce de vache sacrée. Une décision qui coûte un centime à la City va être considérée comme mauvaise pour toute la Grande-Bretagne.
En France, l’influence est plus discrète. Il faut regarder qui sont les personnes qui dirigent la Fédération bancaire française : des énarques et et des inspecteurs des finances, comme de l’autre côté, au ministère. Cela facilite les échanges, on se comprend à demi-mot. C’est une capture sociologique.
L’organisation que vous dirigez, Finance Watch, a-t-elle des moyens suffisants pour faire contre-poids face à ces pressions du lobby bancaire ?
Nous avons eu la chance de connaître un bon envol, depuis le démarrage il y a trois ans. Finance Watch répondait à un vrai besoin, au bon moment. L’organisation a été créée à l’appel de 22 puis 200 élus européens, de tous horizons politiques, qui ont souligné l’importance de rééquilibrer les débats sur ces questions. Cela donne une dynamique. Nous sommes très sollicités par les régulateurs, les gouvernements, les parlementaires, qui ont besoin d’un plaidoyer qui prenne en compte l’intérêt général.
___________________________________________________
Notes :
[1] Secrétaire général de l’ONG européenne Finance Watch, Thierry Philipponnat a travaillé pendant 20 ans dans le secteur bancaire, puis a été responsable d’Amnesty international France. Il a été nommé en novembre 2013 au collège de l’Autorité des marchés financiers, en France
[2] Directive BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive
[3] Le « paquet CRD IV », qui transpose dans le cadre législatif européen, par un règlement et une directive, les accords internationaux de Bâle III sur les nouvelles normes mondiales sur les fonds propres des banques, est entré en vigueur le 17 juillet 2013. Ces accords porte notamment le ratio de solvabilité global de 8% à 10,5% du bilan des banques. Et les exigences de fonds propres « durs », les plus mobilisables, passent de 2% à 7%
[4] La proposition intègre deux mesures phares : l’interdiction pour les banques, à partir de 2017, de spéculer pour leur propre compte sur les produits financiers s’échangeant sur les marchés (actions, obligations, produits financiers complexes…) et sur les matières premières. Et donner le pouvoir à la Banque centrale européenne d’imposer le cantonnement dans une filiale séparée des activités de marché jugées à haut risque, réalisées pour les clients des banques. Lire le détailici.
[5] Notamment via le LTRO, « Long term refinancing operations », prêts à long terme — trois ans — accordés aux banques par la Banque centrale européenne pour éviter un effondrement du crédit. Deux LTRO, d’un total de 1000 milliards d’euros, à taux très faible, ont été accordés en décembre 2011 et février 2012.
[6] Soit en achetant de la dette d’État, soit en replaçant les liquidités auprès de la Banque centrale européenne — c’est le serpent qui se mord la queue ! — soit en plaçant cet argent dans les marchés financiers en général.
A lire : Christian Chavagneux et Thierry Philipponnat, La capture, Où l’on verra comment les intérêts financiers ont pris le pas sur l’intérêt général et comment mettre fin à cette situation, Editions La Découverte, 2014