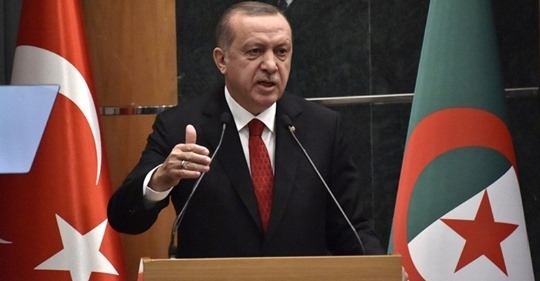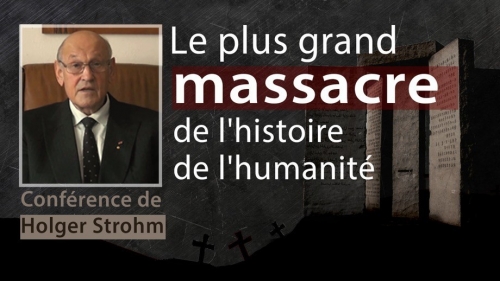Pourquoi l’Occident a-t-il détruit sa propre base industrielle ?
https://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-loccident-a-t-il-detruit-sa-propre-base-industrielle
Par Matthew Ehret – Le 23 juillet 2019 – Source Oriental Review
Avec le radical échec du Green New Deal de la Représentante Alexandria Ocasio-Cortez et les incroyables révélations de la NASA selon lesquelles la croissance industrielle a augmenté la biodiversité sur la terre, un puissant paradoxe se présente.

Depuis des décennies, on nous dit que l’activité industrielle de l’humanité est la cause directe du réchauffement de la planète et des milliers de milliards de dollars ont été consacrés à subventionner des fermes éoliennes, des biocarburants et des panneaux solaires inefficaces, à ainsi augmenter les coûts de l’électricité et réduire de façon catastrophique le potentiel productif des nations. La question doit donc être posée : si l’argent est le moteur du capitalisme, pourquoi des milliers de milliards de dollars ont-ils été dépensés au cours des dernières décennies pour financer des activités « vertes » qui sapent intrinsèquement la base de la création de capital (c’est-à-dire, l’infrastructure et la production industrielle) ? Pourquoi l’« Occident capitaliste » s’est-il détruit ? Est-ce une question de folie ou quelque chose de plus insidieux ?
L’Illusion « post-industrielle »
Depuis le flottement du dollar américain sur les marchés mondiaux en 1971 et la création du pétrodollar en 1973, le monde a connu un effondrement constant des emplois productifs dans le secteur manufacturier, des investissements dans les infrastructures, soit une planification à long terme d’une part et, d’autre part, une augmentation de la déréglementation, de la spéculation à court terme, des services financiers et des emplois à bas salaire dans le commerce de détail. Au cours de ce processus de déclin qui a suivi 1971, l’esclavage de la dette est devenu une norme tant dans les pays développés que dans les pays en développement, tandis que l’externalisation a provoqué la castration de la souveraineté nationale et une dépendance toujours accrue à l’égard de la « main-d’œuvre bon marché » et des « ressources bon marché » de l’étranger. Ce processus a même été appelé la politique de « désintégration contrôlée » du Président de la Réserve Fédérale Paul Volcker en 1978, au moment où il se préparait à relever les taux d’intérêt à des niveaux qui rendraient impossible pour une majorité de petites et moyennes entreprises agro-industrielles de concurrencer les firmes monolithiques. Le modèle le plus solide de cet effondrement a été révélé en 1996 par le regretté économiste américain Lyndon Larouche, et [url+]identifié[/url] sous le nom de Triple courbe d’effondrement (Triple Curve Collapse Function).