Difficile de laisser passer cette fête de Noël sans protester. Oui protester contre la prétention de l'association des maires de France de contribuer un peu plus à la déchristianisation de ce pays.
Version audio de cette chronique
Soulignons que cet organisme ne dispose d'aucune autorité. Mais il a cru pouvoir, sous la co-présidence de deux personnages emblématique de notre république faisandée, l'un issu des rangs chiraquiens, ancien ministre de Sarkozy, le fils Baroin, l'autre qui fut une figure particulièrement sectaire de l'ère Mitterrand en la personne de Laignel maire d'Issoudun, proposer qu'on empêche, au nom de la laïcité, d'installer des crèches de Noël dans les mairies de nos villages. Ces gens parlent d'ailleurs comme si cette tradition valait acte de foi.
Leur recommandation n'a bien sûr aucune valeur en droit. Et on annonce que des maires étiquetés à droite protestent et annoncent qu’ils passeront outre cette recommandation.
Ils ont raison.
Mais je pense d'abord que ces maires qui s'insurgent contre une telle entrave faite à la fois aux libertés et aux traditions ne sont pas assez nombreux, que la proposition de MM. Laignel et Baroin devrait obliger ces deux citoyens à déguerpir de leurs fonctions au sein de l'AMF.
Car leur recommandation dans le cadre de l’AMF n'a aucun sens.
À l'évidence en effet, tendre hypocritement à interdire, dans l'avenir, la présence de crèches de Noël dans les mairies correspond à l'idée d’une laïcité s’exerçant par le vide religieux, sous prétexte de répondre à l'agression des islamo-terroristes dont on nous répète tous les matins qu'ils n'ont, eux, rien à voir avec la foi mahométane. En fait on donne raison à ces extrémistes de l'islam, y compris contre les éléments disposés à une cohabitation avec le pays et les populations d'accueil.
La laïcité originellement était conçue, et affirmée par ses promoteurs, en vue d'assurer en théorie le pluralisme religieux et la liberté de conscience de ce qu'un Barrès saluera en 1917 comme les diverses familles spirituelles de la France.
Les maisons communes que sont les mairies devraient donc, à ce titre, pouvoir accueillir librement, avec des droits égaux, chacune leur tour, ceux qui représentent les traditions du pays, et Noël en est une suffisamment forte, pour que la loi la reconnaisse comme jour férié.
Le seul principe légitime de la laïcité serait qu’aucune religion ne doit bénéficier d’un privilège dans l’État et sur l’État.
Un ami humoriste me fait remarquer que certains de nos concitoyens pourraient se déclarer "victimes d’une odieuse islamophobie si on commémore dans nos mairies la naissance d’un enfant juif dans une Palestine sans Arabes ni musulmans." Que lui répondre ?
Sur le fond de l'affaire, la recommandation de l'AMF, sous l'égide de Baroin et Laignel, s'inscrit dans un contexte où "on" veut nous faire capituler devant l'islamisation rampante de la France et de l'Europe. Elle est évidemment marquée par un sectarisme laïcard dont tout le monde peut reconnaître la patte, celle du grand-orient de France si puissant au parti socialiste et au sein des réseaux chiraquiens.
Or, ce n'est certainement pas de retirer administrativement, et de plus : lâchement, les crèches de Noël qui fera reculer l'islamo-terrorisme. Au contraire.
On doit donc répondre sur le terrain de la liberté : celle d'exercer de traditions aussi inoffensives que la crèche de Noël dans les mairies de certains villages de France, un usage catholique millénaire, la France et l'Europe, même laïques, étant elles-mêmes issues du judéo-christianisme.
Soulignons aussi, s'agissant de l'islam, qu'il ne s'agit pas d'un "culte" mais d'une prédication. Celle-ci n'a pas grand-chose à voir avec l'Histoire de France, encore moins avec celle de l'Europe, sauf à inverser les rôles de la bataille de Poitiers ou du siège de Vienne.
Que certaines traditions maghrébines ou asiatiques soient accueillies, à l'occasion, dans cette "maison commune" qu'est la mairie, dès lors qu'il existe une raison sociologique de les accueillir dans certaines municipalités, cela relève du bon sens et du vivre ensemble, comme la crèche de Noël ou toute autre fête traditionnelle tournée vers la lumière, mais cela doit résulter de la liberté du maire et ne laisser aucune place à aucune prédication fanatique, quelle qu'elle soit. Pas plus celle de l'islamisme que celle de l'athéisme persécuteur des con-frères de MM. Laignel et Baroin.
Je souhaite donc en ce jour à tous mes amis lecteurs et auditeurs, et même à tous mes adversaires, une heureuse fête de la Nativité.
JG Malliarakis
À lire en relation avec cette chronique
"La Loge maçonnique", à commander aux Éditions du Trident, sur la page catalogue ou par correspondance en adressant un chèque de 20 euros aux Éditions du Trident, 39 rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
http://www.insolent.fr/
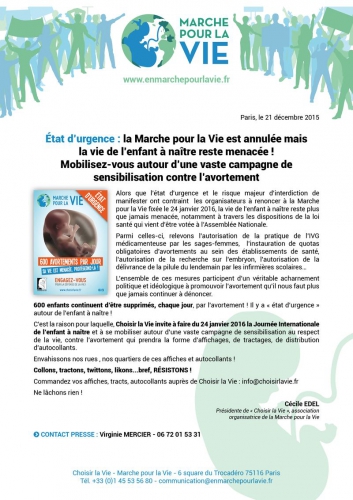
 Jean-Yves Le Gallou
Jean-Yves Le Gallou 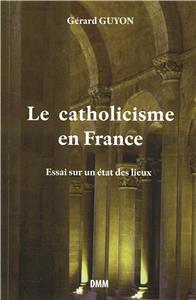 Cet essai sur le catholicisme en France ne porte pas seulement en lui une nostalgie inguérissable de la civilisation française millénaire. Il relève, à travers des thèmes précis, les principales étapes qui ont conduit à la situation actuelle où les catholiques se découvrent comme une communauté marginale dans une société devenue indifférente à la foi qui l'a historiquement construite. Tandis qu'une sécularisation et un laïcisme agressif rendent leur vie spirituelle et leur pratique du culte de plus en plus difficiles, sauf de manière étroitement communautaire.
Cet essai sur le catholicisme en France ne porte pas seulement en lui une nostalgie inguérissable de la civilisation française millénaire. Il relève, à travers des thèmes précis, les principales étapes qui ont conduit à la situation actuelle où les catholiques se découvrent comme une communauté marginale dans une société devenue indifférente à la foi qui l'a historiquement construite. Tandis qu'une sécularisation et un laïcisme agressif rendent leur vie spirituelle et leur pratique du culte de plus en plus difficiles, sauf de manière étroitement communautaire.