tradition - Page 275
-
Guy Steinbach - Les Camelots, Maurras et l'Action française
-
Banderole “Hollande, démission” en ULM – Interview exclusive du pilote

PARIS (NOVOpress) – Preuve de l’incroyable créativité du mouvement d’opposition au mariage des couples homosexuels, un pilote a sillonné cet été les plages du littoral français avec un message des plus pertinents adressé au président le plus mal élu de la cinquième République : “Dégage” et “Hollande démission”. David Van Hemelryck a accepté de répondre à nos questions.
Novopress : Vous êtes depuis plusieurs mois au cœur de nombreuses initiatives gravitant autour de la Manif pour tous, comment – vierge de tout engagement politique – avez-vous franchi le pas de l’engagement militant ?
David Van Hemelryck : Il ne s’agit pas ici d’engagement militant, mais bien d’une obligation. Lors de la manifestation du 24 mars, des amis proches ont été gazés, matraqués et blessés par les forces de l’ordre. Ces gens ne sont pas issus de milieux défavorisés, de banlieues difficiles, ne sont ni des délinquants ni des militants fanatiques. Ils ne sont ni plus ni moins que des “Français moyens”, totalement respectueux des lois et qui avaient confiance dans les institutions de la République. Ils exerçaient simplement leur droit d’expression suite à la dégradation vertigineuse dans laquelle le gouvernement entrainait leur pays depuis avril 2012. Quand on aime son pays et que l’on a une conscience, alors on agit. On ne peut laisser ce gouvernement maltraiter son peuple.
Novopress : Vous semblez manier avec facilité les outils de l’agit-prop. Tout est utile pour frapper les esprits et réveiller les consciences. Comment vous est venue cette idée d’utiliser un petit avion pour diffuser votre message sur les plages ?
DVH :En tant que pilote c’était un moyen légal de toucher le plus grand nombre de personnes possible en passant un message là où ils se trouvent en été, c’est à dire sur les plages. J’ai pensé que les graffitis dans le métro auraient moins d’impact au mois d’août !
Pouvez-vous nous brosser rapidement l’itinéraire que vous avez emprunté avec votre désormais célèbre ULM ?
Après trois semaines d’entraînements tout a commencé à Pau, où j’ai acheté la machine, et où avec un ami pilote nous l’avons modifié nous même – en toute légalité – pour le remorquage de banderole. Immédiatement j’ai rejoint la côte.
Le “buzz” a commencé lors du survol des plages du Bassin d’Arcachon. J’avoue avoir fait 3 tours du bassin pour m’en assurer. Je suis allé le même jour jusqu’à Royan, c’était le 10 août.
Ensuite voici dans les grandes lignes notre marathon aérien :
l’Ile de Ré le 11 août, puis Noirmoutiers le 13. Le 14 fut marqué par la première intervention policière qui a illégalement maintenu l’avion au sol pour plusieurs jours. Le 16 Août ce fût La Baule puis Quiberon le 17 où dix-huit gendarmes furent déployés pour m’accueillir. Suivirent Dînard et Saint-Malo, où je suis aussi passé trois fois. Un véritable marathon car parfois en raison du vent et de la traction de la banderole la “vitesse sol” tombait à moins de 40 km/h !
Notre trajet a été ponctué de plusieurs incidents techniques, ainsi le mât de la banderole a cassé le 24 août, alors que nous étions au Havre. Le 30 Août nous étions au Touquet puis à Calais.
Le 2 et 3 septembre Fréjus, Saint-Raphaël et Sainte-Maxime et encore une intervention policière pour nous interdire de nous poser à Fréjus et de décoller de Fayence. Ensuite, traverser la méditerranée et terminer par les plages de Montpellier à l’Espagne… La boucle est bouclée le deuxième jour après la rentrée scolaire !
Là encore, des ordres très précis avaient été donnés aux forces de l’ordre pour freiner votre périple voire le stopper.
Quels sont les exemples les plus marquants qui vous viennent à l’esprit ?
L’exemple le plus marquant de la pression policière a été sans nul doute lorsque les forces de l’ordre sont venues chez ma mère et ont tenté de l’intimider. Deux fois ! Ils sont même allés la réveiller à 6 heures du matin, soit disant pour demander où je suis. Mais Monsieur Valls! C’est sur internet!!
Quel bilan tirez-vous de cette action ? Etes-vous parvenu à briser le mur médiatique ?
Je note que c’est vous, journaliste, qui employez le terme de “mur” en parlant des médias … S’agit-il d’une reconnaissance d’un fait établit ? C’est tout à votre honneur !!!
Non, le mur n’est pas brisé, seulement un peu éraflé. C’est d’ailleurs le point central de ce bilan, les médias décident de ce dont le peuple doit être informé et non pas l’inverse … en tout cas pas encore. Mais les réseaux sociaux se posent aujourd’hui en concurrents sérieux des puissants groupes de presse et des institutions audiovisuelles. Les informations arrivent petit à petit à être vérifiées, commencent à circuler avant même que les médias traditionnels puissent mettre sous presse. Cela donne confiance dans le peuple Français !
La loi Taubira ayant été votée, il est évident que le formidable élan de la Manif pour tous et des nombreux mouvements associés doit transformer l’essai en se saisissant d’autres sujets touchant fortement les Français. L’insécurité, l’idéologie dominante à l’école, la problématique du Grand Remplacement … Ce virage est visible dans le manifeste des Sentinelles publié il y a quelques jours, est-il également le vôtre ?
Virage ? J’avance droit devant ! Mon grand combat est contre Hollande, ce dirigeant qui ose gouverner contre son peuple, persuadé qu’il a raison contre tout le monde.
La somme des mécontentements est immense et l’équipe Hollande-demission.fr les représentera tous, pour rassembler au delà des sectarismes. La France entière ne veut plus de Hollande !
La mobilisation de soutien au bijoutier de Nice est un exemplaire supplémentaire de la survivance d’un bon sens populaire, tellement bafoué par les élites, qu’il s’exprime en dehors des canaux traditionnels, et notamment par internet. La barre des deux millions de soutien ne semble plus inatteignable. Que vous évoque cette mobilisation inédite ?
L’ affaire du bijoutier de Nice n’évoque pas une réalité nouvelle, ce est nouveau en revanche, c’est la réaction des Français. Une telle mobilisation spontanée montre que le point de rupture des Français est proche. On ne peut demander aux Français de tout accepter sans broncher. Pourquoi accepteraient-ils qu’un Jérôme Cahuzac, un fils Fabius, un fils Touraine ou que des délinquants récidivistes connus des services de polices soient en liberté, quand ils se permettent de profiter du système, alors que ce même système décide d’envoyer en prison un homme victime d’agression, qui a défendu son bien en état de légitime défense. Le mot “égalité” n’aurait plus aucun sens dans notre devise nationale.
David Van Hemelryck, merci d’avoir répondu à nos questions, vous retrouvera-t-on dans les airs ces prochains mois ?
Peut-être pas dans les airs mais vous me retrouverez. Nous prévoyons “encore plus fort”. Hollande-Demission.fr mènera le combat jusqu’au bout, vous pouvez nous faire confiance.
-
Groupe d'Action Royaliste
Soutenu par Maître Antoine Murat malheureusement disparu. Créé en octobre 2008 et considéré aux yeux du doyen des Camelots du Roi, Guy Steinbach, (qui est également le président d'honneur) comme étant parfaitement dans la lignée des Camelots du Roi, le GAR s'est donné comme objectif de moderniser le combat royaliste en ce début du XXIème siècle. Fonctionnant plus comme un réseau de militants autonomes et déterminés, le GAR élabore sa base de recrutement sur des critères biens précis : Pas d'esprit consommateur, tous les militants du GAR sont là pour donner de leur personne et si possible aussi doivent être membre du réseau Lescure. Les militants doivent agir :
Avec l'intérêt général et non avec leurs caprices de sentiments.
Avec l'intérêt général et non avec leurs goûts ou leurs dégoût, leurs penchants ou leurs répugnances.
Avec l'intérêt général et non avec leur paresse d'esprit ou leurs calculs privés ou leurs intérêts personnels
-
Les sentinelles ne lâchent rien Place Vendôme devant une police énervée
Témoignage d'une sentinelle présente hier soir devant le ministère de la justice :
"Hier soir Place Vendôme, une dizaine de sentinelles étaient présentes et certaines se sont avancées devant le ministère. La police est donc arrivée pour empêcher les sentinelles de veiller librement. Ils les ont donc portés de l'autre côté de la rue. La police était particulièrement énervée et les ordres semblaient plus virulents que d'habitude. Un des policiers nous a demander d'arrêter de twitter. Le commissaire était avec eux : celui qu'on voit habituellement aux veilleurs assis, "commissaire Éric Sommation" comme certains l'appellent. Nous sommes partis reprendre des forces (bière pour tous) laissant deux sentinelles veiller seule face à l'ensemble de la police venue en nombre ce soir. Le commissaire a pu rentrer sentant le "danger" s'éloigner.
À notre retour, les policiers étaient assez décontenancés et ont commencé à appeler dans tous les sens. Nous étions une dizaine et avons pris notre position de sentinelles, certains d'entre nous ont avancé, la réaction fut immédiate et violente. Un policier a menacé une sentinelle " reculez ou je vais vous frapper! ".
Un peu plus tard, un autre policier a bousculé assez violemment l'un d'entre nous pour l'unique raison qu'il était sentinelle devant le ministère en le traitant d'"autiste" (?) et autres noms insultant non seulement les sentinelles mais aussi et surtout l'ensemble des personnes atteintes de cette maladie. Le commissaire est revenu en appelant en haut lieu et précisant qu'il voulait une GAV ce soir.
Les policiers, pendant la soirée, cherchaient à nous intimider et nous appelaient par nos prénoms et précisaient nos âges et lieux de travail. À ce moment de la soirée, nous étions bien une dizaine de veilleurs face à 4 fourgons de police, une voiture banalisée dans laquelle était notamment le commissaire, le tout avec une voiture de police qui passait de temps en temps pour surveiller l'ensemble.
Vers 6 h la police est partie et les sentinelles ont repris leur place devant le ministère avec pour seul leitmotiv : on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais !!!"
-
Le pape François condamne vigoureusement l'avortement et l'euthanasie
Et paf dans les dents pour les médias qui s'étaient réjouis en interprétant un peu trop vite les propos tenus par le Pape dans l'entretien à la revue jésuite :
"Nous ne pouvons pas insister seulement sur les questions liées à l’avortement, au mariage homosexuel et à l’utilisation de méthodes contraceptives. Ce n’est pas possible. Je n’ai pas beaucoup parlé de ces choses, et on me l’a reproché. Mais lorsqu’on en parle, il faut le faire dans un contexte précis."
Certains ont cru qu'il ne fallait plus en parler. Patatras. Le Pape François recevait aujourd'hui au Vatican une centaine de gynécologues catholiques.
"Chaque enfant non né, mais injustement condamné à être avorté, possède le visage du Seigneur qui, avant même de naître puis à peine né, a fait l'expérience du refus du monde. Et chaque personne âgée, même si elle est malade ou en fin de vie, porte en elle le visage du Christ".
"On ne peut les éliminer !"
Il est alors revenu sur la "culture du rejet" ou du "déchet". Cette culture a
"un coût très élevé : elle appelle à éliminer des êtres humains, surtout s'ils sont physiquement ou socialement plus faibles". "Notre réponse à cette mentalité est un oui résolu et sans hésitation à la vie", "il n'existe pas une vie humaine plus sacrée qu'une autre".
"Le fait que vous soyez médecins catholiques vous confère une plus grande responsabilité. (...) Les pavillons hospitaliers de gynécologie sont des lieux privilégiés de témoignage et d'évangélisation. Chers amis médecins qui êtes chargés de vous occuper de la vie humaine dans sa phase initiale, rappelez à tous, dans les faits comme avec les paroles, qu'elle est toujours, dans toutes ses phases et à n'importe quel âge, sacrée et de qualité. Et ce n'est pas un langage de foi, c'est un discours de raison et de science". "Cet engagement pour la vie exige d'aller à contre-courant, en payant de sa personne".
-
De l’art de la guerre médiatique 2/2

Polémia - Rediffusion
En excluant de manière humiliante Christian Vanneste de leur université d’été pour le cacher à la presse, les dirigeants de la Manif pour tous ont commis une double faute.
Une faute humaine et morale d’abord. Une faute politique ensuite : ils ont montré leur crainte révérencielle du politiquement correct et contribué ainsi à le renforcer. Car diaboliser son voisin, c’est renforcer la diabolisation dont on est soit même victime. Polémia rediffuse ici l’article de Didier Beauregard sur « de l’art de la guerre médiatique » qui dénonce l’inefficacité des méthodes Barjot. Et propose une stratégie alternative - Polémia.
Comment briser le rideau de fer médiatique
Les dissidents, sans nul doute, doivent affûter leurs stratégies de communication sur la base de nouveaux moyens d’action pour briser le rideau de fer médiatique.
Pour filer plus loin la métaphore militaire, il faut se référer au mode de conflits contemporains de confrontation du fort au faible, dits conflits asymétriques.
– Miser sur l’offensive
La confrontation médiatique tend naturellement à la simplification. Et toute position défensive est d’emblée perçue comme une faiblesse. Elle ne laisse donc d’autre choix que l’offensive. Autrement dit, une fois posés les éléments de réponse aux arguments et attaques de l’adversaire, il faut rapidement passer aux outils offensifs afin de bousculer les positions adverses.
– Optimiser l’orchestration du débat d’idées
Il ne faut cependant pas confondre simplification et simplisme. Le débat d’idées ne doit être ni négligé ni méprisé mais, comme nous l’avons déjà exprimé, il sert d’abord à fixer l’adversaire dans des controverses dont les résultats, souvent, brouillent plus les repères qu’ils ne les clarifient aux yeux de l’opinion publique. La controverse intellectuelle est indispensable pour enlever le monopole de la raison à l’adversaire et le placer sur la défensive, utile pour entretenir un bruit de fond, qui perturbe les messages ennemis, et nécessaire, pour légitimer par le haut l’engagement des camps qui la portent.
Mais à l’heure des médias de masse audiovisuels et de l’Internet, l’essentiel du combat se joue ailleurs. La guerre médiatique est d’abord une guerre de l’image, donc de la mise en scène de représentations.
– Maîtriser un système offensif de représentations
La maîtrise totale de l’espace médiatique « officiel » par le Système dominant exclut toute possibilité de compromis. D’emblée, le Système médiatique s’est constitué en bloc monolithique hostile face au mouvement de contestation du mariage homo.
La stratégie de communication de la Manif pour tous devait donc viser essentiellement à briser l’enfermement dans une représentation négative, en évitant, là encore, le double piège de répondre à l’image caricaturale que l’adversaire veut donner de vous, ou d’essayer de le désorienter, ou, pire encore, de le séduire, en récupérant ses codes. Ce qui renvoie, pour faire simple, dans le cadre de la contestation du mariage homo, à l’option Civitas ou l’option Frigide Barjot.
– Elargir le champ de la contestation
Dans une logique offensive, la Manif pour tous n’avait, selon nous, pas d’autre choix que d’agir en calquant sa stratégie sur celle du gouvernement qui, d’emblée, a dépassé le terrain de la confrontation des idées pour celui de la guerre psychologique à base d’accusations simplistes et de suspicions sur les intentions de l’adversaire.
La manifestation du 24 mars, avec le cortège de brutalités et de déficiences policières qui l’a accompagnée, devait servir de point de basculement pour positionner l’essentiel de la communication médiatique du mouvement de contestation sur la violence du gouvernement et sa tentation totalitaire. Cela veut dire, en clair, un message simplifié, politisé et globalisé.
– Assumer la radicalité
La multiplication des actions à la base, imaginatives et transgressives, qui faisaient ressortir la virulence répressive du pouvoir politique n’a pas été relayée avec la force nécessaire par les porte-paroles de la Manif pour tous, enfermés dans une position d’autojustification de leur propre non-violence, sous le feu roulant des accusations et des insinuations portées par le gouvernement et ses relais médiatiques.
Le comble du tordu a été atteint par Frigide Barjot quand cette dernière a demandé elle-même au ministre de l’Intérieur de mettre en prison les « extrémistes », légitimant du même coup la stratégie du gouvernement de chantage au risque « fasciste ».
La gauche, elle, une fois posées les condamnations de principe contre la violence qui n’engagent pas à grand-chose, n’hésite pas à récupérer les débordements de ses extrémistes pour mieux dénoncer un Système oppressif qui ne laisse d’autre choix que la violence à des êtres bafoués.
Un mouvement de contestation, s’il veut être efficace, ne doit pas se couper totalement de ses tendances les plus radicales, même s’il doit savoir les tenir à distance pour ne pas se laisser déborder au risque de se délégitimer. La gauche a toujours su magistralement orchestrer la violence, physique ou verbale, de ses tendances les plus dures pour entretenir un bruit de fond révolutionnaire qui lui permet de cultiver un romantisme puéril de la révolte sur lequel elle fonde sa légitimité historique.
Le peuple de droite, quand il défile, n’a de cesse de se conformer aux injonctions de ses adversaires qui réduisent d’emblée ses marges de manœuvre en l’enfermant dans le cercle vicieux du soupçon de violence extrémiste.
Les défilés de patronage domestiqués par la crainte de tout débordement, aussi massifs et sympathiques soient-ils, n’ébranleront jamais un pouvoir rompu aux méandres de la manipulation politique.
– Mettre en scène l’émotion
Pour lever toute ambiguïté sur notre propos, précisons qu’ « assumer la radicalité » ne veut nullement dire encourager la violence ; cela signifie simplement donner à son action politique une charge émotionnelle qui prête une valeur exemplaire au combat mené.
Cette charge émotionnelle provient prioritairement de la volonté de piéger l’adversaire dans une représentation négative, voire répulsive, qui le renvoie à des accusations auxquelles l’opinion publique sera sensible. Dans le cadre de la Manif pour tous, il est clair que les thèmes de la répression policière et de la manipulation médiatique étaient susceptibles de rencontrer un large écho auprès d’un grand nombre de Français, déjà réceptifs à ces sujets.
La gauche, avec son système actif de diabolisation, nous a montré depuis des décennies l’effet redoutable de ses campagnes de déferlement émotionnel dont l’affaire Clément Méric est le dernier fleuron.
Sans vouloir atteindre un tel degré de violence émotionnelle, qui suppose déjà un contrôle en profondeur de l’univers médiatique et une volonté totalitaire de le mettre en œuvre, il est clair cependant qu’aucun mouvement d’opinion significatif ne peut s’imposer dans le paysage public sans une mise en scène de l’émotion qui départage aux yeux du peuple les « bons » et les « méchants ».
Dans ce jeu conflictuel des représentations, le pouvoir socialiste vient de commettre sa première erreur majeure en condamnant le jeune Nicolas à deux mois de prison ferme. Il a fait là un grand pas en direction du camp des « méchants ». Les opposants au mariage pour tous peuvent, et doivent, relancer la dynamique de leur mouvement autour de la répression policière et de la dérive totalitaire.
Choqués par la sévérité de la sanction qui frappe un jeune manifestant non violent (à comparer aux peines insignifiantes qui touchent les racailles qui ont violemment défié l’ordre public), les esprits sont mûrs pour suivre cette évolution stratégique indispensable.
– Exercer une pression « citoyenne » sur les médias
Mettre en œuvre une bonne stratégie communicationnelle ne suffit pas nécessairement à franchir la muraille des médias officiels qui fixent encore le cadre autorisé de l’expression publique. Nous retrouvons la question centrale de la forteresse médiatique et des moyens de l’investir.
Nous ne pouvons, dans le cadre restreint de cet article, trop développer cette question, d’autant que chaque cas est un cas particulier. Les acteurs des nouveaux courants de contestation devront pragmatiquement, en fonction des circonstances, trouver leurs propres méthodes d’action. Quelques rapides remarques peuvent cependant permettre de fixer certains repères.
Les médias officiels ont une tendance « naturelle » à ignorer ce qui dérange leurs schémas de pensée à moins que le fait ne devienne par lui-même trop massif pour être occulté sans risquer sa crédibilité. Nous raisonnons ici dans le cadre d’un fait de société qui a franchi le seuil de visibilité médiatique par sa propre dynamique, ce qui est bien le cas de la Manif pour tous dont l’enjeu n’était donc pas d’être visible, mais que ses messages ne soient pas tronqués et son engagement caricaturé.
Dans la logique du conflit asymétrique, le plus faible en termes de forces objectives doit concentrer ses actions sur les points de vulnérabilité de l’adversaire.
Or, si le pouvoir des médias est grand, ces derniers sont loin, pour autant, d’être invulnérables. Leur première faiblesse est économique. La presse écrite quotidienne vit sous perfusion et les radios et télévisions évoluent les yeux rivés sur le taux d’audience dont dépendent leurs recettes publicitaires. Ils sont donc sensibles aux effets d’image et aux réactions du public.
– Utiliser son pouvoir de sanction
Ce dernier doit apprendre à exercer son pouvoir de sanction. Ceci veut dire, notamment, que les leaders de mouvement d’opinion ne doivent pas hésiter à dénoncer publiquement les traitements tronqués d’information de tel ou tel média ou journaliste et d’inciter leurs sympathisants à réagir par la protestation écrite ou verbale et l’abstention.
Michel Denisot a perdu son poste de patron du Grand Journal, après que son émission eut chuté de plus de 13 points d’audience sur la dernière saison. L’explication officielle est le renforcement de la concurrence sur les autres antennes, mais il est fort probable que beaucoup de téléspectateurs aient lâché l’émission phare de Canal+ parce qu’ils n’en pouvaient plus de l’arrogance bobo de la chaîne.
La bonne conscience gauchisante de Libé semble également faire de moins en moins recette puisque le titre a vu ses ventes en kiosque s’effondrer de 40% en une année.
Cette pression citoyenne devra également s’exercer de manière de plus en plus directe sur les médias, avec des manifestations à l’extérieur, voire à l’intérieur, de leurs locaux en fonction du degré de partialité ou d’agressivité qu’ils auront déployé. Là encore, toutes les formes de manifestation sont à envisager en fonction des circonstances. Le temps de l’imagination subversive est venu pour les dissidents.
Enfin, les personnalités engagées dans le débat public qui se confrontent à la partialité du Système médiatique doivent apprendre, dans le cadre des plateaux des médias audiovisuels, à exercer en direct leur droit de suite, en identifiant et en dénonçant les mécanismes des procédés manipulatoires dont ils sont victimes.
Il faut savoir qu’un journaliste en studio se sent vite vulnérable si son image d’impartialité est mise à mal, et qu’il évitera, autant que possible, une situation de confrontation trop directe avec son ou ses interlocuteurs.
En bref, la bonne conscience pharisienne qui caractérise la superstructure médiatique qui maintient le Système en place ne doit plus être considérée comme une fatalité naturelle ou une réalité intouchable.
En guise de conclusion…
Le combat médiatique est une affaire de longue haleine qui dépend des évolutions profondes des mentalités collectives. Il consiste à changer l’ordre des grandes représentations sociales dominantes. L’opinion publique, enjeu central de ce conflit, doit devenir un acteur critique et réactif qui témoigne de son refus de ne plus accepter l’évidence conformiste et oppressive du discours médiatique.
Les Français, les sondages le prouvent, sont prêts à entendre ce propos.
Didier Beauregard
24/06/2013
Voir : De l’art de la guerre médiatique 1/2Image : Les opposants au mariage pour tous peuvent, et doivent, relancer la dynamique de leur mouvement autour de la répression policière et de la dérive totalitaire.
* Cet article a été initialement publié le 25/06/2013, avec pour chapô originel : “En deuxième partie, Didier Beauregard dégage, sur la base de ce cas d’école qu’est devenue la Manif pour tous, les éléments d’une stratégie de communication qui permettraient, enfin, d’investir la citadelle médiatique. La défaite ponctuelle et relative de ce vaste mouvement de contestation doit devenir le creuset des victoires à venir”. Lequel constituant la seule modification apportée.
Lien permanent Catégories : actualité, élections, France et politique française, tradition 0 commentaire -
Les élections municipales, pour quoi faire ?
Extrait de la réponse de Jean-Yves La Gallou :
"[...] Entrer dans une municipalité n’a de sens que si l’on y va dans un esprit de résistance ou de reconquête. Quitte à choisir un secteur de combat et s’y consacrer et à celui-là seul ! Les terrains d’exercice et de manœuvre sont nombreux : les écoles, la culture, le patrimoine, les cantines, les subventions, les locaux municipaux, l’urbanisme, les paysages, les impôts.
Sur les écoles, s’intéresser au contenu, pas seulement aux locaux
En matière scolaire, il ne faut pas s’intéresser seulement à l’intendance mais au fond. Comment ? En fédérant les parents d’élèves qui en ont marre des dérives politiquement correctes dès le primaire. Ou en boycottant l’achat d’ouvrages de désinformation : histoire-propagande ou théorie du genre. Et puis en aidant des écoles indépendantes à trouver des locaux.
Sur les cantines, défendre l’identité culinaire régionale et nationale
Il faut refuser les interdits alimentaires étrangers ainsi que tout achat de viande halal ; et revenir à des menus plus traditionnels tout en privilégiant le localisme. Il faut retirer le contrôle des assiettes des enfants (et des personnes âgées) aux grands oligopoles de la distribution alimentaire. Former le goût et remettre du sens : proximité, produits français, plats régionaux, cochon, agriculture raisonnée ou bio, le tout servi par des entreprises locales.
Sur le patrimoine, valoriser l’identité locale
Il faut veiller sur l’entretien des bâtiments historiques et des églises, cesser de sacrifier les musées et remplacer les minables logos commerciaux par les blasons enracinés : il faut mettre les « communicants » hors d’état de nuire et faire revenir le temps des « armes de la ville » en choisissant des visuels enracinés !
Sur les fêtes, respecter les traditions et œuvrer au ré-enracinement
Chaque ville, chaque bourg, chaque village a son histoire, ses fêtes, ses traditions, sa toponymie, ses sociétés locales, tout ceci mérite d’être respecté et parfois ranimé. Les noms des places, des rues, des lieux de convivialité ne doivent pas être « idéologiques » mais enracinés dans l’histoire et la géographie locales. Les sociétés locales d’amateurs (des arts, de musique, de théâtre ou de danse, d’histoire) doivent être mieux considérées par les professionnels et les « sachants ».
Sur la culture, protéger le pluralisme et privilégier l’ « art caché » plutôt que le non-art contemporain
Vaste chantier ! Il faut rétablir la pluralité et la diversité dans les bibliothèques municipales, au cinéma, au théâtre. Sans sectarisme, bien sûr, mais aussi sans accepter le sectarisme des autres. Et cesser de céder aux sirènes ridicules du non-art contemporain. Retrouver l’ « art caché », selon la jolie expression d’Aude de Kerros.
Sur les subventions, les supprimer pour les nuisibles
Il faut taper dans la butte et cesser de subventionner les nuisibles : les syndicats politiquement corrects, les lobbys homosexualistes, antiracistes et immigrationnistes, les associations étrangères, les communautaristes musulmans (et autres), tout ce petit monde doit être mis à la diète. Qu’ils se financent avec l’argent de leurs adhérents, pas avec celui des contribuables ! L’argent des contribuables n’a pas à financer les mosquées ni les pseudos centres « culturels » islamiques (ou pentecôtistes ou israélites, d’ailleurs). [...]"
-
Les mères veilleuses à Bourg en Bresse
Les mères veilleuses sont à Bourg en Bresse jusqu'au samedi 21 septembre. Vous pouvez les rejoindre et les contacter :
meresveilleuses.bourg@jaimelafamille.info
Voici quelques échanges de ces derniers jours : une jeune femme travaillant en milieu carcéral, très réceptive au discours des mères veilleuses. Elle est consciente de l’importance de repères stables pour la construction d’un enfant et constate que la stabilité d’une famille est le meilleur antidote face à la délinquance. Elle manifeste de l’intérêt sur l'explication du gender à l’école.
Deux jeunes paumés sont venus s’asseoir sur les chaises pliantes des mères veilleuses en début d’après-midi : enfants de la DASS, élevés et maltraités dans des familles d’accueil, ils ont dit avoir souffert de l’absence de père. Ils voulaient faire déplacer la pancarte, sur le passage, pour qu’elle soit encore plus visible.-
Bonne conversation avec deux jeunes en première année de droit, très conscients des enjeux.
-
Universités d'été de Génération Patriote
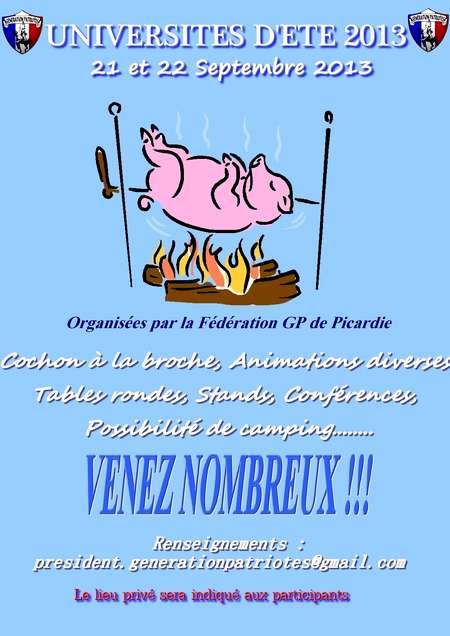
-
L’urgent besoin de la parole royale
La gravité de la situation — la dette explosera en 2014 pour atteindre 2 000 milliards d’euros — devrait mobiliser les forces vives du pays et, parmi elles, si du moins ils étaient ce qu’ils prétendent, les acteurs d’un pays légal dont l’existence n’est justifiée que par les services qu’ils sont censés rendre à la nation.
Las ! En cette rentrée, les agités du bocal politicien se préoccupent plus de consolider leurs positions — au sens militaire du terme — à l’approche d’échéances électorales importantes — municipales, européennes —, que de répondre aux inquiétudes légitimes de leurs compatriotes, qu’il s’agisse du chômage, de l’insécurité ou de la cohésion sociale, mise à mal aussi bien par une immigration galopante encouragée par le pouvoir que par l’adoption progressive de lois dites sociétales. Certes, la plupart des maux qui touchent la France ont une dimension européenne, voire planétaire : ainsi la remise en cause anthropologique de nos sociétés touche aussi bien ces paradis conservateurs que sont l’Allemagne (ou une mère peut désormais se déclarer père de son enfant) et le Royaume-Uni (où ce fut une « conservatrice », Thatcher, qui milita furieusement pour « le droit à l’avortement » avant qu’un « conservateur », Cameron, n’y légalise le mariage homo) que la France sociétaliste : nous avons affaire à une tendance lourde qui prouve combien, en quarante-cinq ans, l’idéologie soixante-huitarde a pu disséminer ses métastases chez des élites en voie de mondialisation.
Tout indique pourtant que nous arrivons à une fin de cycle. Et c’est la France qui, après avoir ouvert à plusieurs reprises le chemin des révolutions — 1789, 1830, 1848, 1968 —, semble devoir indiquer celui de la contre-révolution. Oh, certes, il s’agit encore de frémissements qui peinent à trouver une traduction politique, mais l’imposante réaction du pays réel contre la destruction de la famille, au printemps dernier, les manifestations récentes de soutien de ce même pays réel à un bijoutier qui, d’agressé, se trouve transformé, par un tour de passe-passe judiciaire, en agresseur, alors que son braqueur, qui n’a fait qu’assumer les risques du métier, devient dans le même temps la victime, montrent combien les Français sont de moins en moins dupes. Oui, l’inversion des valeurs est de plus en plus mal supportée par des citoyens qui n’acceptent plus de devoir marcher sur la tête. Taubira sert de révélateur, au sens chimique du terme, quand Valls, qui n’est pas, quoi qu’il en dise, une « chance pour la France », joue le rôle, endormeur, du faux homme d’ordre : il est en ce sens bien plus dangereux que Taubira, même si, fort heureusement, il fait de moins en moins illusion.
Ce désir d’ordre du peuple français, les politiciens, et François Fillon le premier d’entre eux, le traduisent comme un « virage à droite » de leurs concitoyens — habitués qu’ils sont à tout interpréter à travers le prisme déformant de leurs médiocres préoccupations électorales. Or il est bien davantage que cela : il est avant tout le désir de recouvrer les valeurs pérennes sur lesquelles repose toute société qui veut persévérer dans l’être. Alors que la liberté, l’égalité et la fraternité républicaines finissent de dissoudre les solidarités sociales au nom de l’égale valeur — encore appelée laïcité — de toutes les revendications individualistes et communautaristes, ce sont à d’autres valeurs que, toutes générations confondues, se réfèrent ceux qui, aujourd’hui, soutiennent le bijoutier agressé ou qui, au printemps dernier, se sont opposés au mariage contre-nature. C’est au travail, qu’agressent, tout autant que les braqueurs, des mondialistes dont les armes sont les délocalisations et l’immigration, c’est à la famille, condition du développement de la personne, c’est à la nation, dont la famille est la base — ce ne sont pas d’insipides drapeaux arc-en-ciel mais bien des drapeaux français que brandissaient les défenseurs du mariage —, une nation qui se trouve par ailleurs agressée par ces naturalisations à la pelle auxquelles Valls, encore lui, veut procéder, après Sarkozy qui les avait tardivement interrompues par électoralisme. Or la nation est cette amitié essentielle dont la pérennité suppose le consentement des volontés individuelles à un ensemble partagé de devoirs, fondements des droits — nous sommes des « nous » avant d’être des « je », aimait à rappeler Maurras —, un ensemble que le triomphe définitif du chaos mondialiste ferait voler en éclats. Oui, si le pays réel se réveille, c’est qu’il a conscience de jouer sa survie.
 Nul doute qu’en fragilisant le cordon sanitaire imposé par Mitterrand, il y a trente ans, Fillon n’ait eu à l’esprit ce retournement de tendance. Assurément, sa préoccupation est d’endiguer la montée du Front National à la fois en se conciliant les électeurs de Marine Le Pen et en se montrant à l’écoute de ces adhérents et électeurs de l’UMP qui ne comprennent plus l’objet de ce tabou imposé par les socialistes, au siècle dernier, à la droite libérale. Fillon a cherché à prendre une longueur d’avance dans la perspective des primaires de 2016 sur ses concurrents de l’UMP — et ils sont nombreux —, ne serait-ce qu’en les forçant à se positionner par rapport à lui. Il avait du reste bien choisi son moment : la veille de l’UDT du Front National.
Nul doute qu’en fragilisant le cordon sanitaire imposé par Mitterrand, il y a trente ans, Fillon n’ait eu à l’esprit ce retournement de tendance. Assurément, sa préoccupation est d’endiguer la montée du Front National à la fois en se conciliant les électeurs de Marine Le Pen et en se montrant à l’écoute de ces adhérents et électeurs de l’UMP qui ne comprennent plus l’objet de ce tabou imposé par les socialistes, au siècle dernier, à la droite libérale. Fillon a cherché à prendre une longueur d’avance dans la perspective des primaires de 2016 sur ses concurrents de l’UMP — et ils sont nombreux —, ne serait-ce qu’en les forçant à se positionner par rapport à lui. Il avait du reste bien choisi son moment : la veille de l’UDT du Front National.Une UDT dont on doit retenir cette heureuse précision de Marine Le Pen sur la laïcité, au lendemain de la publication par Peillon d’une charte dont « le texte [...] ne prend pas en compte la réalité de l’histoire de France, la réalité de notre culture. Pour comprendre la nation française, la République française, il faut connaître et admettre ses fondements chrétiens. N’en déplaise à certains. » Le malheur, c’est que c’est la république elle-même qui a, dès l’origine, renié ces « fondements chrétiens », empêchant de « comprendre la nation française ».
Nous n’en approuvons pas moins cette prise de position sans aucune ambiguïté de Marine Le Pen sur le lien indissoluble entre la France et le christianisme. Si la laïcité a un sens, il se trouve là, dans ce rapport entre une nation et une religion, catholique pour ne pas la nommer, qui est la seule à respecter, tout en le fondant, l’autonomie de l’ordre politique. Du reste, seules des sociétés chrétiennes ou imitant la séparation chrétienne des pouvoirs, ont vu l’émergence, pour le meilleur et pour le pire, de la notion de laïcité.
Mais justement, les attaques incessantes contre la France, contre son être et son peuple, d’un pays légal sans attache nationale, ne rendent encore que plus cruel le besoin de la parole royale. Elle seule, parce que dégagée de toute préoccupation politicienne, est à même de rappeler l’essentiel. « Je représente les principes qui rendront à l’Etat la plénitude de l’impartialité, de l’indépendance et de la stabilité. Français, ou l’autorité et les libertés de la monarchie, ou l’oppression de l’anarchie socialiste. Ces grandes vérités politiques ne dépendent ni de vous ni de moi. Lorsque j’en ai reçu la garde, avec la vie, pour les transmettre intactes à mon fils, j’ai hérité aussi du devoir de les rappeler à la nation française et, s’il plaît à Dieu, quand il le faudra, je les appliquerai au gouvernement du pays en utilisant le concours des Français de toutes origines et de toutes conditions librement organisés et représentés. »
Ces fortes paroles de Jean III datent du 30 janvier 1933 : elles n’ont pas pris une ride.
François Marcilhac - L’AF 2870


