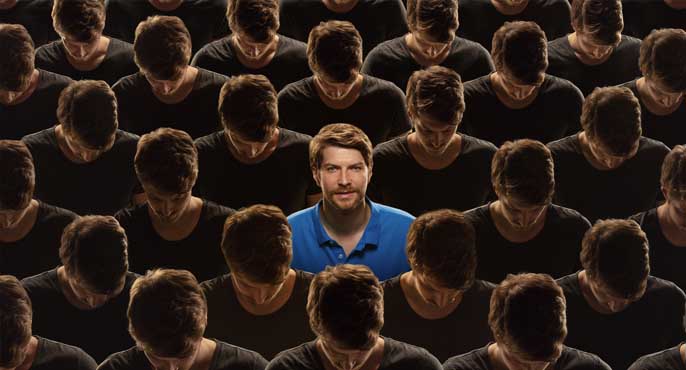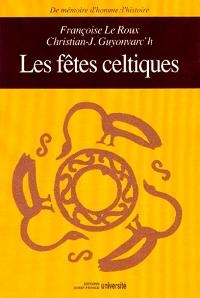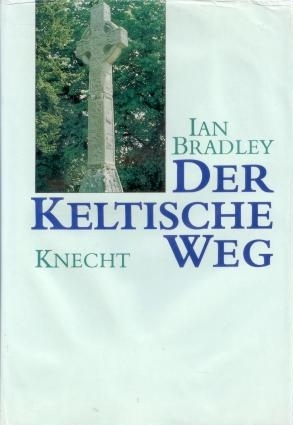Dans la quatorzième livraison de la revue bimensuelle des Diipetes (Athènes, Grèce), un article de Thomas Mastakouri puise inspiration dans la figure du Héros de nos sociétés européennes antiques. Les idées développées par l'auteur, tout en étant discutables de par un certain romantisme de la révolte, ont cependant le mérite de nous interpeller et nous invitent à une réflexion critique sur ce que peut vouloir encore dire héroïcité. Ce que nous avons à réaliser est aussi d'une certaine façon ce que nous avons à transmettre, c'est bien là la seule source de grandeur et c'est pourquoi Boileau rappelait à juste titre qu'« on peut être héros sans ravager la terre ».