Les leçons d’Aristote, philosophe moral et politique (laissons de côté ici l3e naturaliste) ne sont pas caduques. Elles doivent bien entendu être lues et comprises dans leur contexte. Mais leurs principes restent en bonne part actuels. Rappels d’une doctrine.
La notion de cité est déterminante dans la philosophie politique d’Aristote. Quelle forme prend cette détermination ? Pour Aristote l’appartenance à la cité précède et en même temps influe de manière décisive sur la définition de sa philosophie politique, c’est-à-dire du bien en politique. En d’autres termes, l’hypothèse préalable d’Aristote à l’élaboration même de sa pensée politique, c’est que l’existence d’un monde commun, un monde qui s’incarne dans la cité, précède la définition du bien commun et le conditionne. Pour comprendre ce cheminement, nous verrons d’abord ce que veut dire « la cité » pour Aristote (I). Nous examinerons quelle conception il en a. Nous verrons ensuite (II) comment la pensée politique d’Aristote prend place dans son analyse de la pratique (praxis).
La philosophie pratique est pour Aristote la « philosophie des choses humaines ». C’est donc la philosophie de la politique. La pensée aristotélicienne suppose un monde commun, la notion de cité et d’appartenance à la cité. Politikonvient de polis. L’étymologie de politique renvoie à la cité. La pensée d’Aristote n’est jamais une pensée hors sol. Elle part de la cité pour chercher le bien de la cité.
Une communauté d’hommes libres
I - La cité (en grec polis) est un Etat avant d’être une ville. Mais c’est aussi une communauté d’hommes libres avant d’être un Etat. C’est une communauté de citoyens libres qui partagent la même histoire, les mêmes héros, les mêmes dieux, les mêmes rites et les mêmes lois. Fustel de Coulanges a souligné l’importance de la religion dans la fondation des cités (La cité antique, 1864). Ainsi, chaque cité grecque a un panthéon différent. La cité en tant que polis n’est pas d’abord une donnée spatiale. Mais il se trouve que (a fortiori dans un paysage accidenté comme celui de la Grèce, ou de la Grande Grèce [Sicile]), la cité correspond aussi à un lieu déterminé, à une géographie particulière. Cette communauté de citoyens dans un lieu particulier, c’est une communauté politique souveraine au côté d’autres communautés politiques, rivales, alliées ou ennemis.
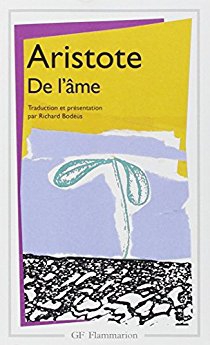 « Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).
« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).
Dans Politiques (nous nous référerons à la traduction de Pierre Pellegrin, Garnier Flammarion, 1990), Aristote s’attache à déterminer quels doivent être les rapports des hommes entre eux. C’est là le cœur de la politique. Cela ne concerne que les hommes qui vivent dans un cadre politique, c’est-à-dire dans une cité. Les Barbares sont donc exclus et, à l’intérieur même de la cité, les esclaves et les femmes. Les Barbares sont certes, tout comme les esclaves et les femmes, des êtres rationnels, mais ce ne sont pas des êtres politiques.
Que sont les êtres politiques au sens grec ? Si l’homme possède le langage, et pas seulement la voix, c’est qu’il est destiné à vivre en société. Par le langage, l’homme peut se livrer au discours et à la délibération. Aristote explique cela ainsi : « § 10. […] la parole est faite pour exprimer le bien et le mal, et, par suite aussi, le juste et l'injuste ; et l'homme a ceci de spécial, parmi tous les animaux, que seul il conçoit le bien et le mal, le juste et l'injuste, et tous les sentiments de même ordre, qui en s'associant constituent précisément la famille et l'État. § 11. On ne peut douter que l'État ne soit naturellement au-dessus de la famille et de chaque individu ; car le tout l'emporte nécessairement sur la partie, puisque, le tout une fois détruit, il n'y a plus de parties, plus de pieds, plus de mains, si ce n'est par une pure analogie de mots, comme on dit une main de pierre ; car la main, séparée du corps, est tout aussi peu une main réelle. […] § 12. Ce qui prouve bien la nécessité naturelle de l'État et sa supériorité sur l'individu, c'est que, si on ne l'admet pas, l'individu peut alors se suffire à lui-même dans l'isolement du tout, ainsi que du reste des parties ; or, celui qui ne peut vivre en société, et dont l'indépendance n'a pas de besoins, celui-là ne saurait jamais être membre de l'État. C'est une brute ou un dieu. » Or chacun comprendra que les brutes sont plus courantes que les dieux.
Aristote poursuit : « § 13. La nature pousse donc instinctivement tous les hommes à l'association politique. Le premier qui l'institua rendit un immense service ; car, si l'homme, parvenu à toute sa perfection, est le premier des animaux, il en est bien aussi le dernier quand il vit sans lois et sans justice. […]. Sans la vertu, c'est l'être le plus pervers et le plus féroce ; il n'a que les emportements brutaux de l'amour et de la faim. La justice est une nécessité sociale ; car le droit est la règle de l'association politique, et la décision du juste est ce qui constitue le droit » (Politiques I, 1253a).
Mais, comment vivre bien en société, c’est-à-dire en fonction du bien ? Comment faire ce qu’ordonne la vertu ? « Comment atteindre à ce noble degré de la vertu de faire tout ce qu’elle ordonne » (Politiques, IV, 1, 6).
Comment s’incarne cette recherche de la vertu ? Aristote voyait pour la cité trois types de constitutions possibles : la monarchie, l’aristocratie, le gouvernement constitutionnel (politeia) ou république. Le premier type, la monarchie, est le gouvernement d’un seul, qui est censé veiller au bien commun. Le deuxième type, l’aristocratie est censée être le gouvernement des meilleurs. Le troisième type, le gouvernement constitutionnel, ou encore la république, est censé être le gouvernement de tous.
Ces trois régimes ont leur pendant négatif, qui représente leur dévoiement. Il s’agit de la tyrannie, perversion de la monarchie, de l’oligarchie (gouvernement de quelques-uns) comme dévoiement de l’aristocratie, de la démocratie comme perversion du gouvernement constitutionnel (Politiques, III, 7, 1279a 25). « Aucune de ces formes ne vise l’avantage commun » conclut Aristote.
 Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populismeet Le retour du peuple. An I ?)
Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populismeet Le retour du peuple. An I ?)
Pour Aristote, la politique est un savoir pratique. Il s’agit de faire le bien. Dans la conception aristotélicienne de la cité, tout le monde est nécessaire mais tout le monde ne peut être citoyen. Seul peut être citoyen celui qui n’est pas trop pris par des tâches utiles. « Le trait éminemment distinctif du vrai citoyen, c’est la jouissance des fonctions de juge et de magistrat » (Politiques, II, 5, 1257a22). Le paysan et l’artisan ne peuvent être citoyens, pas plus que le commerçant.
L’esclavage, qui n’était pourtant pas très ancien dans la Grèce antique, est justifié par Aristote. Il permet aux citoyens de s’élever au-dessus de certaines tâches matérielles. « Le maître doit autant que possible laisser à un intendant le soin de commander à ses esclaves, afin de pouvoir se livrer à la vie politique ou à la philosophie, seules activités vraiment dignes d'un citoyen » (Politiques, I, 2, 23). La vision qu’a Aristote de la société est incontestablement hiérarchique.
Toutefois, l’inégalitarisme d’Aristote n’empêche pas qu’il défende l’idée d’un minimum à vivre pour tous. « Aucun des citoyens ne doit manquer des moyens de subsistance » (Politiques, VII, 10, 1329a). Ce point de vue est logique car Aristote définit le but de la communauté comme « la vie heureuse » : « Une cité est la communauté des lignages et des villages menant la vie heureuse c’est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique. Il faut donc poser que c'est en vue des belles actions qu'existe la communauté politique, et non en vue de vivre ensemble ». (Politiques, III, 9, 6-15).
Le bonheur de la cité et l’autarcie sont donc liés. L’autarcie est l’une des conditions du bonheur, et un signe du bonheur. Cela, qui est notre cité, est limité et cela est bien, justement parce que ce qui est bien tient dans des limites. Que nous disent les limites ? Que le bien a trouvé sa place. Qu’il est à sa place. Cette notion d’autosuffisance ou encore d’autarcie s’oppose à un trop grand pouvoir des commerçants, c’est-à-dire de la fonction marchande. C’est aussi une vision hiérarchique où sont respectées les diversités et les inégalités, car si toutes les diversités ne sont pas des inégalités, beaucoup le sont.
La question de la taille de la cité n’est pas un détail dans la pensée d’Aristote. Elle fait partie du politique, comme le remarque Olivier Rey (dans Une question de taille, Stock, 2014). « Une cité première, note Aristote, est nécessairement celle qui est formée d’un nombre de gens qui est le nombre minimum pour atteindre l’autarcie en vue de la vie heureuse qui convient à la communauté politique [...]. Dès lors, il est évident que la meilleure limite pour une cité, c’est le nombre maximum de citoyens propre à assurer une vie autarcique et qu’on peut saisir d’un seul coup d’œil. » (Politiques, VII). En d’autres termes, dès que l’autarcie est possible, la cité doit cesser de grandir.
Ni trop petite ni trop grande, telle doit donc être la cité. C’est le concept de médiété que l’on retrouve ici. La cité doit être comprise entre 10 et 100 000 habitants, précise Aristote (Ethique à Nicomaque, IX, 9, 1170 b 31). Il est évident que 10 est un chiffre que l’on ne doit pas prendre au premier degré. Aristote veut dire que la population de la cité doit au moins excéder une famille, qu’elle est toujours autre chose et plus qu’une famille. L’idée d’un maximum d’habitants est la plus importante à retenir. Etre citoyen n’est plus possible pour Aristote dans une cité trop grande, trop peuplée. Et il semble bien que le chiffre de 100 000 habitants soit l’ordre d’idée à retenir. (On notera que les circonscriptions françaises pour les députés étaient à l’origine de la IIIe République de 100 000 habitants. Un vestige des conceptions d’Aristote ?). En résumé, Aristote rejette le gigantisme.
Rappelons ce qu’Aristote dit de la vertu majeure de médiété. « Ainsi donc, la vertu est une disposition à agir d'une façon délibérée, consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée et comme la déterminerait l'homme prudent. Mais c'est une médiété entre deux vices, l'un par excès et l'autre par défaut ; et c'est encore une médiété en ce que certains vices sont au-dessous, et d'autres au-dessus de "ce qu'il faut" dans le domaine des affections aussi bien que des actions, tandis que la vertu, elle, découvre et choisit la position moyenne. C'est pourquoi, dans l'ordre de la substance et de la définition exprimant la quiddité, la vertu est une médiété, tandis que dans l'ordre de l'excellence et du parfait, c'est un sommet » (Ethique à Nicomaque, II, 6, 1106b7-1107a8). Disons-le autrement : la vertu est l’absence d’excès, ni excès de prudence qui serait alors timidité peureuse ni excès de témérité, qui serait hardiesse inconsciente, et cette façon de s’écarter des excès est une excellence. Pour la cité, le principe est le même : il s’agit de suivre une ligne de crête entre les excès que serait une trop petite et une trop grande taille. En tout état de cause, la question de la bonne taille est importante. Du reste, on ne peut remédier à une trop grande taille par la fermeture des frontières. Selon Aristote, il ne suffirait pas « d’entourer de remparts » tout le Péloponnèse pour en faire une cité (Politiques, III, 1, 1276a). Il faut éviter la démesure. Après, il est trop tard.
C’est parce qu’elle est parfaitement adaptée à elle-même que la cité tend par nature à l’autarcie. Sa finitude est sa perfection. « Cette polis représente la forme la plus haute de la communauté humaine », note Hannah Arendt (La politique a-t-elle encore un sens ? L’Herne, 2007). Néanmoins, la coopération, l’association entre cités est possible. C’est l’isopolitéia, le principe d’une convention ou encore association entre cités dont l’un des aspects était souvent le transfert de populations pour rétablir les équilibres démographiques (cf. Raoul Lonis, La cité dans le monde grec, Nathan, 1994 et Armand Colin, 2016). Exemple : Tripoli veut dire « association de trois cités ».
II – Comment la politique s’inserre-t-elle dans ce qu’Aristote appelle praxis ? Et quelles conséquences peut-on en tirer sur la cité ?
Praxis, technique et production
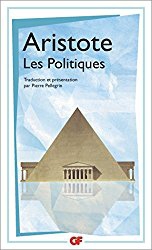 Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.
Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.
Praxis et poiesis sont proches sans se confondre. La production (poiesis) est inclue dans la pratique (praxis). C’est parce que nous travaillons de telle façon que nous produisons tel type de choses. Mais tout en étant inclue, elle s’y oppose. En effet, la pratique trouve sa fin en elle-même, elle n’a pas besoin de se justifier par une production, par un objet produit, une œuvre produite. La pratique est liée à notre être propre.
Pour le dire autrement, la production est une action, mais toute action n’est pas une production. Certaines pratiques ne sont pas des productions. Elles n’ont pas pour objet une œuvre comme produit. Un exemple est celui de la danse.
Une production a par contre sa fin à l’extérieur d’elle-même : travailler pour construire une chaise, ou un attelage de chevaux, par exemple. En outre, ce qui relève de la production mobilise aussi la techné, l’art des techniques. Avec la poiesis, il s’agit de produire quelque chose d’extérieur à soi, ou d’obtenir un résultat extérieur à soi (par exemple, réaliser un bon chiffre d’affaire pour un commerçant). Par opposition à cela, la pratique ou praxis possède en elle-même sa propre fin. Elle est en ce sens supérieure à la production. Ainsi, bien se conduire, qui est une forme de praxis, est une activité immanente à soi.
L’enjeu de la praxis est toujours supérieur à celui de la poiesis. Le but ultime de la praxis, c’est le perfectionnement de soi. Ce qui trouve en soi sa propre fin est supérieur à ce qui trouve sa fin à l’extérieur de soi.
Or, qu’est-ce qui relève de l’action hors la production ? Qu’est-ce qui relève de la praxis ? C’est notamment l’éthique et la politique. Les deux sont indissociables. Ce sont des domaines de la pratique. Là, il s’agit moins de chercher l’essence de la vertu que de savoir comment pratiquer la vertu pour produire le bien commun. « L’Etat le plus parfait est évidemment celui où chaque citoyen, quel qu’il soit, peut, grâce aux lois, pratiquer le mieux la vertu, et s’assurer le plus de bonheur. » (Politiques, IV, 2, 1324b). L’ordre social et politique optimum est celui qui permet la pratique de la vertu, qui travaille ainsi à atteindre le bien commun. C’est ce qui permet le bonheur des hommes dans la cité.
Si la vertu politique ne se confond pas avec la philosophie, les deux se nourrissent réciproquement. En recherchant la sagesse, l’homme arrive à la vertu, qui concerne aussi bien l’individu que l’Etat et est nécessaire dans les deux cas. En effet, la politique est « la plus haute de toutes les sciences » (Politiques, III, 7).
Comment pratiquer la vertu ? Est-ce une question de régime politique ? Qu’il s’agisse de monarchie, d’aristocratie ou de république (régime des citoyens), tous ces régimes peuvent être bons selon Aristote selon qu’ils modèrent les désirs extrêmes et sont animés par la vertu. La politique a des conditions en matière de morale et en matière d’éducation. Dans le même temps, il n’y a pas de morale (ou d’éthique) ni d’éducation qui n’ait de conséquences politiques. Les deux se tiennent. (Platon, ici d’accord avec Aristote, avait souligné que la politique était avant tout affaire d’éducation, d’expérience et de perfectionnement de soi).
En tout état de cause, le collectif, le commun doit primer sur l’individuel. En matière d’éducation, c’est l’Etat qui doit enseigner ce qui est commun, la famille assurant l’éducation dans le domaine privé. « C’est une grave erreur de croire que chaque citoyen est maitre de lui-même ; chacun appartient à l’Etat. » (Politiques, V, 1, 2) (Mais l’Etat n’est pas un lointain, c’est un proche car nous avons vu que les cités avec des populations de grande taille sont proscrites).
La philosophie d’Aristote n’est pas égalitariste, avons-nous déjà noté : chacun a sa place et sa fonction. Pierre Pellegrin résume cela en expliquant que pour Aristote « chacun doit recevoir proportionnellement à son excellence ». Aristote ne pense pas que les hommes soient tous les mêmes même si « tous les hommes pensent que la vie heureuse est une vie agréable » (Ethique à Nicomaque,1153b15), et que le bonheur est ce « qui est conforme à la vertu la plus parfaite, c'est-à-dire celle de la partie de l'homme la plus haute » (Ethique à N., X, 7).
La justice, c’est que chacun fasse ce qu’il doit faire en allant vers la perfection dans sa fonction. Le bien suprême, le bonheur (eudaimonia) des hommes consiste dans la pleine réalisation de ce qu’ils sont dans la société. Il y a chez Aristote un lien permanent entre justice et politique d’une part, morale et éducation d’autre part. Ce lien consiste à faire prévaloir en nous la partie rationnelle de notre âme sur la partie irrationnelle.
Les idées d’Aristote sont toutes conçues par rapport à la cité. C’est à la fois leur limite et leur force. Aristote suppose un préalable à toute pensée politique. C’est l’existence d’un monde commun, une cité commune, un peuple commun. Le bien commun, c’est la justice, et la condition de la justice, c’est l’amitié (philia). « La justice ira croissant avec l’amitié » (Ethique à Nicomaque, VII, 11).
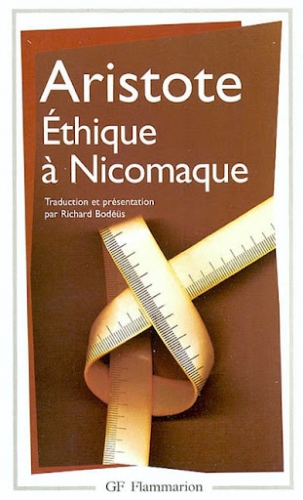 L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).
L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).
La politique est donc affaire de contexte – ce qui est une autre façon de parler de monde commun : « il ne faut pas seulement examiner la meilleure organisation politique, mais aussi celle qui est possible » (Politiques, IV, 1, 1288b).
Pour Aristote, l’homme n’entre jamais en politique en tant qu’homme isolé. Il porte toujours un monde, qui est celui des siens, celui de sa cité. Après avoir expliqué que la cité vise naturellement l’autarcie, c’est à dire le fait de se suffire à soi, Aristote explique : « Il est manifeste […] que la cité fait partie des choses naturelles et que l’homme est un animal politique et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard des circonstances, est soit un être dégradé soit un être surhumain, et il est comme celui qui est injurié en ces termes par Homère : ’’sans lignage, sans foi, sans foyer’’ (...). Il est évident que l'homme est un animal politique plus que n'importe quelle abeille et que n'importe quel animal grégaire. Car, comme nous le disons, la nature ne fait rien en vain ; et seul parmi les animaux l'homme a un langage » (Politiques, I, 2, 1252a).
La cité d’Aristote n’existe pas que pour satisfaire les besoins. En visant la vie heureuse, qui est un objectif collectif même s’il concerne chacun, elle condamne l’individualisme et met au premier plan l’amitié. Celle-ci n’est pas une affaire privée mais une affaire publique. La vie heureuse est l’affaire de tous et c’est un projet pour tous. Elle est ce qui anime une cité dans laquelle règne la justice. « Il n’y a en effet qu’une chose qui soit propre aux hommes par rapport aux autres animaux : le fait que seuls ils aient la perception du bien, du mal, du juste, de l’injuste et des autres notions de ce genre. Or, avoir de telles notions en commun, c'est ce qui fait une famille et une cité. » (Politiques, I, 2, 1253a8). L’individu seul pourrait ne viser que son plaisir. La cité le pousse à dépasser sa subjectivité pour se hisser vers la recherche du bien commun.
Pierre Le Vigan.
Pierre Le Vigan est écrivain. https://www.amazon.fr/-/e/B004MZJR1M
Son dernier livre est Métamorphoses de la ville. Disponible en Format numérique ou broché
https://www.amazon.fr/M%C3%A9tamorphoses-ville-Romulus-Co...
http://euro-synergies.hautetfort.com/



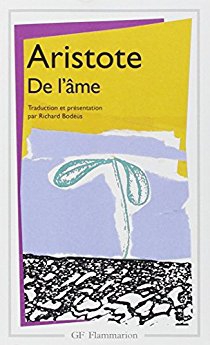 « Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).
« Il est donc manifeste que la cité n'est pas une communauté de lieu, établie en vue de s'éviter les injustices mutuelles et de permettre les échanges. Certes, ce sont là des conditions qu'il faut nécessairement réaliser si l'on veut qu'une cité existe, mais quand elles sont toutes réalisées, cela ne fait pas une cité, car [une cité] est la communauté de la vie heureuse, c'est-à-dire dont la fin est une vie parfaite et autarcique pour les familles et les lignages » (Politiques, III, 9, 6-15).  Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populismeet Le retour du peuple. An I ?)
Notons que la démocratie est, pour Aristote, le gouvernement des plus pauvres, à la fois contre les riches et contre les classes moyennes. Le terme « démocratie » est ainsi pour Aristote quasiment synonyme de démagogie. (Cela peut choquer mais nos élites n’ont-elles pas la même démarche en assimilant toute expression des attentes du peuple en matière de sécurité et de stabilité culturelle à du « populisme », terme aussi diabolisateur que polysémique, comme l’a montré Vincent Coussedière dans Eloge du populismeet Le retour du peuple. An I ?) 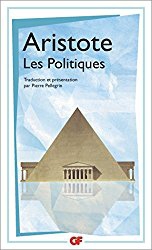 Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.
Dans la philosophie d’Aristote, on rencontre plusieurs domaines : la theoria (la spéculation intellectuelle, ou contemplation), l’épistémé (le savoir), la praxis (la pratique) et la poiesis (la production, qui est précisément la production ou la création des œuvres). Nous avons donc quatre domaines. La theoria c’est, à la fois, ce que nous voyons et ce que nous sommes. L’epistémé, c’est ce que nous pouvons connaitre. La poiesis, c’est ce que nous faisons. La praxis, c’est comment nous le faisons.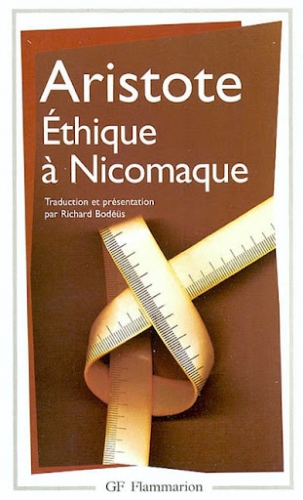 L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).
L’amitié n’est pas le partage des subjectivités comme dans le monde moderne, c’est autre chose, c’est l’en-commun de la vertu. « La parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont semblables en vertu. » (Ethique à Nicomaque, VIII, 4, 1156 b, trad. Jules Tricot). Hannah Arendt a bien vu cela. Elle rappelle que l’amitié n’est pas l’intimité mais un discours en commun, un « parler ensemble » (Vies politiques, 1955, Gallimard, 1974). « Pour les Grecs, l’essence de l’amitié consistait dans le discours », écrit Hannah Arendt. Le monde commun créé par le partage de l’amitié implique un sens commun du monde et des choses, comme l’avait vu aussi Jan Patocka (Essais hérétiques sur la philosophie de l’histoire, Verdier, 1981). L’amitié contribue à la solidité de la cité. « Toute association est une parcelle de la cité » (« comme des parcelles de l’association entre des concitoyens »). Le principe de l’amitié n’est pas véritablement différent de celui de la politique. Il implique la justice et la vérité. « Chercher comment il faut se conduire avec un ami, c'est chercher une certaine justice, car en général la justice entière est en rapport avec un être ami » (Ethique à Eudème, VII, 10, 1242 a 20).