Communiqué de "Terre & Peuple - Wallonie"
 TERRE & PEUPLE Magazine n°70: Russie et Ukraine
TERRE & PEUPLE Magazine n°70: Russie et Ukraine
Le numéro 70 de Terre & Peuple Magazine est centré autour du thème 'Russie et Ukraine, une fracture au coeur de l'Europe'.
Pierre Vial, dans son éditorial, professe que notre mission essentielle est de dire la vérité, la loi du réel. Dans notre monde de tricheurs, dire la vérité rend libre. C'est un acte révolutionnaire de résistance aux lois liberticide, aux tabous imposés au mépris des réalités et du respect des différences, notamment les différences culturelles et raciales entre les peuples. Il est regrettable à ce propos qu'Alain de Benoist recommande : « Evitons de 'racialiser' la victoire de Trump ! »
Pierre Vial recense le dernier livre de Patrick Buisson, consacré, non pas à la présidence de Sarkozy, mais à sa critique fondamentale, afin de mieux illustrer le sujet 'La cause du peuple'. Eminence grise de ce président de la République, c'est à cette cause qu'il s'est inlassablement attaché à le convertir, pour le service du bien commun, à lui faire accepter avec la 'ligne Buisson' l'idée d'une rupture avec la ligne anti-France, celle qui met « à genoux, puis à plat ventre, puis à baiser la babouche : ce n'est jamais suffisant. » Et à lui ouvrir les yeux sur les véritables enjeux de cette guerre, qui met en question le fonds ethno-culturel et racial du peuple français. Quand il croyait l'avoir convaincu, il l'entendait, empressé de se montrer politiquement correct, déclarer au Monde : « Le métissage, c'est la volonté de vivre ensemble. Ce n'est pas la négation des identités ! » Jusqu'à la révolte des identitaires à laquelle appelle aujourd'hui Patrick Buisson : on veut leur peau, celle de leur âme.
Robert Dragan saute sur l'occasion de re-fusiller Jean-Paul Demoule, l'archéologue qui, sans être lui-même linguiste, s'est mêlé de contester, dans son livre 'Mais où sont passés les Indo-Européens ?', la réalité d'une origine commune aux langues européennes vivantes ! Cette occasion est l'exécution en règle de Demoule dans la revue d'études indo-européennes WEKwOS, laquelle l'accuse d'ignorer délibérément les dernières synthèses scientifiques et de s'en tenir à la science du XIXe siècle !
Le même Robert Dragan enchaîne, dans sa tâche de justicier, en tordant le cou à l'accusation de voltairianisme qui, dans les milieux patriotes, est proférée à l'encontre des païens, lesquels fondent pourtant leur identité sur la communauté du peuple avec le peuple. Alors que Voltaire, comme nombre de philosophes des Lumières, affecte pour le peuple un souverain mépris. Le portrait, documenté, qu'il campe de Voltaire est dévastateur. Notamment sa détestation pour Rousseau, contre qui il portera plainte devant des juges suisses, réclamant qu'on le punisse « capitalement » ! Il l'écrit à d'Alembert : « Jean-Jacques sera charmé qu'on le pende, pourvu qu'on mette son nom dans la sentence. »
Pierre Vial salue la réapparition du Crapouillot qui, pour sa résurrection, a choisi de déshabiller les clowns désabusés de EELV (Europe-Ecologie-Les Verts), pour la plupart des arrivistes étrangers à la nature et dont des marchands ont récupéré les bons slogans. Mathilde Gibelin les avertit que la révolution est en marche et qu'ils ont des comptes à lui rendre.
Roberto Fiorini, présentant le dossier Russie-Ukraine, rappelle que son importance pour notre avenir ne doit pas nous faire perdre de vue que nous sommes sans prise sur l'événement et que c'est ici que se mène le combat pour notre survie. La Russie nous procure un modèle dont s'inspirer, voire des opportunités à exploiter, mais elle n'est pas le vecteur de notre salut, lequel ne tient qu'à nous.
Alain Cagnat présente un relevé détaillé de l'histoire de l'Ukraine, depuis les Varègues, colonisateurs Vikings qui, dès le VIe siècle, rejoignent, par les voies d'eau la Mer Baltique à la Mer Noire et fondent Novgorod et Kiev, jusqu'à la guerre civile actuelle fomentée par les ong 'humanitaires' de Soros et autres, en passant par les vagues d'invasions, Tatars, Mongols, Lituaniens, Polonais, Ottomans, et les réactions, les Cosaques et les grands tsars, Pierre Ier et Catherine II. Il conclut : « Que ressort-il de tout ceci ? Que Kiev est le berceau de la Russie. Que Russes et Ukrainiens ne forment en réalité qu'un même peuple. Et que l'Ukraine est, comme tant d'autres pays, instrumentalisée par les Anglo-Saxons dans leur tentative de contrôler le monde. »
Pour Jean-Patrick Arteault, la guerre civile larvée qui ronge depuis près de trois ans l'Ukraine est une guerre régionale, qui oppose la Russie et l'Union européenne, et une guerre mondiale, qui oppose l'occidentalisme américano-centré et le souverainisme eurasiatique. C'est un conflit interne entre deux peuples frères, compliqué par des ingérences externes. Le nom de l'Ukraine, qui signifie marche frontalière, lui a été donné par ses voisins au long d'une histoire fournie en fluctuations territoriales, jusqu'au démembrement de l'URSS, en 1991. La victoire de 1945 lui a procuré des gains territoriaux sur des zones historiquement autrichiennes ou polonaises parlant ukrainien, à côté de zones historiquement russes parlant ukrainien, de zones parlant russe mais à forte majorité d'Ukrainiens et de zones à majorité de Russes. La Crimée, conquise sur les Ottomans par Catherine II est alors peuplée massivement de Russes ethniques. La fragmentation est également culturelle et religieuse. La décision, lors de la pseudo-révolution du Maïdan en 2014, de retirer au russe son statut de langue officielle a mis le feu aux poudres. Aux élections présidentielles de 2010, la pro-occidentale ultra-corrompue Ioulia Tymochenko a été largement battue par le pro-russe Ianoukovitch, contre qui les occidentaux (notamment Bernard-Henry Levy et Georges Soros) ont alors déclenché le coup d'état. Dans ce pays, les facteurs de division ne manquaient pas, notamment la mémoire de l'Holodomor, la famine organisée par les bolcheviques, pour l'essentiel des commissaires politiques juifs, qui fit des millions de morts. Dans la 'Grande Guerre Patriotique' de 1941-1945, les Ukrainiens non-russophones s'en trouvèrent plus motivés à combattre aux côtés des Allemands. La guerre civile dans le Donbass n'a pas été déclenchée à l'initiative de la Russie, mais du nouveau pouvoir de Kiev, qui s'inscrit dans la stratégie de l'Amérique d'empêcher, pour réaliser sa fameuse 'destinée manifeste', l'empire russe d'accéder aux mers libres.
Robert Dragan rappelle que, à l'issue de la première guerre mondiale, la résistance victorieuse de la Pologne à l'armée des soviétiques lui a permis de s'approprier un cinquième de l'Ukraine, le reste de cette région de l'empire des tsars subissant par la suite un sort particulièrement atroce, du fait à la fois de la résistance des paysans ukrainiens à la collectivisation des terres et à la présence dans le pays d'une forte minorités de Juifs (lesquels avaient même constitué jusqu'alors une nationalité à part). Les récoltes sont réquisitionnées (semences comprises), par priorité pour l'exportation, et les récalcitrants sont punis avec une sauvage sévérité (la déportation ou pire). Il s'ensuit une famine épouvantable, qui a fait plus de six millions de morts, dont d'innombrables enfants. L'opération, qualifiée de Holodomor, est attribuée par la population aux Juifs qui, il est vrai, constituent l'essentiel des commissaires et policiers politiques communistes. Les gens se répétaient que les juifs se vengeaient pour « les années Khmelnytski », du nom de l'etman des cosaques zaporogues qui, au XVIIe siècle, a libéré l'Ukraine du joug des Polonais (lesquels avaient jusque là confié aux Juifs la perception des impôts...). Cet héritage historique convaincra de nombreux Ukrainiens à s'engager contre les soviétiques dans la Waffen SS. L'implacable épuration qui s'ensuivit entraînera des centaines de milliers de déportations. On comprend bien que cela obère la relation des Ukrainiens avec les Russes, mais pas que cela les amène à soutenir des oligarques cosmopolites, parmi lesquels de très nombreux juifs !
Pierre Koenig relève que c'est le 25 juillet dernier que Poutine a consacré le Club Stolypine. Animé par son conseiller Sergueï Glaziev, il vise à donner à l'économie russe un modèle de développement qui tranche sur l'idéologie globaliste du libre marché à l'occidentale d'Alexei Koudrine, dans un retour à la conception westphalienne des rapports entre les nations. Pour le même Pierre Koenig, la Perestroïka de Gorbatchev et la Glasnost sont des opération de déstabilisation menées par l'occident, jusqu'au pillage généralisé et à la sécession des pays baltes, de la Biélorussie, de l'Ukraine et des républiques d'Asie centrale. Cela s'inscrit dans une ligne que la thalassocratie anglo-saxonne a amorcée à l'époque élisabéthaine contre l'Espagne et le Portugal, pour empêcher qu'une puissance continentale domine le continent, et qu'elle a poursuivie contre la France jusqu'à Waterloo, pour briser ensuite les empires austro-hongrois et allemand. Et contre la Russie, à la Guerre de Crimée, alors que l'enjeu était nul pour la France. Depuis la fin de l'URSS, cette oligarchie a gagné une guerre idéologique et s'apprête à réduire l'humanité dans un esclavage culturel. Il est vital de promouvoir, contre ce totalitarisme rampant, la liberté des peuples et la pluralité des cultures.
Pour Thierry Thodinor, à la faveur de l'état de choc dans lequel les peuples européens ont été placés, le 'Consensus de Washington' (FMI/Banque Mondiale...) vise à imposer ses réformes, lesquelles seraient rejetées en temps ordinaire. Dans l'Ukraine d'aujourd'hui, livrée aux maladies infectieuses et au pillage par les prédateurs locaux et par ceux qu'on y a importés (tel ce Hunter Biden, propre fils du vice-président US sortant !), la 'Révolution de la Dignité' s'est transformée en de sordides règlements de compte.
Petrus Agricola, correspondant habituel de Rivarol pour le monde agricole, note au sujet des sanctions prises à propos de l'Ukraine à l'encontre de la Russie de Poutine que, depuis l'arrivée de celui-ci au pouvoir, les Russes ont développé de manière spectaculaire leurs productions agricoles. Notamment en mettant en culture des millions d'hectares de 'tchernozioms', les fameuses terres noires. La Russie est ainsi devenue, devant les Etats-Unis, le premier exportateur mondial de blé, son client le plus important étant l'Egyte. Pendant ce temps, les paysans européens paient la facture de leurs élites donneuses de leçons : avec les fournitures qu'ils destinaient aux Russes, ils noient les marchés qui voient les prix s'effondrer, tant pour leurs fruits et légumes que pour leurs porcs. La Russie est incitée à devenir auto-suffisante, ce qu'elle réalisera très prochainement.
Ancien président de l'Association française de l'Agriculture, l'écrivain Alexis Arette, qui avait dans son livre 'Les damnés de la terre' dénoncé le programme agricole des puissances financières et la trahison de la démocratie chrétienne, des Jeunesses Agricoles Catholiques et des syndicats d'agriculteurs, rappelle que le génocide du monde agricole, initié par le Général De Gaulle, a été concomitant à celui des Harkis et a conduit les résistants (dont lui-même) dans les prisons de la République. Mais qu'il en est sorti 'in-converti' ! Opportunistes, « les syndicalistes agricoles mériteraient, dans un bon régime, d'être pendus ». Des six millions trois cent mille paysans français qui vivaient de la terre à la sortie de la guerre, il en subsiste moins d'un million, dont plus de deux cent mille exploitations de « subsistance » de paysans misérables qui s'accrochent par amour de la terre. Avec une productivité énorme de basse qualité, sur des sols stérilisés, avec des économies d'échelle qui ne compensent pas la fragilisation, notamment celle des cheptels, touchés par des pandémies et gavés d'antibiotiques. Dans le même temps, Poutine mise sur la qualité de la production d'une agronomie biologique.
Claude Valsardieu égraine toute une théorie d'images suggestives et de symboles évocateurs, confirmés par des étymologies, certaines fermes comme le roc, d'autres émouvantes et vertigineuses, pour inviter à se réapproprier les mystères de la lumière virginale de l'aurore : le coq, Mithra et Epona, Athéna et l'étoile du matin. Et il rappelle comment, à l'époque romane, l'Eglise a investi la majesté païenne de l'aurore avec la crèche de Noël, avec le Petit-Jésus, symbole de la naissance du soleil, et avec la Sainte Vierge, vêtue de bleu-pâle et de blanc comme la lumière aurorale. Il établit ensuite la coïncidence entre sainte Barbe, la barbare Berbère que Vatican II a éjectée du calendrier, et Danaé, princesse d'Argos qui fut comme Barbe enfermée par son père dans une tour, où Zeus vint la féconder par une pluie d'or, afin qu'elle enfante Persée et que celui-ci puisse tuer la Méduse. Qui donc restituera leur benoîte patronne aux mineurs et aux géologues, aux puisatiers et aux artificiers, aux artilleurs et aux pompiers.
http://euro-synergies.hautetfort.com/
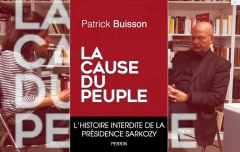 Les lignes qui suivent, puissantes et pénétrantes, toutes marquées d'authentique esprit contre-révolutionnaire, ne sont pas de Charles Maurras, venues de temps lointains ... Mais du premier des conseillers du précédent président de la République française, Patrick Buisson. « Le doute n'habite-t-il pas le système lui-même ? » demande-t-il. Il en fut l'un des rouages les plus hauts placés de 2007 à 2012. Sans illusion et sans abandon ni de ses convictions de fond ni de sa lucidité critique. Est-ce folie de supposer possible qu'en certaines circonstances déterminées un tel régime pourrait s'effondrer sur lui-même, se défausser, laisser la place ? A méditer. Lafautearousseau
Les lignes qui suivent, puissantes et pénétrantes, toutes marquées d'authentique esprit contre-révolutionnaire, ne sont pas de Charles Maurras, venues de temps lointains ... Mais du premier des conseillers du précédent président de la République française, Patrick Buisson. « Le doute n'habite-t-il pas le système lui-même ? » demande-t-il. Il en fut l'un des rouages les plus hauts placés de 2007 à 2012. Sans illusion et sans abandon ni de ses convictions de fond ni de sa lucidité critique. Est-ce folie de supposer possible qu'en certaines circonstances déterminées un tel régime pourrait s'effondrer sur lui-même, se défausser, laisser la place ? A méditer. Lafautearousseau  TERRE & PEUPLE Magazine n°70: Russie et Ukraine
TERRE & PEUPLE Magazine n°70: Russie et Ukraine 
 Oui, la remigration est possible. Et oui, la préservation de notre identité nécessite que cette remigration soit mise en œuvre. Voilà ce que vient démonter cet ouvrage qui détaille ces 30 mesures pour une politique d’identité et de remigration (éd. Idées), ainsi que leurs modalités d’application. Avec cet ouvrage, sur lequel aucun candidat à la présidentielle ne pourra faire l’impasse,
Oui, la remigration est possible. Et oui, la préservation de notre identité nécessite que cette remigration soit mise en œuvre. Voilà ce que vient démonter cet ouvrage qui détaille ces 30 mesures pour une politique d’identité et de remigration (éd. Idées), ainsi que leurs modalités d’application. Avec cet ouvrage, sur lequel aucun candidat à la présidentielle ne pourra faire l’impasse,