culture et histoire - Page 1754
-
RFR - Tribune des orateurs - 1
-
Conférence: Roberto Fiorini - Ile de France - 19/10/13

-
Paris Violence Guerre Sur Tous Les Fronts
-
On marche sur la tête : Assistante maternelle : pour un "bonjour", elle perd son agrément
Bonjour, merci, s’il te plaît… Chez Gwenaëlle Laverda, assistante maternelle, “la politesse fait partie des règles de base, tout n’arrive pas sur un plateau d’argent”.
Une règle qui lui a coûté son agrément le 12 mars dernier.

A 34 ans, cette habitante de Frans se retrouve sans emploi pour avoir voulu inculquer à un enfant de trois ans et demi ce qu’elle considère comme un principe éducatif élémentaire : la politesse. “Archaïque” lui a répondu la puéricultrice du secteur sur lequel elle exerçait.
“Rigide et inadapté” a considéré la commission consultative paritaire des assistants maternels départemental qui a rendu la sentence.
A l’origine de la procédure, une remarque notée dans le carnet de liaison entre les parents de l’enfant et l’assistante maternelle. Le garçon de trois ans et demi en novembre 2012, date des faits, reprend le mari de sa nourrice.
“Tu ne m’as pas dit bonjour” lui lance-t-il. Une réflexion d’enfant qui surprend Gwenaëlle et qu’elle consigne dans le carnet pour en informer les parents après avoir fait une remontrance au petit qui depuis plusieurs semaines refuse de dire bonjour. Pas de punition, le sermon n’ira pas plus loin.
“Avant de signer le contrat, j’avais pourtant rencontré deux fois les parents. Ils connaissaient mes principes éducatifs et étaient d’accord”, explique l’assistante maternelle qui affirme les avoir prévenu plusieurs fois du comportement de leur fils, dont elle avait la garde périscolaire depuis septembre 2012.
La remarque passe mal, les parents licencient l’assistante maternelle et contactent la PMI (protection maternelle et infantile). Visite de la puéricultrice du secteur et une convocation du conseil général au courrier : Gwenaëlle Laverda a rendez-vous le 5 mars avec la commission consultative paritaire. “Votre agrément fait l’objet d’une proposition de retrait pour les raisons suivantes : vous n’avez pas un comportement professionnel envers les enfants accueillis,” lui écrit-on. L’enquête est close…
Soutenue
Elle s’y rend, soutenue et accompagnée des parents des deux autres enfants dont elle a la garde. Des parents en colère eux-aussi de voir leur nourrice mise en cause. “Nous sommes parents de deux enfants qui s’épanouissent pleinement au contact de leur assistante maternelle”, écrira d’ailleurs Jérémy Robert, le père de famille, aux autorités.
Le témoignage n’empêchera pas au conseil général de décider du retrait de l’agrément de leur assistante maternelle qui reproche également à la nourrice de ne pas avoir respecté les consignes des parents relatives à son état de santé. L’enfant étant sujet à des poussées de fièvres, ses parents avaient demandé à l’assistante de ne pas le forcer à manger. Une consigne que ne conteste pas l’assistante mais pas question de sauter les haricots pour passer directement au dessert : “on fait très attention au gaspillage” prévient aussi la jeune femme.
On a pensé que…
Une instruction à charge pour les parents qui soutiennent leur nourrice, un tribunal pour l’assistante maternelle. “On a pensé que son attitude, cette rigidité éducative inadaptée, allait provoquer des blocages et on ne pouvait donc pas garantir des conditions d’épanouissement de l’enfant en bas âge” justifie Thierry Clément, directeur de la prévention et l’action sociale au conseil général de l’Ain.
Pour la commission, l’assistante maternelle refuserait de remettre son comportement en question. Principe de précaution sans doute, le réprésentant indique néanmoins qu’il n’y avait pas là de mise en danger de l’enfant. “Mais une assistante maternelle doit avoir du recul et ne doit pas se fâcher contre un enfant”, défend le représentant. Gwenaëlle Laverda attend aujourd’hui de consulter son dossier professionnelle pour peut-être comprendre.
Elle a choisi de faire appel de cette décision. Une décision qui interroge : la politesse, un vilain défaut ?
Marion Villeminot - La Voix de l’Ain
http://www.actionfrancaise.net/craf/?On-marche-sur-la-tete-Assistante
-
Aristote et la politique
-
Alexandre Latsa : « la Russie connait un renouveau religieux sans précédent »
Alexandre Latsa est un Français qui travaille en Russie et réside à Moscou depuis 2008. Il est blogueur et analyste politique et géopolitique pour les agences russes RIA-Novosti et Voix de la Russie. Il tient aussi un site d’information intitulé la Dissonance: un autre regard sur la Russie. Nous lui avons posé des questions sur la France et la Russie, le dossier syrien…
1) Comment qualifierez-vous les relations entre nos deux pays qui défendent des valeurs totalement différentes (loi Taubira et loi interdisant la propagande homosexuel)?
Du point de vue économique elles sont encore plutôt bonnes puisque les indicateurs économiques sont positifs et les échanges entre les deux pays sont croissants. On constate depuis 2009 une hausse des investissements français en Russie et surtout plus récemment une hausse des investissements russes en France. On a d’ailleurs récemment parlé de diplomatie économique pour qualifier la relation de la Russie avec nombre de pays européens, dont la France.
Sur le plan politique, la relation semble s’essouffler, ce qui était assez prévisible avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en France. La France affirme son statut de terre d’asile pour de nombreux agitateurs politiques, qu’ils s’agissent d’opposants libéraux soupçonnés de corruption ou d’agents provocateurs comme les Femen qui bénéficient des grâces de la république.
L’affaire Syrienne a en outre porté un coup très dur aux relations entre les deux pays car la Russie et la France ont clairement sur ce dossier des approches différentes et surtout des objectifs opposés.
Sur le plan des mœurs enfin une rupture Russie/Europe de l’ouest semble clairement s’établir. Cette rupture semble due aux choix des modèles de société diamétralement opposés que l’Europe de l’Ouest (donc la France) et la Russie développent. Et sur ce plan la nous sommes clairement face à un nouveau rideau de fer moral et sociétal. Il y a aussi le facteur religieux qui est important, la Russie connaît en effet un renouveau religieux sans précédent et dont on ne peut que difficilement mesurer l’ampleur vu de France. A contrario la France semble être entrée dans une période d’athéisme totalitaire qui vise en premier lieu la religion catholique.
2) Poutine a porté un sérieux coup à la diplomatie française sur le dossier syrien mais Fabius a déclaré que la position française avait obligé les Russes à négocier. Êtes-vous d’accord avec lui ?
Malheureusement il semble que la diplomatie Française se soit un peu trop rapidement avancée dans cette affaire. La France a joué les Va-t-en guerre de façon irrationnelle et injustifiée et au final l’accord Russo-américain qui émerge de la crise nous laisse totalement à l’écart du centre de prises de décision et nous affaiblit considérablement sur la scène internationale.
Le président Assad, qui est visiblement pour l’instant du moins en train de gagner sur tous les fronts (militaire, politique et médiatique) s’est même permis de rappeler que : « l’Europe n’avait pas mot à jouer dans le règlement de la crise ». Ce faisant on peut penser qu’il visait clairement l’Angleterre et la France.
Laurent Fabius a été ridiculisé et au passage a fait ridiculiser la France, ce qui est plus grave. Il est bien évident que les affirmations que vous citez sont une bien piètre tentative de tenter de sauver le peu qui reste à sauver. Personne ne peut sérieusement croire que la France a dans cette affaire influé la position russe d’une quelconque façon. Au contraire, on peut plutôt penser que les diplomates français ont dans cette affaire pris une bonne leçon de la part de la diplomatie russe. N’est pas joueur d’échec qui veut.
3) Certains parlent de l’émergence d’un monde bipolaire ou d’une nouvelle guerre froide entre les USA et la Russie, est-ce exact ?
La guerre froide n’a jamais cessé. Elle s’était atténuée car à la chute de l’URSS les élites russes se sont retrouvées désorientées, à la tête d’un Etat à la dérive et aux mains de lobbies et groupes mafieux qui ont totalement parasitée tant le fonctionnement intérieur qu’extérieur du pays. Certains stratèges américains ont alors pensé qu’il suffisait d’accompagner l’effondrement inévitable de la Russie.
Mais en 2000 à la surprise générale, un nouveau visage est apparu dans la politique russe. Un homme dont le projet politique, le redressement de la Russie, est en train de se réaliser. Ce redressement entre en conflit total avec les projets américains pour l’Europe et le monde, qui passait notamment par une prise de contrôle politique et militaire maximale sur la région Eurasie et la prise de contrôle des réserves énergétiques et des voix énergétiques d’Eurasie.
Plus la Russie se relève et reprend sa position de puissance régionale et désormais (on vient d’en avoir la preuve avec la Syrie) de puissance mondiale, plus la tension entre Amérique et Russie va s’accroitre mais l’Amérique a de moins en moins les moyens de nuire à la Russie. On l’a bien vu historiquement du reste, le département d’Etat américain a d’abord mené la guerre contre la Russie sur son territoire (guerres dans le Caucase russe en 1994 et 1999), puis dans l’étranger proche russe (guerre de Géorgie en 2008) et désormais encore plus loin à l’extérieur des frontières russes (guerre en Syrie de 2011) car il s’agit d’une guerre directement dirigée contre la Russie comme je l’ai expliqué ici.
4) En général, comment les Russes perçoivent la politique française et le mandat de Hollande plus particulièrement?
Avec un relatif désintéressement mais une certaine incompréhension.
Le peuple russe a clairement compris la nécessite d’un homme fort à la tête de l’état. Ils savent que la France traverse des moments troubles et donc ils se demandent pourquoi voter pour un socialiste qu’ils assimilent à raison du reste, à plus d’immigration et de laxisme.
Par conséquent, les russes estimant qu’ils faillent moins d’immigrés et plus d’ordre, et ce de façon générale et permanente, chez eux comme chez nous, on peut comprendre leur relative incompréhension face au choix du peuple français de voter pour un candidat socialiste.
5) Pour finir, Poutine est l’homme fort de la Russie, qui pourrait lui succéder dans un avenir plus ou moins lointain?
Il y a une science qui est celle de la Kremlinologie et qui consiste à tenter de prévoir ce qui se passera au Kremlin. Je peux vous certifier qu’il s’agit de la science la plus incertaine et la plus improbable qui soit!
Il y a de nombreux personnages clefs autour de Vladimir Poutine mais de la à prévoir qui sera le successeur de Vladimir Poutine c’est chose impossible croyez moi. On ne sait toujours pas du reste si Vladimir Poutine se présentera de nouveau en 2018 ce qui repousserait le nécessaire choix d’un successeur à 2024.
D’ici la, beaucoup de choses auront inévitablement changé, en Russie comme ailleurs. Il est plausible que de nouveaux visages apparaissent et peut être de façon aussi surprenante ou inattendue que n’est apparu Vladimir Poutine en 1999.
L’histoire russe est ouverte, contrairement à la situation actuelle dans nombre de nations ouest-européennes, et ce pour une raison principale: les élites russes ont réellement le pouvoir, elles sont souveraines et surtout elles ont un projet colossal pour le futur.
-
LES ARBRES DE LA VIE LES DIEUX VIVENT DANS LES FORÊTS
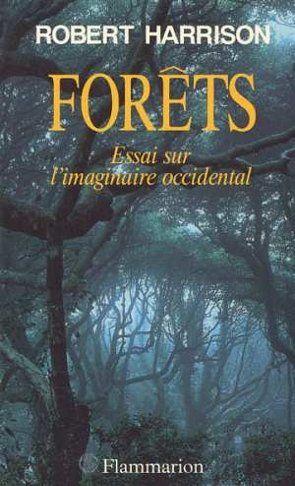 [Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest, forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]
[Ci-contre : couverture de l'étude de R. Harrison, reparue en poche (Champs-Flammarion, 1994). « Le mot “forêt” est à l’origine un terme juridique. Tout comme ses nombreux dérivés dans les langues européennes (foresta, forest, forst...), il vient du latin foresta. Le mot latin n’apparait pas avant la période mérovingienne. Dans les documents romains et les premiers actes du Moyen Âge le terme usuel pour désigner les bois et les régions boisées était nemus. Le mot foresta apparaît pour la première fois dans les lois des Lombards et les capitulaires de Charlemagne, pour désigner non tant les régions boisées en général que les réserves de chasse royale. L’origine du mot est incertaine. Selon toute vraisemblance, il viendrait du latin foris, en dehors. L’obscur verbe latin forestare signifiait retenir en dehors, mettre à l’écart, exclure. En effet, pendant la période mérovingienne où le mot foresta fit son entrée dans le lexique, les rois s’étaient octroyé le droit d’exclure du domaine public de vastes étendues boisées, afin d’y préserver la vie sauvage qui, en retour, devait assurer le maintien d’un rituel royal fondamental : la chasse »]« Détruire des forêts ne signifie pas seulement réduire en cendres des siècles de croissance naturelle. C'est aussi un fonds de mémoire culturelle qui s'en va » : Robert Harrison résume bien, ainsi, l'enjeu plurimillénaire, le choix de civilisation que représente la forêt, avec ses mythes et ses réalités (Forêts : Essai sur l'imaginaire occidental, Flammarion, 1992). Une forêt omniprésente dans l'imaginaire européen.
L'inconscient collectif est aujourd'hui frappé par la destruction des forêts, due à l'incendie, aux pluies acides, à une exploitation excessive. Un être normal — c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encore totalement conditionné par la société marchande — ressent, quelque part au fond de lui-même, quelle vitale vérité exprime Jean Giono lorsqu'il écrit de l'un de ses personnages : « Il pense : il tue quand il coupe un arbre ! »
Le rapport de l'homme à la forêt est primordial. Il traduit une vision du monde, le choix d'un système de valeurs. Car la forêt, symbole fort, porte en elle des références fondamentales. « Une époque historique — écrit Harrison — livre des révélations essentielles sur son idéologie, ses institutions et ses lois, ou son tempérament culturel, à travers les différentes manières dont elle traite ou considère ses forêts ». Dans la longue mémoire culturelle des peuples, la place donnée — ou non — aux forêts est un repère qui ne trompe pas.
Pour étudier la place des forêts dans les cultures et les civilisations, depuis qu'il existe à la surface de la terre des sociétés humaines, Harrison prend pour guide une grille d'analyse forgée par un Napolitain du XVIIIe siècle, Giambattisto Vico, qui résume ainsi l'évolution de l'humanité : « Les choses se sont succédé dans l'ordre suivant : d'abord les forêts, puis les cabanes, les villages, les cités et enfin les académies savantes » (La Science nouvelle, 1744).
Ainsi, les forêts seraient à l'origine la matrice naturelle d'où seraient sortis les premiers hommes. Lesquels, en s'affranchissant du milieu forestier pour ouvrir des clairières, en se regroupant pour construire des cabanes, auraient planté les premiers jalons de la civilisation, c'est-à-dire de la conquête de l'homme sur la nature. Puis, d'étape en étape, de la ruralité au phénomène urbain, de la rusticité à la culture savante, de la glèbe aux salons intellectuels, l'humanité aurait réalisé son ascension. On voit bien, ici, s'exprimer crûment cette conception tout à la fois linéaire et progressiste de l'histoire, qui triomphe au XVIIIe siècle avec la philosophie libérale des Lumières pour nourrir, successivement, l'idéologie libérale et l'idéologie marxiste. Mais cette vision de l'histoire plonge ses racines très loin, dans cette région du monde qui, entre Méditerranée et Mésopotamie, a donné successivement naissance au judaïsme, au christianisme et à l'islam, ces 3 monothéismes qui sont définis, à juste titre, comme les religions du Livre.
TU NE PLANTERAS PAS...
Religions du Livre, de la Loi, du désert. C'est-à-dire religions ennemies de la forêt, car celle-ci constitue un univers à tous égards incompatible avec le message des fils d' Abraham. La Bible, est, à ce sujet, sans ambiguïté. Dans le Deutéronome, Moïse ordonne à ses errants dont il veut faire le Peuple élu de brûler, sur leur passage, les bois sacrés que vénèrent les païens, de détruire ces piliers de bois qui se veulent image de l'arbre de vie : « Mais voici comment vous devez agir à leur égard : vous démolirez leurs autels, briserez leurs stèles, vous couperez leurs pieux sacrés, et vous brûlerez leurs idoles ». L'affirmation du Dieu unique implique l'anéantissement des symboles qui lui sont étrangers : « Tu ne planteras pas de pieu sacré, de quelque bois que ce soit, à côté de l'autel de Yahvé ton Dieu que tu auras bâti ».
Cet impératif sera perpétué par le christianisme, du moins en ses débuts lorsqu'il rencontre sur son chemin, comme principal obstacle, la forêt et ses mythes. Très vite, l'Église pose en principe un face à face entre les notions de paganisme, sauvagerie et forêt (sauvage vient de sylva), d'un côté, et christianisme, civilisation et ville, de l'autre. Quand Charlemagne entreprend. pour se faire bien voir d'une Église dont il attend la couronne impériale, une guerre sainte en Saxe, bastion du paganisme, il donne pour première consigne à ses armées de détruire l'lrminsul, ce monument qui représente l'arbre de vie et qui est le point de ralliement des Saxons. Le message est clair : pour détruire la capacité de résistance militaire des païens, il faut d'abord éliminer ce qui donne sens à leur combat. Calcul erroné, puisqu'il faudra, après la destruction de l'lrminsul, encore trente ans de massacres et de déportations systématiques pour imposer la croix. Les clercs entourant Charlemagne n'avaient pas compris que pour les Saxons comme pour tout païen, les dieux vivent au cœur des forêts, comme le constatait déjà Tacite chez les Germains de son temps. Autrement dit, tant qu'il reste un arbre debout, le divin est présent.
LA FORÊT-CATHÉDRALE
La soumission forcée des Saxons n'aura pas fait disparaître pour autant la spiritualité liée aux forêts. Car le christianisme a dû, contraint et forcé, s'adapter à la mentalité européenne, récupérer et intégrer les vieux mythes qui parlaient encore si fort, au cœur des hommes. Cette récupération s'exprime à travers l'architecture religieuse : « La cathédrale gothique — note Harrison — reproduit visiblement les anciens lieux de culte dans son intérieur majestueux qui s'élève verticalement vers le ciel et s'arrondit de tous côtés en une voûte semblable à celle des arbres rejoignant leurs cimes. Comme des ouvertures dans le feuillage, les fenêtres laissent pénétrer la lumière de l'extérieur. En d'autres termes, l'expression forêt-cathédrale recouvre davantage qu'une simple analogie, car cette analogie repose sur la correspondance ancienne entre les forêts et la résidence d'un dieu » (cf. aussi Les Racines des cathédrales, Roland Bechmann, Payot, 1981).
L'Église s'est trouvée, au Moyen Âge, confrontée à un dilemme : contre le panthéisme inhérent au paganisme, et qui voit le divin partout immergé dans la nature, il fallait décider d'une stratégie de lutte. Réprimer, pour extirper, éradiquer ? C'est la solution que préconisent de pieuses âmes, comme le moine bourguignon Raoul Glaber : « Qu'on prenne garde aux formes si variées des supercheries diaboliques et humaines qui abondent de par le monde et qui ont notamment une prédilection pour ces sources et ces arbres que les malades vénèrent sans discernement ». En favorisant les grands défrichements des Xlle et XIlle siècles, les moines ont un objectif qui dépasse de beaucoup le simple intérêt économique, le gain de nouvelles surfaces cultivables : il s'agit avant tout, de faire reculer ce monde dangereux, car magique, qui abrite fées et nymphes, sylves et sorcières, enchanteurs et ermites (dont beaucoup trop ont des allures rappelant fâcheusement les hommes des chênes, les anciens druides). Brocéliande est, comme Merlin, « un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres ».
Faut-il, donc, détruire les forêts ? Les plus intelligents des hommes d'Église comprennent, au Moyen Âge, qu'il y a mieux à faire. Le culte de saint Hubert est chargé de faire accepter la croix par les chasseurs. Les “chênes de saint Jean” doivent, sous leur nouveau vocable, fixer une étiquette chrétienne sur les vieux cultes du solstice qui se pratiquent à leur pied. On creuse une niche dans l'arbre sacré pour y loger une statuette de la Vierge (nouvelle image de l'éternelle Terre-Mère). Devant “l'arbre aux fées” où se retrouvent à Domrémy Jeanne d'Arc et les enfants de son âge, on célèbre des messes. La plantation du Mai, conservée, sera compensée par la fête des Rameaux ( qui vient remplacer la Fête de l'arbre que célébraient, dans le monde romain, les compagnons charpentiers pour marquer le cyclique et éternel retour du printemps).
Saint Bernard, qui a su si bien, comme le rappelle Henri Vincenot [in : Les Étoiles de Compostelle, Denoël, 1984, repris en Folio, 1987], perpétuer les traditions celtiques, assure tranquillement devant un auditoire d'étudiants : « Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira ». Cet accueil et cette intégration, par le syncrétisme, d'une nature longtemps perçue, par la tendance dualiste présente dans le christianisme, comme le monde du mal, du péché, sont poursuivis par un saint François d'Assise. « C'était en accueillant la nature — constate Georges Duby —, les bêtes sauvages, la fraîcheur de l'aube et les vignes mûrissantes que l'Église des cathédrales pouvait espérer attirer les chevaliers chasseurs, les troubadours, les vieilles croyances païennes dans la puissance des forces agrestes » (Le temps des cathédrales, Gal., 1976).
La perpétuation du symbole de l'arbre et de la forêt se fera, à l'époque moderne, par la plantation d'arbres de la Liberté (1), les sapins de NoëI, la branche verte placée par les compagnons charpentiers sur le faîtage terminé de la maison...
L'ARBRE COMME SOURCE DE VIE
 Mais, référence culturelle par excellence, la forêt reste, jusqu'à nos jours, un enjeu idéologique et l'illustration d'un choix de valeurs. Quand Descartes, dans son Discours de la méthode, compare l'autorité de la tradition à une forêt d'erreurs, il prend la forêt comme symbole d'un réel, foisonnant et touffu, dont il faut s'abstraire, en lui opposant la froide mécanique Raison. « Si Descartes se perd dans la forêt — le monde historique, matériel —, ne nous étonnons pas qu'il se sente chez lui dans le désert (...) C'est l'esprit désincarné qui se retire de l'histoire, qui s'abstrait de sa matière et de sa culture » (R. Harrison, op. cit.). Ajoutons : de son peuple.
Mais, référence culturelle par excellence, la forêt reste, jusqu'à nos jours, un enjeu idéologique et l'illustration d'un choix de valeurs. Quand Descartes, dans son Discours de la méthode, compare l'autorité de la tradition à une forêt d'erreurs, il prend la forêt comme symbole d'un réel, foisonnant et touffu, dont il faut s'abstraire, en lui opposant la froide mécanique Raison. « Si Descartes se perd dans la forêt — le monde historique, matériel —, ne nous étonnons pas qu'il se sente chez lui dans le désert (...) C'est l'esprit désincarné qui se retire de l'histoire, qui s'abstrait de sa matière et de sa culture » (R. Harrison, op. cit.). Ajoutons : de son peuple.Inversement, en publiant leurs célèbres Contes et légendes du foyer, les frères Grimm, au XIXe siècle, entendent redonner, par le biais de la langue, un terreau culturel, un enracinement à la communauté nationale et populaire allemande. Or, significativement, la forêt est omniprésente dans leurs contes, en tant que lieu par excellence de ressourcement.
L'arbre comme source de vie. Présent encore parmi nous grâce à une reuvre qui a, par bien des aspects, valeur initiatique, Henri Vincenot me confiait un jour : « II y a dans la nature des courants de forces. Pour reprendre des forces, c'est vrai que mon grand-père s'adossait à un arbre, de préférence un chêne, et se pressait contre lui. En plaquant son dos, ses talons, ses mains contre un tronc d'arbre, il ne faisait rien d'autre que de capter les forces qui vivent et cornmontent en l'arbre. Il ne faisait qu'invoquer, pour y puiser une nouvelle énergie les puissances de la terre, du ciel, de l'eau, des rochers, de la mer... » (éléments n°53).
► Pierre Vial, Le Choc du Mois n°53, 1992.
(1) cf. Jérémie Benoit, « L'Arbre de la Liberté : résurgence d'une mentalité indo-européenne », in Études indo-européennes, 1991.
-
Bagadou stourm - Bezenn Parrot
-
La chasse au Delon est ouverte
J’ai redécouvert à Trevelez cet été qu’il y avait une vie hors de la matrice ; et que pour sortir corps et âme de la matrice techno et culturelle, il me fallait ne plus écrire de chroniques en français. Il ne faut plus être français du tout ; il me semble d’ailleurs que la France hollandaise, même mécontente dans les sondages, mérite ce qu’elle a, et qu’elle en redemande. Les chroniques, souvent incomprises, que j’ai faites depuis deux ans sur son histoire intellectuelle ne l’auront que trop confirmé : après 1870 les jeux sont faits en France pour le pire et l’encore plus pire. La France aime l’étranger, les droits de l’homme, le socialisme, le métissage, l’universalisme et l’Amérique post-WASP en guerre éternelle et inutile. C’est BHL qui a raison, BHL son saigneur et mentor officiel. La France postmoderne adore encore plus l’interventionnisme, le fun, les surgelés Picard et la fiscalité. Jules Verne même, ai-je appris récemment dans son excellent "Clovis Dardentor" explique que l’on perdra l’Algérie à cause de l’absence de vrais colons et de la sur-présence du fonctionnaire. Le dernier coup de grâce - ou de race - aura été donné en Mai 68 par le petit peuple néanderthalien, guidé par ses instits’ festifs et nihilistes, et toujours si soucieux de donner la chasse au restant des germains épargnés en 1789 ou sur les charniers républicains (pour 89 ce n’est pas de moi, c’est de Renan). Le mauvais pli pris par la droite molle ou faussement dure suit logiquement l’involution de cette terre fatiguée - et fatigante à plus d’un trait.
Pour le reste, comme me le recommande un commentateur désagréable à souhait (Jaurès, je crois, qui semble payé pour ça), je vais me consacrer de plus près à la grande littérature ou à quelque essai ambitieux ; je l’ai pourtant déjà fait, voyez mon catalogue, mais parfois en pure perte car les temps et les lieux ne s’y prêtaient pas. Mais j’ai été heureusement traduit en russe (mon "Tolkien" - ce n’est pas le seul traduit de mes opus), ce qui m’a permis de rencontrer ma merveilleuse femme. J’ai depuis viré à l’orthodoxie, laissant aux cathos réacs le soin de conspuer leur pape comme à l’époque de Léon Bloy.
Mes amitiés à mes rares mais suffisants lecteurs, mes Happy Few, comme disait l’Autre. Je leur recommande de réapprendre le latin pour lire les vrais classiques dans le texte, rien n’est meilleur pour l’esprit et sa santé. Virgile ou bien Tacite, quel pied de nez au système social ; quelle lumière aussi pour se préparer à la vieillesse et au sommeil éternel qui nous attend bien plus sûrement que la faillite de la presque Hollande ou la baisse des actions Facebook.
La - dernière - chronique que l’on va lire est donc pour la presse russe et elle traite de l’affaire Alain Delon pour mon public russe. Si on ne l’aime pas, on pourra toujours en relire de précédentes ! J’en ai eu de bien notées par mes impavides examinateurs !
France : la chasse à Alain Delon est ouverteLa France n’est certes plus le grand pays rayonnant qu’il a été au temps du général de Gaulle, quand le monde entier respectait son prestige, ses armes, sa diplomatie, mais aussi ses chanteurs et ses artistes de cinéma. Petite colonie américaine aigrie, la France est aujourd’hui un pays néo-totalitaire (comme dit le journaliste d’extrême-gauche Halimi) où la chasse aux sorcières est tout le temps ouverte. Le récent scandale et la diabolisation soulevée par les propos politiquement incorrects d’Alain Delon en matière homosexuelle (matière la plus redoutable de toutes, Vladimir Poutine et la Russie, toujours en position d’accusés ici, en savent quelque chose) sont là pour en témoigner.
Alain Delon a donc déclaré à la télé française qu’il était opposé à la cause homosexuelle, cause qui commence à casser les pieds de presque tous les Français ici, et il a même ajouté sans doute un peu trop lyrique, que l’homosexualité était contre nature ; mais comme on sait la science moderne a beaucoup fait reculé les limites de cette pauvre nature ! Immédiatement il a eu droit à ce que nous appelons en français une levée de boucliers, et notre dernière star internationale - tout aussi diabolisée et marginalisée que notre légendaire Brigitte Bardot, qui préfère s’occuper des animaux que des Français, et comme on la comprend ! - a été donc dénoncé, marginalisé, critiqué, houspillé, diabolisé, etc. Comme Delon a plus de soixante-dix ans, on l’a aussi traité de gâteux, de papy car ce racisme antivieux est lui très bien toléré en France maintenant (la plupart des vieux étant des blancs et des chrétiens, il est donc légitime et moral de les insulter dans ce malheureux pays).
Je dois dire maintenant que j’ai mal compris la sortie de notre ami Delon, si j’ai très bien compris la réaction satanique de nos médias de masse. Je me suis demandé en effet comme Molière ce qu’il allait faire dans cette galère. Pourquoi parler des sujets qui brûlent dans un pays dégénéré, devenu dangereux (les touristes en savent quelque chose !) et surtout habité par les démons de la chasse aux sorcières ? Le grand cinéaste Annaud que j’ai interviewé pour La Pravda m’a plusieurs fois dit en privé qu’il était très prudent au moment des interviews, et que la langue de bois était faite pour les médias de masse occidentaux, qui poussent de plus en plus à la création orwellienne d’une novlangue, d’une pensée unique et d’une police de la pensée. Alain Delon aurait donc dû savoir ce qui allait lui tomber dessus.
On me dira que ce guerrier et samouraï du cinéma en a vu d’autres (il avait même confessé à la BBC que les expériences homosexuelles n’avaient rien de déshonorant - c’était en jouant au billard, et en répondant en anglais il y a cinquante déjà...) et qu’il a peut-être voulu une fois nouvelle faire parler de lui en termes polémiques. La polémique n’a jamais nui à son personnage bien au contraire. Mais cette fois-ci sa fille Anouchka a tenu à se désolidariser des propos de son père. Trahison filiale bien venue : car cette société ouverte, tolérante et démocratique ne trouve rien de mieux que de faire dénoncer les parents par leurs enfants comme aux temps les moins ragoûtants du totalitarisme du siècle dernier.
L’affaire Delon nous rappelle une chose ; qu’il s’agisse de la bourse folle et de l’économie en chute libre, de l’immigration, de la Syrie, du contrôle mental et social des populations, l’occident est tombé sur la tête et devrait faire fuir ceux qui ont encore le sens de l’honneur et de la justice. Merci au grand acteur exilé en Suisse de nous l’avoir rappelé.
Nicolas Bonnal http://www.france-courtoise.info/?p=1499#suite
-
Fraction - Esclavage mondial