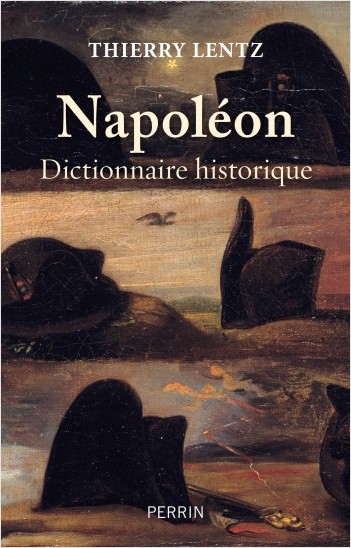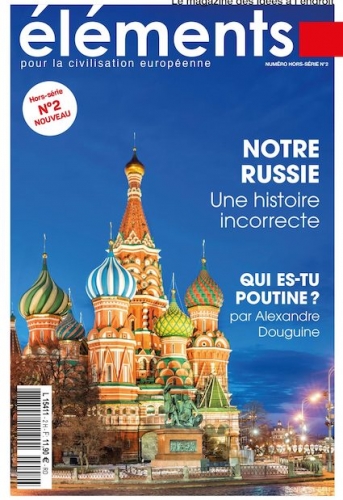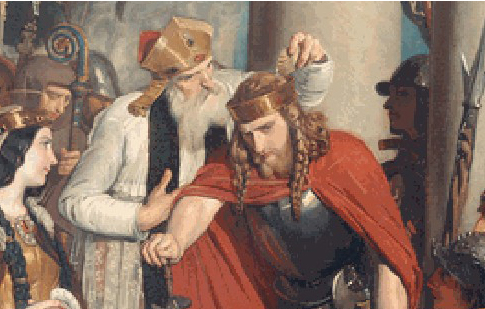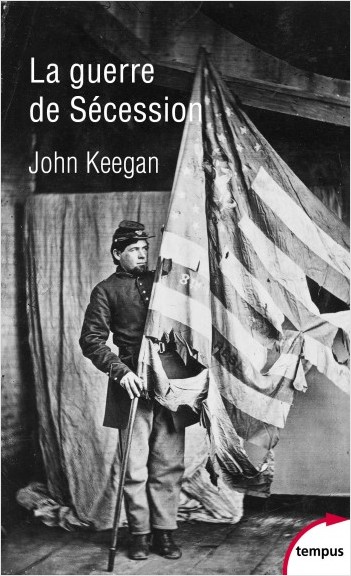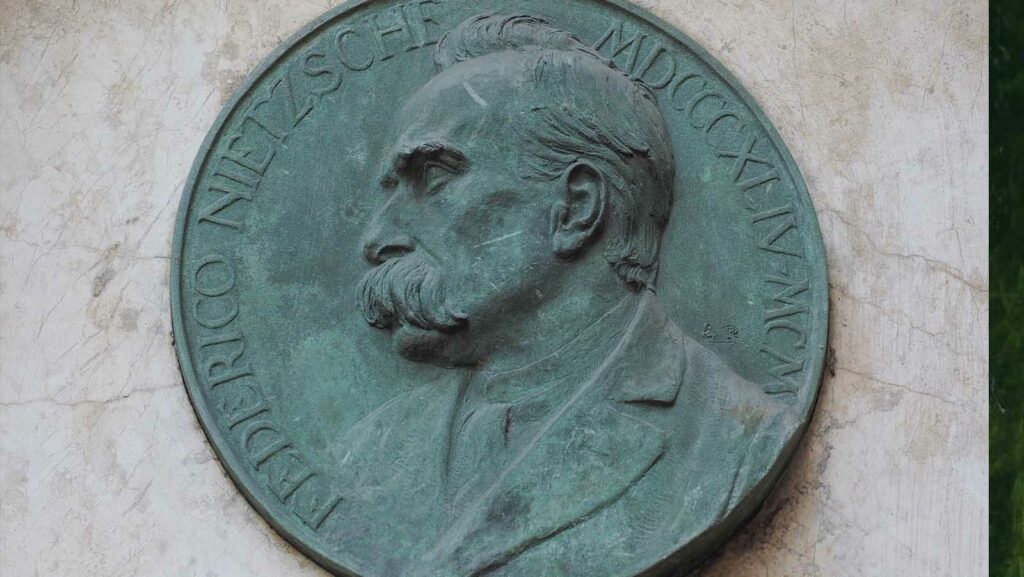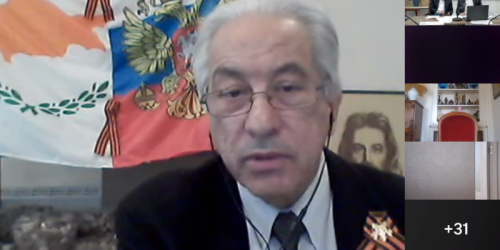Située à proximité de Mulhouse, dans l’Est de la France, l’abbaye d’Oelenberg est l’unique monastère d’hommes en Alsace. Il compte aujourd’hui 9 moines, qui vivent de prière et de travail manuel et intellectuel, selon la règle de saint Benoît. Fondée en 1046, cette abbaye s’est construite au cours des siècles, avec bientôt 1000 ans de péripéties… Dans cet article, on vous explique toute l’histoire de l’abbaye d’Oelenberg, c’est parti !