
Voici la troisième des cinq rubriques extraites de l’éditorial de CHRISTIAN FRANCHET D’ESPÈREY, du n° 58 de la Nouvelle Revue Universelle, fondée par Jacques Bainville en 1920.
Il y a d’abord ce que Philippe Lallement appelle l’extension du maurrassisme “intra-muros”, qui correspond au travail effectué à l’intérieur de la mouvance maurrassienne, dans le sillage de Boutang et de Debray. Dans ce registre, au premier rang des noms à citer, vient Gérard Leclerc. A plus d’un titre : d’abord pour son rôle dans les instances des organisations héritières de l’Action française ; également pour ses chroniques depuis un demi-siècle dans la presse royaliste, qui constituent une véritable encyclopédie critique des idées contemporaines ; enfin comme auteur, dès 1974, d’Un autre Maurras, un ouvrage qui pour la première fois faisait ressortir l’existence d’une anthropologie maurrassienne, et dont on espère – pardon, dont on attend non sans impatience ! – une prochaine réédition ! Motif supplémentaire de citer Gérard Leclerc : c’est lui qui ouvre notre dossier sur le nouvel âge du maurrassisme, avec une étude historique truffée de souvenirs personnels sur le legs de l’Action française. Il y montre que ce n’était pas un mouvement politique comme les autres : pour l’Action française, la politique, c’est beaucoup plus que la politique – pour la raison même qui faisait dire à Pascal que l’homme passe infiniment l’homme. La politique de l’Action française, c’est la défense de la civilisation, c’est la défense de l’homme.
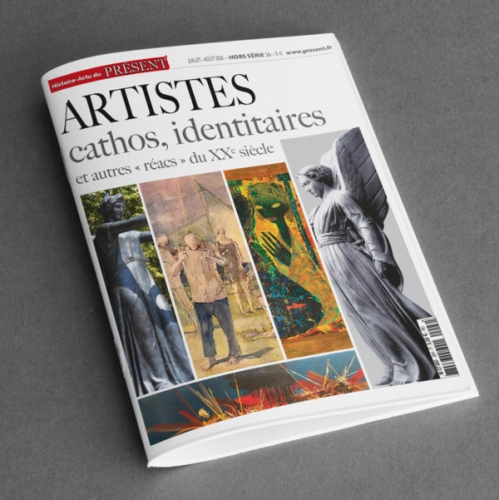



 Il y a à peine soixante ans…
Il y a à peine soixante ans…
