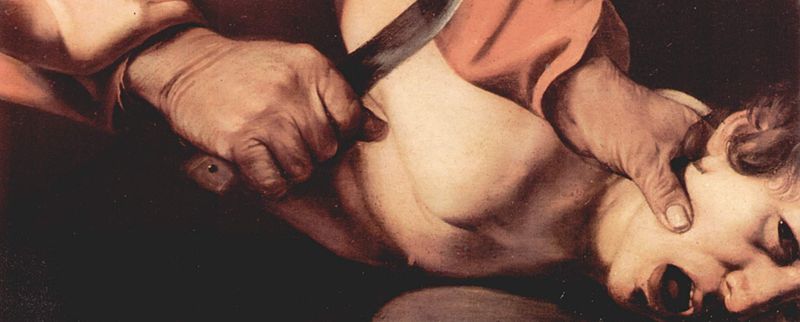Depuis la loi de 1973, dite « loi Rothschild », du nom de la banque dont était issu l’ancien président de la République, Georges Pompidou, l’État est obligé de passer par le système des banques privées pour financer son endettement.
Aujourd’hui, Emmanuel Macron, issu lui aussi de la banque Rothschild, ne compte pas bien sûr remettre en cause cette loi, préférant faire des coupes sombres dans les budgets sociaux pour réduire le déficit de l’État… Depuis 1973, le Trésor public ne peut plus présenter ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. En clair, l’État est condamné à se financer par des emprunts, contre intérêts, auprès de banques privées, au lieu de continuer à emprunter sans intérêt auprès de la Banque de France.