
Dans l’océan des mauvaises nouvelles, guerres et autres massacres, il s’en glisse une parfois qui amène le sourire dans l’odeur du café : mercredi 21 février, le tribunal administratif de Paris a annulé la fermeture des voies sur berge dans le centre de la capitale.
Traduction : Hidalgo peut aller se faire voir.
Bien sûr, Notre-Drame de Paris a décidé de faire appel, mais il n’empêche : voir les juges la prendre la main dans le sac de ses tripatouillages et autres mensonges fait du bien à l’âme.
Comme le souligne, ce jeudi, Alba Ventura dans son édito politique (RTL), « c’est un sacré revers. Parce que là, c’est la justice qui dit que la mairie de Paris a mal fait les choses. Ce n’est pas un éditorialiste ou un automobiliste en colère, ou encore un ennemi politique. » Et puis, surtout, c’est solidement argumenté. Tout d’abord, l’étude d’impact pour la réalisation du projet a été « bâclée ». Les mots de la Justice sont forts : « omissions », « insuffisances », « inexactitudes ». Gros mensonges, même, car le tribunal administratif a relevé que « l’analyse n’a été effectuée que sur une bande de 100 mètres de part et d’autre des voies ». Vous avez bien lu. Pour la rive gauche, l’esplanade du musée d’Orsay et la rive droite, le chantier de la Samaritaine. Du foutage de gueule, comme on dit vulgairement.
Et donc, comme on vous le disait et répétait ces mois derniers, la pollution a bien diminué dans Paris, mais seulement sur une bande de 3,5 km de longueur sur 100 m de largeur, ce que la mairie de Paris appelle « un espace de respiration » (sic). Partout ailleurs c’est un espace d’asphyxie : la pollution a grimpé en flèche, particulièrement dans l’Est parisien (jusqu’à +15 %) et bien au-delà du périphérique.
On ne rouvrira pas les voies sur berge. Anne Hidalgo a, d’ailleurs, pris immédiatement un nouvel « arrêté de piétonisation » et, comme le souligne encore Alba Ventura, « ce ne sont pas les objectifs des opposants au projet » dont « beaucoup savent très bien que l’on ne reviendra sans doute pas en arrière ». Non,
« ce que veulent ceux qui ont porté plainte et qui ont gagné en première instance, c’est que désormais les décisions soient concertées, que la ville de Paris ne décide pas toute seule, dans son coin, alors qu’elle est au cœur de la plus grande région de France. »
Le véritable problème, avec Anne Hidalgo, c’est son incapacité à écouter. Son refus de la discussion, de la concertation. Son obstination soutenue par un sectarisme politique peu commun. La piétonisation de Paris n’a jamais eu pour but de nous aider à respirer, mais seulement d’assurer sa réélection. Mais elle n’est pas très intelligente, madame Hidalgo ; surtout, elle a depuis longtemps atteint son niveau d’incompétence, raison pour laquelle elle enchaîne les mauvais coups : la gamelle des Vélib’ et les 40 millions d’euros de perte dus à l’annulation, par le Conseil d’État, du marché de l’affichage entre la ville et la société JCDecaux, par exemple. Sans compter la belle image des camps de migrants qu’on déplace d’un carrefour à l’autre, la saleté repoussante de la ville, les rats qui courent partout.
Et puis, il y a les décisions qui hérissent tout le monde, y compris dans son bord politique, quand madame Hidalgo trouve de la place – et quelle place ! – pour la quincaillerie flashy de l’américain Jeff Koons mais pas pour accueillir les cendres d’un académicien français. Il faut dire que Michel Déon, dernier survivant des Hussards, incarnait cette droite littéraire, élégante et libertaire qui, dans les années cinquante du siècle dernier, préférait La Table ronde aux Temps modernes des Sartre et compagnie. Jusque dans l’au-delà, un crime impardonnable pour la très sectaire maire de Paris.
En mars 2020, dans deux ans tout juste, nous élirons nos maires. Anne Hidalgo, qui se sait sur un siège éjectable, pense trouver son salut dans le vélo, le patin à roulettes et les baraques à frites.
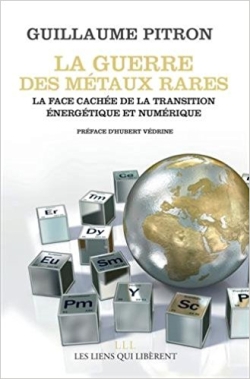 "Que reprochez-vous au modèle de la transition énergétique tel qu'il nous est présenté ?
"Que reprochez-vous au modèle de la transition énergétique tel qu'il nous est présenté ?
 De Loup Mautin
De Loup Mautin

